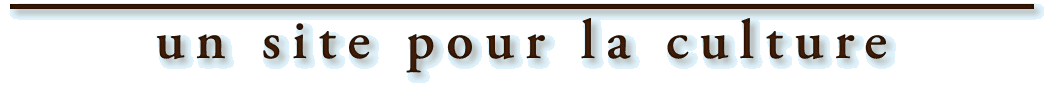Figure traditionnelle d’Orphée, chantant et jouant de la lyre, d’après un vase grec.
Si la Dafne de Peri, en 1597, son Euridice et celle de Caccini en 1600 peuvent être considérées, stricto sensu, comme les tous premiers opéras, c’est incontestablement l’Orfeo de Monteverdi, cette "fable en musique" ("favola in musica") jouée pour la première fois à Mantoue en 1607, qui en est le premier chef-d’oeuvre et a fondé un genre musical qui reste encore aujourd’hui l’un des plus vivants. Ce n’est pas sur le plan "spectaculaire" que s’est opérée cette innovation : les grandes noces royales avaient déjà donné lieu à de grandioses créations où se mêlaient théâtre, musique, danse et "machines" (nous dirions aujourd’hui "effets spéciaux"), comme La Pellegrina en 1589 pour les noces du Grand-Duc Ferdinand Ier de Toscane et de Christine de Lorraine ou les deux Euridice déjà citées pour celles de Henri IV et de Marie de Médicis…
L’innovation, la révolution consistait à sortir la musique de son contexte "madrigalesque" et cessait d’être un simple support conventionnel des paroles : elle épousait ces dernières, les soutenait, les portait dans une symbiose émotionnelle, ce qui inaugurait une nouvelle ère pour la musique occidentale. Paroles et musique devenaient indissociables, comme si elles étaient nées d’un même inspiration. Cette révolution était née des travaux de la Camerata fiorentina, mais c’est sans conteste Monteverdi qui a insuflé à cette révolution musicale un génie inégalé.
« Prima le parole, dopo la musica. »
= « D’abord les mots, ensuite la musique. »
Longtemps confinée au rôle de simple vecteur lyrique, la musique s’est vue accorder une autre dimension. Elles régulait la force des paroles, leur imprimait une charge émotionnelle, les drapait de douceur ou d’aigreur au grè des couplets. Ce n’était plus de simples notes d’accompagnement.
En adoptant le principe de "Primo la parole, doppo la musica", Cavalieri, Peri et Caccini à Florence, Banchieri à Bologne, Monteverdi à Mantoue, ont mis en musique, dans leurs opéras et leurs madrigaux, les plus grands poètes, en soutenant les affects des paroles par une musique aussi évocatrice que celles-ci et en inventant le "stile rappresentativo".
Pendant du "stile rappresentativo", le "recitar cantando" était composé sur des textes libres. Le "recitar cantando" avait évolué dans cet élément essentiel de l’opéra que l’on nomme "récitatif".
Dans cette révolution musicale et esthétique, Monteverdi s’est taillé la part du lion. Ces principes ont donné lieu, de la part de leurs initiateurs, à des tentatives d’une grande qualité, mais encore largement plongées dans leur contexte madrigalesque. Monteverdi, quant à lui, est allé beaucoup plus loin, déjà, dès 1605, dans son 5e Livre de Madrigaux et dans son Orfeo. Mais il ira encore beaucoup plus loin dans ses 7e (1619) et 8e (1638) Livres de Madrigaux, où le genre "magridal" explose littéralement, mais surtout son Couronnement de Poppée (1642), son dernier opéra (on en a perdu de nombreux), qui reste aujourd’hui d’une étonnante modernité.
Ce n’est pas un hasard si le sujet du premier opéra de Monteverdi fut le légendaire musicien de la mythologie grecque, Orfeo en italien, Orphée en français, dont le talent lui permettait même de séduire les monstres infernaux par ses chants mélodieux et de faire quitter à sa douce Eurydice ces sombres demeures.
discographie
| Année Label |
Orfeo Euridice |
Autres interprètes |
Choeur Orchestre |
Chef |
| 1949 BC (*) |
Max Meili Elfreide Trötschel |
Gerda Lammers Eva Fleischer |
Choeur et Orchestre de Chambre de Berlin | Helmut Koch |
| 1955 DG |
Helmut Krebs Hanni Mack-Cosack |
Fritz Wunderlich Jeanne Deroubaix |
Conservatoire de Hambourg Sommerlichen Musiktagen |
August Wenzinger |
| 1960 Ponto |
Gérard Souzay Judith Raskin |
Doris Yarick Regina Sarfaty |
Choeur et Orchestre du New York City Center Opera | Leopold Stokowski |
| 1967 Erato |
Eric Tappy Magali Schwartz |
Wally Staempfli Juliette Bise |
Ensemble vocal et instrumental de Lausanne | Michel Corboz |
| 1969 Teldec |
Lajos Kozma Rotraud Hansman |
Cathy Berberian Eiko Katanosaka |
Capella Antiqua Munich Concentus Musicus Vienne |
Nikolaus Harnoncourt |
| 1973 Archiv |
Nigel Rogers Emilia Petrescu |
Anna Reynolds James Bowman |
Choeur Monteverdi Hambourg Camerata Academica |
Jürgen Jürgens |
| 1981 Teldec |
Philippe Huttenlocher Rachel Yakar |
Trudeliese Schmidt Glenys Linos |
Ensemble Monteverdi de l’Opéra de Zürich | Nikolaus Harnoncourt |
| 1983 EMI |
Nigel Rogers Patrizia Kwella |
Emma Kirkby Jennifer Smith |
London Baroque London Cornett and Sackbut Ensemble |
Charles Medlam Nigel Rogers |
| 1985 Erato |
Gino Quilico Audrey Michael |
Carolyn Watkinson Colette Alliot-Lugaz |
Chapelle Royale Opéra de Lyon |
Michel Corboz |
| 1985 Archiv |
Anthony Rolfe Johnson Julianne Baird |
Lynne Dawson Anne Sophie von Otter |
Monteverdi Choir English Baroque |
John Eliot Gardiner |
| 1992 Decca |
John Mark Ainsley Catherine Bott |
Julia Gooding Christopher Robson |
New London Consort | Philip Pickett |
| 1993 Lyricord |
Jeffrey Thomas Dana Hanchard |
Jessica Tranzillo Jennifer Lane |
ARTEK | Gwendolyn Toth |
| 1995 Claves |
Paolo Coni Nuccia Focile |
Claudia Clarich Enrico Fancini |
Orchestra da Camera Lucchese | Herbert Handt (**) |
| 1995 HM (*) |
Laurence Dale Efrat Ben Nun |
Jennifer Larmore Bernarda Fink |
Concerto Vocale | René Jacobs |
| 1996 K617 |
Victor Torres Adriana Fernandez |
Gloria Bianditelli Maria Cristina Kiehr |
Studio da Musica Antiqua Ensemble Elyma |
Gabriel Garrido |
| 1998 Naxos |
Alessandro Carmignani Marinella Pennicchi |
Rosita Frisani Patrizia Vaccari |
Cappella Musicale de Bologne | Sergio Vartolo |
| 2004 Virgin |
Ian Bostridge Patricia Ciofo |
Nathalie Dessay Paul Agnew |
European Voices Le Concert d’Astrée Les Sacqueboutiers de Toulouse |
Emmanuelle Haïm |
| 2005 Dynamic |
Kobie van Rensburg Cyrille Gerstenhaber |
Estelle Kaïque Philippe Jaroussky |
La Grande Écurie et la Chambre du Roy | Jean-Claude Malgoire |
| 2006 Glossa |
Mirko Guadagnini Emanuela Galli |
Marina de Liso Josè Lo Monaco |
La Venexiana | Claudio Cavina |
| 2006 Centaur |
Franck Kelley Roberta Anderson |
Laurie Monahan Debora Rentz |
Aston Magna | Daniel Stepner |
| 2006 Brilliant |
William Matteuzzi Sylvia Pozzer |
Sara Mingardo Angela Bucci |
Sergio Vartolo | |
| 2007 Naïve |
Furio Zanasi Anna Simboli |
Sara Mingardo Monica Piccinini |
Concerto Italiano | Rinaldo Alessandrini |
|
*) BC : Berlin Classic ; HM : Harmonia Mundi.
**) Orchestration Respighi |
||||
Attention ! La présentation de l’enregistrement de Wenzinger pourrait nous faire croire que le rôle titre est tenu par le magnifique Wunderlich, mais il n’en est rien.
Il faudrait également ajouter l’enregistrement de Jeanette Sorrell (avec reconstitution de la scène finale de bacchanale !), malheureusement, en anglais.
Jusqu’à la parution de l’enregistrement d’Alessandrini, il était difficile de départager les différentes versions de cet opéra. Les plus réussies (Jacobs, Garrido, la Venexiana, Haïm) péchaient par un excès d’emphase et surchargeaient de lyrisme et de sonorités raffinées une oeuvre qui tient plus du madrigal que du grand opéra. On regrettait les deux ratés de Vartolo, alors qu’on lui doit un Retour d’Ulysse et un Couronnement de Poppée d’une rare justesse, des enregistrements de référence. Et l’on se tournait, finalement, faute de mieux, vers Harnoncourt.
Alessandrini a, ici, trouvé précisément les sonorités, la légèreté, le rythme justes de cette oeuvre charnière dans l’histoire de la musique. Même si nous ne possédons pas la documentation nécessaire pour retrouver exactement la manière dont avait été interprété cette oeuvre lors de sa création, la musique possède sa vérité propre, et Alessandrini l’a merveilleusement appréhendé. En outre, ses chanteurs sont les plus beaux de la discographie, distillant un remarquable, naturel et vivant recitar cantando, et Furio Zanasi nous rappelle parfois Nigel Rogers ou Eric Tappy.
Nous ne saurions toutefois pas passer sous silence deux enregistrements, celui de Jürgen Jürgens avec Nigel Rogers et le premier enregistrement de Corboz avec Erix Tappy dans le rôle d’Orphée. S’ils sont dépassés stylistiquement, s’ils appartiennent aux premières générations de « baroqueux » et pèchent par certaines inadéquations (choeurs trop fournis, mélanges d’instruments anciens et modernes), ils contiennent des pages infiniment précieuses, d’une beauté à couper le souffle, grâce en particulier à leurs Orfeo, Eric Tappy et Jürgen Jürgens. Ces deux chanteurs, se laissant porter littéralement par la musique, ont trouvé le ton juste et ne peuvent se faire oublier. Ces deux enregistrements sont parfois difficiles à trouver.
En DVD, nous continuons de préférer l’Orfeo dirigé par Savall pour la très belle réalisation scénique et l’atmosphère très chaleureuse qui s’en dégage.