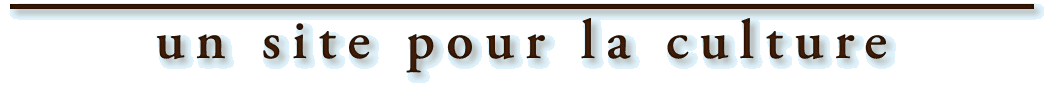La Vie est un Songe en ligne : Première journée • Seconde journée • Troisième journée
Traduction de Damas-Hinard, 1845
Scène I.
Une prison.
Entre CLAIRON.

L’hippogriffe, une créature mi-oiseau de proie, mi-cheval – d’après une enluminure conservée à la BNF.
CLAIRON. On m’a renfermé, pour ce que je sais, dans une tour enchantée. Que me fera-t-on pour ce que j’ignore, si pour ce que je sais l’on me tue ?… Se peut-il qu’un homme plein de vie, et qui mangerait si volontiers, en soit réduit à mourir de faim !… C’est au point que j’ai pitié de moi… Chacun dira : « je le crois bien, » et en effet cela est facile à croire ; car pour moi ce silence est en désaccord avec mon nom — de Clairon, et je ne- puis me taire… Ma seule compagnie en ce lieu, — je frémis de le dire, — ce sont les araignées et les rats : ne voilà-t-il pas de jolis moineaux !… Par suite de mes rêves de cette nuit, j’ai ma pauvre tête pleine de visions fantastiques, de trompettes, de ruses, de processions, de croix, de flagellants ; et de ceux-ci les uns montent, les autres descendent, et plusieurs se trouvent mal en voyant leurs compagnons couverts de sang… Pour moi, à vrai dire, si je me trouve mal, c’est de ne pas manger ; et de plus, il est assez dur de se voir en une prison où l’on n’a, le jour, pour tout régal que le philosophe Nicomède, et, la nuit, que le concile de Nicée… Si le silence est saint, j’aurai du moins pour moi, dans le nouveau calendrier, saint Secret, puisque je jeûne à son intention ; et, cependant, il faut avouer que j’ai bien mérité mon châtiment, puisque j’ai gardé le silence étant valet, ce qui est un horrible sacrilège.
Bruit de tambours et de clairons, et cris au dehors.
UN SOLDAT, du dehors. Voici la tour où il est enfermé. Enfoncez la porte et entrez.
CLAIRON. Vive Dieu ! c’est moi que l’on cherche, car on dit que je suis enfermé ici. Qu’est-ce donc qu’on me veut ?
UN SOLDAT, du dehors. Entrez ! entrez !
Entrent un grand nombre de soldats.
UN AUTRE SOLDAT. Il est ici.
CLAIRON. Il n’y est pas.
TOUS. Seigneur ?
CLAIRON. Ils sont ivres, je crois.
PREMIER SOLDAT. Vous êtes notre prince. Nous ne voulons pas de prince étranger ; nous ne voulons obéir qu’à notre seigneur légitime. Permettez-nous de baiser vos pieds.
TOUS. Vive notre grand prince !
CLAIRON. Vive Dieu ! c’est pour de bon… Ne serait-ce pas la coutume en ce pays de prendre chaque jour un homme, de l’élire prince, et puis de l’emprisonner ?… Il faut bien que cela soit, car je ne vois pas autre chose. Eh bien ! je vais jouer mon rôle.
TOUS. Donnez-nous vos pieds.
CLAIRON. Cela m’est impossible ; car j’en ai besoin pour mon usage personnel, et il ne serait pas convenable de voir un prince sans pieds.
DEUXIÈME SOLDAT. Tous nous l’avons dit à votre père lui-même : nous ne reconnaissons que vous seul pour notre prince, et nous ne voulons pas de celui de Moscovie.
CLAIRON. Vous avez donc manqué de respect à mon père ? Je vous reconnais là.
PREMIER SOLDAT. C’a été loyauté de notre part.
CLAIRON. Oui, vous êtes de braves gens, et je vous pardonne.
DEUXIÈME SOLDAT. Venez rétablir votre pouvoir. Vive Sigismond !
TOUS. Vive ! vive Sigismond !
CLAIRON, à part. Ils m’appellent Sigismond ? Ce n’est pas mauvais. Ou appelle ainsi tous les princes de contrebande.
Entre SIGISMOND.
SIGISMOND. Qui donc a prononcé le nom de Sigismond ?
CLAIRON, à part. Seulement il est triste d’être un prince affamé !
PREMIER SOLDAT. Qui est Sigismond ?
SIGISMOND.C’est moi.
DEUXIÈME SOLDAT, à Clairon. Comment donc, misérable imposteur, te faisais-tu passer pour Sigismond ?
CLAIRON. Je le nie ! Ce n’est pas moi qui me suis dit Sigismond, c’est vous qui m’avez ensigismondé ; et par conséquent la faute en est à vous, non à moi. .
PREMIER SOLDAT. Noble prince Sigismond, la bannière que vous voyez est la vôtre, et nous venons vous acclamer comme notre seigneur légitime. Votre père le grand roi Basilio, craignant que le ciel n’accomplisse une prédiction qui le menace de se voir vaincu et humilié par vous, prétend vous ôter le droit de lui succéder et le transmettre au prince Astolfe, duc de Moscovie. Il a dans ce but assemblé ses états. Mais le peuple, qui sait fort bien qu’il a un roi légitime, ne veut pas qu’un étranger le gouverne ; et c’est pourquoi, dédaignant noblement un horoscope funeste, il est venu vous chercher dans cette prison, vous délivrer, et vous offrir son aide pour que vous repreniez à un tyran votre couronne et votre sceptre. Venez donc : une armée nombreuse de bannis et de plébéiens assemblée dans ce désert vous attend et vous appelle. N’entendez-vous pas leurs cris et leurs acclamations ?
SOLDATS, du dehors. Vive, vive Sigismond !
SIGISMOND. Qu’est-ce donc, grand Dieu !… Vous voulez qu’une fois encore je rêve des grandeurs qui s’évanouiront le lendemain ! Vous voulez qu’une fois encore mes yeux aperçoivent je ne sais quelle vaine apparence de majesté et de pompe qui va disparaître au moindre souffle ! Vous voulez qu’une fois encore je m’expose à un pareil désenchantement, et que je coure ces dangers inséparables du pouvoir ! non, cela ne peut pas être, cela ne sera pas… Regardez-moi désormais comme un homme soumis à sa fortune ; et puisque je sais maintenant que la vie n’est qu’un rêve, disparaissez, vains fantômes, qui, pour m’abuser, avez pris une voix et un corps, et qui n’avez en réalité ni corps ni voix ! Je ne veux point d’une majesté fantastique, je ne veux point d’une pompe menteuse, je ne veux point de ces illusions qui tombent au premier souffle, — semblables à la fleur délicate de l’amandier, que le plus léger souffle emporte au loin, et qui laisse alors tristement dépouillées ces branches dont ses couleurs charmantes faisaient le gracieux ornement. — Je vous connais à présent, je vous connais, et je sais que vous abusez de même tout homme qui vient à s’endormir. Vos mensonges ne peuvent plus m’égarer, et je me tiens sur mes gardes, — sachant bien que la vie n’est qu’un songe.
DEUXIÈME SOLDAT. Si vous croyez que nous voulons vous tromper, tournez les yeux vers ces hautes montagnes, et voyez-les couvertes d’un peuple qui vous attend, prêt à vous obéir.
SIGISMOND. Déjà, l’autre fois, j’ai vu cela aussi distinctement que je le vois à cette heure, et cependant ce n’était qu’un songe.
DEUXIÈME SOLDAT. Toujours, noble seigneur, les grands événements sont annoncés à l’avance, et c’est pour cela sans doute que vous avez rêvé ce que vous voyez en ce moment.
SIGISMOND. Vous avez raison ; c’était sans doute l’annonce de ce qui devait être ; et d’ailleurs, puisque la vie est si courte, 6 mon âme, livrons- nous à un nouveau rêve. Mais que ce soit avec prudence, avec sagesse, et de manière à n’en sortir qu’au moment favorable. Le désenchantement sera moindre, dès que nous y serons préparés : car on se rit des inconvénients qu’on a prévus. C’est pourquoi, bien persuadés que même le pouvoir le plus réel n’est qu’un pouvoir emprunté, et doit revenir tôt ou tard à celui à qui il appartient, jetons-nous hardiment dans cette entreprise. — Mes vassaux, je vous suis reconnaissant de votre fidélité, et vous aurez en moi un homme dont la prudence et le courage vous délivreront du joug étranger. Que l’on sonne l’alarme et marchons ! je veux vous montrer au plus tôt ma valeur. Dès ce moment, je me soulève contre mon père, et je prétends que mon horoscope s’accomplisse en le mettant à mes pieds. (A part. ) Mais quoi ! si je m’éveille auparavant, pourquoi parler d’une chose qui ne sera point réalisée ?
TOUS. Vive, vive Sigismond !
Entre CLOTALDO.
CLOTALDO. D’où vient tout ce bruit ?
SIGISMOND. Clotaldo !
CLOTALDO. Seigneur ! (A part. ) Je redoute sa colère.
CLAIRON, à part. Je parie qu’il va le jeter du haut en bas de la montagne.
Il sort.
CLOTALDO. Je me prosterne devant vous, monseigneur, résigné à mourir.
SIGISMOND. Levez-vous ! — levez-vous, ô mon père ! Veuillez être mon guide, mon confident, mon conseil, vous qui, depuis ma naissance, m’avez élevé si fidèlement ! Embrasez-moi.
CLOTALDO. Que dites-vous ?
SIGISMOND. Que je rêve et que je veux faire le bien, car on ne perd jamais le prix du bien que l’on a fait, même en rêve.
CLOTALDO. Puisque vous vous êtes promis de bien faire, seigneur, je ne vous offenserai certainement pas en vous montrant que c’est là aussi mon intention… Vous voulez déclarer la guerre à votre père ? Je ne puis vous conseiller ni vous seconder contre mon roi. Me voilà à vos pieds, tuez-moi !
SIGISMOND. Insolent ! traître ! ingrat ! (A part.) Mais non, ô ciel ! calmons- nous ; car je ne sais pas encore si je suis éveillé ou si je rêve. (Haut.) Clotaldo, je vous sais gré de votre noble conduite. Allez servir le roi. Nous nous retrouverons sur le champ de bataille. (Aux soldats.) Vous, sonnez l’alarme.
CLOTALDO. Je vous baise les pieds mille fois.
Il sort.
SIGISMOND. Allons, Fortune, marchons vers le trône ; et si je dors, ne me réveille pas, et si je veille, ne me replonge pas dans le sommeil — Mais que tout cela soit une vérité ou un rêve, l’essentiel est de se bien conduire : si c’est la vérité, à cause de cela même ; et si c’est un rêve, afin de se faire des amis pour le moment du réveil.
Tous sortent au bruit du tambour.
Scène II.
La cour du palais.
Entrent LE ROI BASILIO et ASTOLFE.
LE ROI. Peut-on, Astolfe, arrêter un cheval emporté ? Peut-on retenir un fleuve qui coule avec rapidité vers la mer ? Peut-on maintenir un rocher qui va rouler du haut d’une montagne ?… Eh bien ! tout cela serait plus facile que d’apaiser le vulgaire une fois sorti de la mo-dération et du devoir. Rien ne le prouve mieux que ce peuple partagé en deux partis contraires, et qui fait retentir les échos des montagnes des noms répétés d’Astolfe et de Sigismond. Ces lieux affreux, rendus plus affreux encore par la présence de ce peuple en fureur, seront le théâtre de quelque sanglante tragédie dont nous menace la fortune.
ASTOLFE. Seigneur, que toute fête soit remise à un autre jour ; renvoyons à un moment plus favorable le bonheur que vous m’aviez promis. Si la Pologne, que j’espère plus tard gouverner, se refuse à mon autorité, c’est sans doute afin que je commence par mériter cet honneur. Donnez-moi un cheval, et je descends parmi les insurgés, aussi prompt que l’éclair qui précède le tonnerre.
Il sort.
LE ROI. Il n’y a aucun moyen d’empêcher ce que veulent les destins, et ce qu’ils ont annoncé doit s’accomplir. Il est impossible d’éviter ce qui doit être, et vouloir s’opposer à son malheur ne sert qu’à le hâter. Quelle affreuse loi ! quel sort funeste ! quelle déplorable disgrâce que de tomber dans le péril en voulant le fuir ! Et moi, hélas ! avec mes précautions, je me suis perdu et j’ai causé la ruine de mon pays !
Entre ESTRELLA.
ESTRELLA. Si par votre présence, noble seigneur, vous n’essayez d’arrêter le tumulte que causent dans la ville les deux partis qui la divisent, vous verrez bientôt tout votre royaume à feu et à sang. Déjà les maux qu’ils ont causés sont immenses, et l’on ne voit et n’entend partout que lamentables malheurs et tragédies horribles. Encore quelque temps, et tous les plus beaux monuments de ce royaume désolé ne pourront plus servir à un peuple détruit, que de tombeaux.
Entre CLOTALDO.
CLOTALDO. Grâce a Dieu ! j’arrive vivant à vos pieds.
LE ROI. C’est vous, Clotaldo ! Qu’est devenu Sigismond ?
CLOTALDO. Un peuple déchaîné et furieux a pénétré dans la tour et en a fuit sortir le prince, qui, se voyant libre, a annoncé fièrement que la prédiction des astres allait s’accomplir.
LE ROI. Qu’on me donne un cheval ! Je veux en personne réduire un fils ingrat ; je veux, en personne, défendre mon trône, et mon épée va réparer l’erreur de ma science.
Il sort.
ESTRELLA. Eh bien ! moi aussi, je marche au combat à vos côtés ; je prétends illustrer mon nom dans les batailles et rivaliser avec la déesse Pallas.
Elle sort, et l’on sonne l’alarme.
Clotaldo va pour sortir, mais entre ROSAURA, qui le retient.
ROSAURA. Bien que votre valeur murmure de ce retardement, écoutez-moi. — Vous savez que je suis venue pauvre et abandonnée en Pologne, et que j’ai trouvé auprès de vous protection et pitié. Vous m’avez commandé de vivre dans le palais sous ces vêtements, qui ne sont pas les miens, de ne pas laisser voir ma jalousie, et de me cacher du prince Astolfe. Il m’a vue, à la fin, et cependant, épris de la princesse, il doit, cette nuit, lui parler dans le jardin. Je m’en suis procuré la clef, vous pourrez y pénétrer ; et si votre courage vous le permet, il vous sera facile de venger mon honneur par la mort du perfide.
CLOTALDO. Il n’est que trop vrai, Rosaura ; dès que je vous ai vue, je ne sais. ; quel instinct m’a porté à faire pour vous tout ce qui était en mon pouvoir. Mon premier soin a été de vous engager à changer d’habits, afin qu’il fût moins facile au prince Astolfe de vous reconnaître, En même temps, je pensais aux moyens de rétablir voire honneur ; el cet honneur m’est si cher, que je ne craignais pas de penser à la mort du prince. Mais voyez le jeu du sort ! Tandis que je méditais sa mort, Sigismond a voulu me tuer moi-même ; sur quoi le prince est accouru, el sans s’occuper de son propre péril, il a pris ma défense avec une rare générosité. Dites-moi donc, comment pourrais-je à présent donner la mort à qui je dois la vie ? Comment me conduire, partagé entre vous deux ? Lequel des deux dois-je seconder ? A l’un j’ai donné la vie ; je l’ai reçue de l’autre. Si je suis engagé par ce que j’ai donné, je ne le suis pas moins par ce que j’ai reçu. Et c’est pourquoi, en de telles circonstances, mon affection ne sait à quel parti s’arrêter, el je me sens neutralisé par deux forces contraires.
ROSAURA. Pour un homme tel que vous, je n’ai pas besoin de vous le dire, autant il est noble de donner, autant il est indigne de recevoir. Ce principe posé, c’est à moi que vous devez de la reconnaissance, et non au prince Astolfe ; car à moi vous avez donné, et de lui vous avez reçu ; et tandis que moi, je vous ai fourni l’occasion de vous conduire noblement, lui, il est cause que vous avez commis un acte indigne de vous. Donc, puisque vous m’avez donné à moi ce que vous avez reçu de lui, vous avez à vous plaindre de lui et vous êtes mon obligé, et c’est pourquoi, dans cette situation, vous me devez votre reconnaissance et vous devez défendre mon honneur.
CLOTALDO. Il est noble de donner, mais la reconnaissance est le devoir de celui qui reçoit. Or, si, en donnant, je me suis montré généreux, je dois me montrer reconnaissant de ce que j’ai reçu. Laissez-moi donc mériter tout à la fois la réputation d’homme généreux et celle d’homme reconnaissant.
ROSAURA. De vous j’ai reçu la vie, et en me la donnant, vous m’avez dit vous-même qu’une vie déshonorée n’était point la vie. Donc, vous ne m’avez rien donné, puisque ce que vous m’avez donné n’était point la vie ; et si, comme vous en êtes convenu tout à l’heure, la générosité passe avant la reconnaissance, commencez par vous montrer généreux ; vous serez ensuite reconnaissant.
CLOTALDO. Eh bien ! je serai généreux avant tout. Je vous donne toute ma fortune, Rosaura ; retirez-vous dans un couvent. Par ce moyen, qui me semble heureusement trouvé, nous évitons un crime, et vous avez un asile sûr et paisible. Lorsque le royaume est déjà si divisé, et si malheureux par ses divisions, un homme noble ne doit pas les augmenter ; et en vous proposant ce parti, en même temps que je demeure fidèle à mon roi, je me montre généreux envers vous et reconnaissant envers le prince. Décidez-vous donc, je vous prie, à l’accepter ; car je ne ferais pas plus pour vous, vive Dieu ! alors même que je serais votre père.
ROSAURA. Quand bien même vous seriez mon père, j’aurais peine à souffrir cette injure ; et puisque vous n’êtes pas mon père, je ne la souffrirai pas.
CLOTALDO. Que comptez-vous donc faire ?
ROSAURA. Tuer le duc.
CLOTALDO. Eh quoi ! une femme qui ne connaît point son père aurait tant de courage ?
ROSAURA. Certainement
CLOTALDO. Qui peut vous l’inspirer ?
ROSAURA. Le soin de ma réputation.
CLOTALDO. Songez donc que bientôt…
ROSAURA. Mon honneur brave tout.
CLOTALDO. Le prince Astolphe sera votre roi et le mari d’Estrella.
ROSAURA. Vive Dieu ! cela ne sera pas.
CLOTALDO. Vous ne pourrez pas l’empêcher.
ROSAURA. Peut-être !
CLOTALDO. Renoncez à ces projets.
ROSAURA.. Jamais !
CLOTALDO. Vous succomberez.
ROSAURA. Cela est possible.
CLOTALDO. Et vous risquez de vous y perdre.
ROSAURA. Je le crois comme vous.
CLOTALDO. Que cherchez-vous donc ?
ROSAURA. Ma mort.
CLOTALDO. C’est dépit.
ROSAURA. C’est honneur.
CLOTALDO. C’est folie.
ROSAURA. C’est valeur.
CLOTALDO. C’est colère.
ROSAURA. C’est fureur.
CLOTALDO. Comment ! votre passion ne peut rien entendre ?
ROSAURA. Non.
CLOTALDO. Qui vous secondera ?
ROSAURA. Moi.
CLOTALDO. Rien ne peut vous détourner ?
ROSAURA. Rien.
CLOTALDO. Voyons donc s’il n’y aurait pas d’autre moyen…
ROSAURA. C’est le seul moyen de me perdre.
Elle sort.
CLOTALDO. Eh bien ! si tu veux absolument ta perte, — attends-moi, ma fille ; nous nous perdrons ensemble.
Il sort.
Scène III.
Un lieu retiré dans la campagne.
On bat le tambour, des Soldats défilent dans le lointain. Entrent SIGISMOND, couvert de peaux de bête, et CLAIRON.
SIGISMOND. Si Rome triomphante, comme à son premier âge, me voyait en ce jour, comme elle saisirait avec joie l’occasion de mettre à la tête de ses armées une bête sauvage dont le courage irrésistible aurait bientôt conquis le monde !… Mais ne laissons pas s’élever si haut nos pensées orgueilleuses, et ne désirons pas tant la gloire humaine, si nous devons regretter de l’avoir obtenue quand elle se sera évanouie. Moins cette gloire sera grande, moins nous la regretterons, quand nous l’aurons perdue.
On entend le bruit du clairon.
CLAIRON. Sur un cheval rapide et fougueux, qui, à lui seul, représente les quatre éléments, — car son corps, c’est la terre ; son âme, c’est le feu ; son écume, c’est l’eau, et son souffle, c’est l’air ; — donc, sur ce monstre composé, qui a la forme d’un cheval, et qui vole plutôt qu’il ne court, arrive vers nous une femme guerrière.
SIGISMOND. Elle a un éclat qui m’éblouit.
CLAIRON. Vive Dieu ! c’est Rosaura.
Il sort.
SIGISMOND. C’est le ciel qui me l’envoie.
Entre ROSAURA, portant une épée et une dague.
ROSAURA. Généreux Sigismond, de qui la majesté héroïque sort enfin des ténèbres où elle était ensevelie, et qui, semblable à cet astre dont les rayons brillants éclairent au loin les monts et les mers, vous levez enfin sur la Pologne, dont vous êtes le bienfaisant soleil ; je viens vous prier d’accorder votre protection à une femme malheu-reuse, qui, par cela même, a, pour l’obtenir, deux titres, dont un seul suffit pour lui mériter l’assistance de tout homme de cœur. Voilà trois fois que je me présente à vos yeux, et cependant vous ne pouvez pas savoir qui je suis, car chaque fois, je me suis présentée à vous sous un costume différent. La première, vous avez pu penser que j’étais un homme, dans la prison où vous étiez enfermé, et où j’oubliai mes chagrins en voyant votre malheur ; la seconde, vous m’avez parlé comme à une femme, à cette époque où votre grandeur ne fut qu’une ombre et passa comme un rêve ; enfin, vous me voyez aujourd’hui, pour la troisième fois, dans un équipage qui participe de celui des deux sexes, car je porte les habits d’une femme et les armes d’un homme… Et pour que votre pitié m’accorde une protection plus complète et plus efficace, veuillez entendre, je vous prie, le récit de mes tragiques infortunes. — Je suis née, à la cour de Moscovie, d’une mère noble, qui devait être fort belle, car elle fut bien malheureuse. Elle attira l’attention d’un perfide que je ne nomme point, parce qu’il m’est inconnu. Ma mère, persuadée par ses propos galants, et croyant à la parole qu’il lui donnait de l’épouser, eut la faiblesse de céder, faiblesse qu’elle pleure encore aujourd’hui, car il ne tarda pas à l’abandonner, en lui laissant son épée que je porte à mon côté, et qui ne tardera pas à sortir du fourreau… 0 mariage !… ô mystère profond, impénétrable !… Je naquis, et je fus la vivante image de ma mère, non pas sans doute pour la beauté, mais pour l’infortune et le malheur. 11 est inutile, après cela, que je vous raconte avec détail ma disgrâce. Tout ce que je puis vous dire, c’est que celui qui m’a enlevé l’honneur et qui en triomphe aujourd’hui avec orgueil, c’est le prince Astolfe… Hélas ! en prononçant ce nom, je sens mon cœur se soulever de colère et d’indignation… Oui, c’est lui qui, oubliant et ma confiance et les joies qu’il avait trouvées près de moi (car lorsqu’on n’aime plus, on perd jusqu’à la mémoire de l’amour), c’est lui qui m’a délaissée, pour venir en Pologne, où il prétend à l’empire et à la main d’Estrella… Trompée, offensée, jouée ainsi par un homme, je demeurai triste, désolée, morte et livrée, pour ainsi dire, à toute la confusion de l’enfer. Je ne parlais à personne de ce qui m’était arrivé ; mais mon silence parla plus haut que je n’aurais voulu ; et ce fut au point qu’un jour ma mère, me prenant à l’écart, crut devoir me parler seule à seule. Je ne vous dirai point que je lui confiai mon aventure : non, mon secret sortit de mon cœur impétueusement et à la hâte, comme si je l’eusse délivré de la prison où je le renfermais. Je vous avouerai même que je n’eus pas trop de honte avec elle ; je savais qu’elle avait passé par une semblable disgrâce, et cela m’encourageait à lui conter la mienne. Bref, ma mère m’écouta avec une indulgente bonté, et me consola par la confidence de ses propres chagrins ; mais elle ne voulut pas qu’à son exemple, j’attendisse du temps la réparation à laquelle j’avais droit, pensant que, comme elle, je l’aurais attendue vainement ; elle me conseilla de chercher par moi-même à rétablir mon honneur, en venant à la poursuite de celui qui m’avait abandonnée. Donc, après m’avoir fait revêtir des habits d’homme, lesquels lui semblaient mieux convenir à mon entreprise, elle dépendit de la muraille une vieille épée… (elle tire son épée) c’est cette épée dont je vous parlais tout à l’heure et qu’il est temps de sortir du fourreau… elle me la donna en me disant : «Rends-toi en Pologne, et fais en sorte que les seigneurs les plus nobles te voient cette épée ; quelqu’un d’eux, en la voyant, t’accordera sa bienveillance et sa protection. » Je vins donc en Pologne ; et je n’ai pas besoin de vous dire qu’à peine y fus-je arrivée, mon cheval, qui avait pris le mors aux dents, m’emporta jusque près de l’endroit où vous étiez enfermé et où vous fûtes si étonné de me voir. Mais ce que vous ne savez pas, c’est que Clotaldo, qui d’abord s’était passionné pour ma cause, qui avait demandé ma grâce au roi, et qui m’avait placée comme dame auprès d’Estrella pour qu’il me fût plus facile d’empêcher son mariage, — Clotaldo, persuadé maintenant qu’il importe au bien du royaume qu’Astolfe épouse la princesse, me conseille de renoncer à mes prétentions, ce qui est contre mon honneur. Pour moi, noble et vaillant Sigismond, joyeuse de ce qu’enfin sorti de cette horrible prison où s’écoulait tristement votre existence, vous avez pris les armes contre un père tyrannique et cruel, je viens vous offrir mon concours ; je viens, nouvelle Pallas, offrir à un nouveau Mars mon bras et mon épée. Marchons donc, noble et vaillant héros, marchons sans retard ; car il nous importe à tous deux d’empêcher ce mariage : à moi, pour que le prince n’épouse pas une autre femme ; à vous, parce que la réunion de leurs royaumes et de leurs forces vous rendrait plus difficile la victoire… Femme, je viens vous prier de m’aider à recouvrer mon honneur ; homme, je viens vous exciter à recouvrer votre couronne… femme, je viens attendrir un cœur qui ne peut pas être insensible à ma prière ; homme, je viens vous servir de mon courage et de mes armes. Et c’est pourquoi, pensez-y bien, si vous veniez à m’inspirer de l’amour comme à une femme, pour défendre mon honneur, comme un homme, je vous donnerais la mort ; car si, pour la faiblesse et la plainte, je suis une femme, je suis un homme pour venger mon honneur.
SIGISMOND, à part. O ciel ! si tout cela n’est qu’un rêve, donne-moi le pouvoir d’en conserver le souvenir, car j’aurais peine à me rappeler tout ce que j’ai entendu dans ce rêve !… Que Dieu me soit en aide ! Comment sortir de toutes ces difficultés qui m’assiègent, ou comment en distraire ma pensée ?… Quelle peine ! quel doute ! Si cette grandeur où je me suis vu un moment n’a été qu’un rêve, comment se fait-il que cette femme m’en donne des renseignements si précis ? C’a donc été la vérité et non pas un rêve… Et si cela est la vérité, — autre embarras non moins grand, — comment donc ma vie l’appelle-t-elle un rêve ? Est-ce donc à dire que la gloire de ce monde ressemble tant à un rêve, que la plus véritable n’est qu’un mensonge, et que la plus fausse a quelque chose de vrai ? Y a-t-il de l’une à l’autre si peu de différence que l’on puisse se demander si ce que l’on voit est vérité ou mensonge ? sont-elles si semblables que l’on puisse hésiter entre les deux ? Eh bien ! s’il en est ainsi, et si la grandeur, si le pouvoir et la majesté doivent s’évanouir comme des ombres, sachons mettre à profit le moment qui nous est donné, et jouissons de ce rêve… Rosaura est en mon pouvoir, mon âme adore sa beauté ; profitons de l’occasion ; que mon amour n’écoute que les désirs qui le transportent. Ceci est un rêve ; eh bien ! rêvons du bonheur, le malheur viendra assez tôt… Mais quoi ! mes paroles mêmes m’entraînent dans des idées bien différentes !… Si tout cela n’est qu’un rêve, si tout cela n’est que vaine gloire, quel homme, pour la vaine gloire de ce monde, perdra ainsi follement une gloire divine ? Est-ce que le bonheur passé n’est pas un rêve ? est-ce qu’en se rappelant les plaisirs qu’on a goûtés, on ne finit pas toujours par se dire à soi-même : j’ai rêvé tout cela ?… Eh bien ! puisque voilà mes illusions tombées, et puisque je suis désormais convaincu que le désir n’est chez l’homme qu’une flamme brillante qui convertit en cendres tout ce qu’elle a touché, — poussière légère qui se dissipe au moindre vent, — ne pensons donc qu’à ce qui est éternel, et à cette gloire durable où le bonheur et la grandeur n’ont ni fin, ni repos, ni sommeil… Rosaura a souffert dans son honneur, il est de mon devoir de le lui rendre et non pas de le lui ôter ; et, vive Dieu ! je veux le recouvrer plutôt encore que ma couronne… Fuyons une occasion pour moi si dangereuse. (Aux soldats.) Sonnez l’alarme. (A part.) Il faut que je livre bataille avant que le soleil éteigne ses rayons de flammes dans les eaux de l’Océan.
ROSAURA. Eh quoi ! seigneur, vous vous éloignez, et ma douleur n’a pas encore obtenu de vous une seule parole ! Pourquoi ne laissez- vous pas tomber sur moi un seul regard ? pourquoi détournez-vous le visage ?
SIGISMOND. Rosaura, le devoir m’ordonne de vous traiter ainsi, afin que je puisse plus tard vous montrer toute ma compassion. Ma voix ne vous répond pas pour que mon honneur vous réponde ; je ne vous parle pas pour que mes actions vous parlent en ma place, et je ne vous regarde pas, parce qu’on est obligé de ne point s’occuper de votre beauté lorsqu’on veut s’occuper de votre honneur.
Il sort.
ROSAURA. Que signifie cette énigme, ô ciel ? N’avais-je pas assez de mes chagrins ? et devait-il y ajouter avec ses paroles équivoques ?
Entre CLAIRON.
CLAIRON. Ah ! madame, je vous retrouve enfin !.
ROSAURA. Eh bien ! d’où viens-tu, Clairon ?
CLAIRON. J’ai été enfermé dans une tour, où ma mort a été sur le tapis ; on l’a jouée aux cartes, et j’ai été assez heureux pour avoir quinola. Je puis, grâce à cela, vous apprendre une nouvelle.
ROSAURA. Laquelle ?
CLAIRON. Je sais le secret de votre naissance ; et, en effet, le seigneur Clotaldo… (On entend un bruit de tambours.) Mais quel est ce bruit ?
ROSAURA. Qu’est-ce que cela peut être ?
CLAIRON. Une armée sort de la ville pour combattre celle du fier SIGISMOND. ROSAURA. Pourquoi ne suis-je pas à ses côtés ? Ne serait-ce pas une indigne lâcheté ? Marchons, et ne donnons pas au monde un scandale de plus !…
Elle sort.
VOIX, du dehors. Vive notre roi !
D’AUTRES VOIX. Vive notre liberté !
CLAIRON. Oui, vive le roi et la liberté en même temps ! et qu’ils vivent contents tous deux ! Pour moi, quelque chose qui arrive, j’ai résolu de ne pas m’en affliger ; et me mettant à l’écart au milieu de tout ce tapage, je veux aujourd’hui, comme Néron, nie moquer de tout et ne prendre nul souci… Si fait, je me soucie encore d’une chose, c’est de moi ; et, caché ici, je veux voir toute la fête ; l’endroit est favorable, la mort ne viendra pas me chercher derrière ces rochers ; je fais la figue à la mort.
On entend le bruit des tambours, le cliquetis des armes, et entrent LE ROI, CLOTALDO et ASTOLFE, fuyant.
LE ROI. Fut-il jamais un roi plus malheureux ? fut-il jamais un père aussi persécuté ?
CLOTALDO. Votre armée, de toutes parts vaincue, fuit au loin en désordre.
ASTOLFE. Et les traîtres sont maîtres du champ de bataille.
LE ROI. Dans les luttes de ce genre, ce sont les vainqueurs qui ont le droit pour eux, et les traîtres, ce sont les vaincus. Fuyons donc, Clotaldo, fuyons le traitement cruel que nous réserve un fils inhumain.
On entend une décharge d’armes a feu, Clairon tombe blessé.
CLAIRON.. Que le ciel me soit en aide !
ASTOLFE. Quel est ce malheureux soldat qui vient de tomber tout sanglant à nos pieds ?
CLAIRON. Je suis un pauvre malheureux qui, pour avoir voulu me préserver de la mort, suis allé la chercher ; je la fuyais et elle m’a atteint, car il n’y a pas d’endroit où elle ne pénètre ; d’où il se peut conclure que plus on veut éviter ses coups, plus on s’expose à les recevoir. Aussi, retournez, retournez au combat ; on est plus en sûreté au milieu du feu et des armes que derrière la plus haute montagne, puisque le destin est si puissant et si irrésistible qu’il se fait partout un chemin. C’est pourquoi, vainement vous espérez par la fuite vous soustraire à la mort. Songez— y bien, vous mourrez si Dieu a décidé que vous devez mourir.
Il tombe hors de la scène.
LE ROI. Songez-y bien, vous mourrez si Dieu a décidé que vous devez mourir !… Hélas ! ô ciel ! comme il établit bien l’ignorance et la faiblesse de l’homme, ce cadavre qui parle ainsi par la bouche d’une blessure dont le sang qui s’en échappe, comme un langage plein d’éloquence, nous enseigne si bien que toutes les dispositions de l’homme sont impuissantes contre une force et une volonté supérieure. En effet, moi qui voulais épargner d’affreux désastres à mon pays, ne t’ai-je pas moi-même remis aux mains de ceux dont je le voulais délivrer ?
CLOTALDO. Bien que la destinée connaisse tous les chemins, seigneur, et qu’elle trouve derrière les plus épais rochers celui qu’elle cherche, il n’est pas chrétien de dire qu’on ne peut pas se préserver de sa rigueur. On le peut, croyez-moi, et l’homme sage triomphe souvent de la destinée. Si donc vous n’avez pas ici toute la sécurité nécessaire, faites tout ce qu’il faut pour vous sauver.
ASTOLFE. Sire, Clotaldo vous parle tout à la fois avec la prudence de l’âge mûr et avec la résolution de la jeunesse. Dans le bois épais qui couvre cette partie de la montagne, est un cheval plus rapide que le vent ; montez-le et fuyez ; moi, pendant ce temps, je protégerai votre fuite.
LE ROI. Si Dieu a décidé que je devais mourir aujourd’hui, et si la mort me cherche, je veux l’attendre ici et la voir face à face.
On sonne l’alarme, et entre SIGISMOND, à la tête de ses troupes.
UN SOLDAT. C’est dans les détours de la montagne et parmi les hautes bruyères que le roi s’est caché.
SIGISMOND. Suivez-le, et fouillez le bois avec soin, en regardant tous les arbres.
CLOTALDO. Fuyez, seigneur !
LE ROI.. Pourquoi ?
ASTOLFE. Quelle est votre intention ?
LE ROI. Laissez-moi, Astolfe.
CLOTALDO. Que voulez-vous ?
LE ROI. Je veux recourir au seul moyen de salut qui me reste. (II s’avance vers Sigismond et s’agenouille. ) Me voilà, prince, à vos pieds, que je couvre de mes cheveux blancs. Prenez ma couronne, prenez mon rang et mes titres, traitez-moi en captif ; qu’enfin, par ma disgrâce, la prédiction du destin et la volonté du ciel s’accomplisse.
SIGISMOND. Nobles hommes de Pologne, qui voyez avec étonnement ces événements merveilleux, faites silence, écoutez votre prince : — Ce que Dieu a déterminé dans ses conseils, ce qu’il a écrit de son doigt sur les tables azurées du ciel, ce qu’il a annoncé dans ce livre magnifique au moyen des astres et des étoiles qui en sont les lettres d’or, — ne ment et ne trompe jamais ; celui qui ment, celui qui trompe, c’est celui qui les étudie dans de mauvais desseins et qui prétend les expliquer. Mon père, ici présent, par crainte de mon mauvais naturel, a fait de moi, en quelque sorte, une bête sauvage ; quand bien même, grâce à la noblesse d’un sang généreux, je serais né modeste et docile, une pareille éducation aurait suffi à me donner des mœurs féroces ; n’était-ce pas là un singulier moyen de me rendre doux et humain ?… Si l’on disait à un homme : «Une bête féroce doit te donner la mort, » ne serait-il pas insensé d’en réveiller une qu’il trouverait endormie ? Si l’on disait à un homme : « Cette épée que tu portes à ton côté doit être la cause de ta mort, » ne serait-il pas plaisant qu’il espérât se sauver en la tirant du fourreau et en la tournant contre son sein ? Si l’on disait à un homme : « Tu dois périr et demeurer enseveli sous les flots, » comprendriez-vous que cet homme se lançât à la mer, alors qu’en furie elle élève jusqu’au ciel, les unes sur les autres, les montagnes de ses eaux courroucées ?… La même chose lui est arrivée qu’à l’homme qui, menacé d’une bête féroce, la réveille ; et à l’homme qui, craignant une épée, la tire contre lui-même ; et à l’homme qui, devant périr dans les flots, se lance à la mer au milieu de la tempête… Et quand bien même,—écoutez-moi, je vous prie !—quand bien même mon naturel eût été une bête féroce endormie, ma fureur une épée – sans tranchant, et ma cruauté un temps calme et tranquille, ce n’est point par l’injustice que l’on triomphe de la fortune ; au contraire, par l’injustice, on ne fait que l’irriter ; et pour la vaincre, il faut s’armer de sagesse et de modération. Rappelez-vous aussi qu’il n’est pas possible de se mettre à l’abri du malheur qui doit venir ; il faut attendre qu’il arrive, et alors, agir suivant les conseils de la prudence… Donc, qu’il vous serve de leçon ce spectacle étrange, prodigieux, horrible, qui frappe vos yeux en ce moment ; car qu’y a-t-il de plus étrange, de plus prodigieux, de plus horrible, que de voir abattu à mes pieds mon père et mon roi ?… Le ciel avait prononcé la sentence, il a voulu s’y soustraire, il ne l’a point pu ; le pourrai-je, moi qui suis plus jeune, moi qui lui suis, à un si haut degré, inférieur en science et en mérite ? (Au roi.) Levez-vous, seigneur, donnez-moi votre main ; vous devez être convaincu maintenant que vous n’avez pas interprété comme il fallait la volonté du ciel… Pour moi, je m’humilie devant vous, et, sans essayer de me défendre, j’attends votre vengeance.
LE ROI. Mon fils, une conduite si généreuse vous donne à mes yeux une nouvelle existence, et vous êtes désormais l’enfant de mon cœur. A vous, mon fils, le titre que je portais, à vous mon sceptre et ma couronne ; vos beaux faits vous établissent roi.
TOUS. Vive, vive Sigismond 1
SIGISMOND. Puisqu’il m’est permis aujourd’hui de songer à des victoires, il en est une que je dois chercher avant tout : c’est celle que je remporterai sur moi-même. — Astolfe, donnez sans retard la main à Rosaura ; vous savez que cette réparation est due à son honneur, et je l’attends de vous.
ASTOLFE. Seigneur, j’ai contracté, je l’avoue, des obligations à son égard ; considérez, cependant, qu’elle-même ignore qui elle est, et qu’il serait indigne de moi d’épouser une femme qui…
CLOTALDO. Arrêtez, n’achevez pas… Rosaura est aussi noble que vous, Astolfe, et mon épée le soutiendra dans le champ. Elle est ma fille : c’est tout dire.
ASTOLFE. Que dites-vous ?
CLOTALDO. J’attendais, pour découvrir ce secret, que je l’eusse vue honorablement établie. Je ne puis entrer en ce moment dans de plus longs détails ; mais enfin, elle est ma fille.
ASTOLFE. Puisqu’il en est ainsi, je ne me refuse plus à tenir ma parole.
SIGISMOND. Maintenant, pour qu’Estrella ne regrette pas tant la perte d’un si noble prince, je veux lui donner de ma main un mari qui ne le cède en rien à Astolfe, soit par la fortune soit par le mérite. (A Estrella.) Donnez-moi la main.
ESTRELLA. Je ne m’attendais pas à tant de bonheur.
SIGISMOND. Quant à Clotaldo, qui a servi mon père si fidèlement, j’espère l’avoir toujours pour ami, et je lui accorde d’avance toutes les grâces qu’il peut souhaiter.
UN DES PERSONNAGES. Si vous récompensez ainsi un homme qui ne vous a point servi, — à moi qui ai causé le soulèvement du royaume et qui vous ai tiré de prison, — que me donnerez-vous ?
SIGISMOND. La prison ; et afin que tu n’en sortes qu’à ta mort, je t’y ferai soigneusement garder. Une fois la trahison accomplie, on n’a plus besoin du traître.
LE ROI. Nous sommes tous dans l’admiration.
ASTOLFE. Quel changement s’est opéré en lui !
ROSAURA. Quelle sagesse et quelle prudence !
SIGISMOND. Pourquoi donc montrez-vous cet étonnement ?… Puisque c’est un songe qui m’a réformé, je crains de me réveiller et de me voir une seconde fois dans ma triste prison. Autrement, je ne me plaindrais pas du rêve que j’ai fait ; car j’ai appris par là que tout bonheur en ce monde passe comme un songe, et je veux profiter du mien pendant qu’il en est temps… (Au public.) En vous demandant pour nos fautes l’indulgence et le pardon que l’on doit attendre des nobles cœurs.