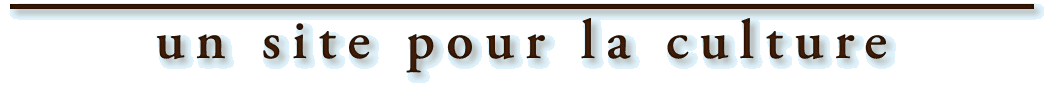L’Iliade et l’Odyssée dans la traduction de Jean-Baptiste Dugas-Montbel
L’Iliade : Chant 1 • Chant 2 • Chant 3 • Chant 4 • Chant 5 • Chant 6 • Chant 7 • Chant 8 • Chant 9 • Chant 10 • Chant 11 • Chant 12 • Chant 13 • Chant 14 • Chant 15 • Chant 16 • Chant 17 • Chant 18 • Chant 19 • Chant 20 • Chant 21 • Chant 22 • Chant 23 • Chant 24
L’Odyssée : Chant 1 • Chant 2 • Chant 3 • Chant 4 • Chant 5 • Chant 6 • Chant 7 • Chant 8 • Chant 9 • Chant 10 • Chant 11 • Chant 12 • Chant 13 • Chant 14 • Chant 15 • Chant 16 • Chant 17 • Chant 18 • Chant 19 • Chant 20 • Chant 21 • Chant 22 • Chant 23 • Chant 24
Les Libations.

Ulysse et ses compagnons, mosaïque du musée du Bardo à Tunis
Cependant Hermès Cyllénien rassemble les âmes des prétendants ; il tient en ses mains une belle baguette d’or, dont il peut à son gré fermer les yeux des hommes, ou les arracher au sommeil : il s’en sert pour conduire les âmes ; celles-ci le suivent avec un léger frémissement. Ainsi dans l’intérieur d’un antre obscur des chauves-souris s’envolent en frémissant, lorsque l’une vient à se détacher du haut d’un rocher, car elles se tiennent toutes ensemble ; de même ces âmes laissent échapper un aigre murmure, et le bienveillant Hermès les précède à travers les ténébreux sentiers. Ils franchissent les courants de l’Océan, le rocher de Leucade, les portes du Soleil, et la demeure des Songes ; bientôt elles arrivent à la prairie asphodèle, où résident les âmes qui sont les ombres des morts.
Ils trouvèrent l’âme d’Achille, fils de Pélée, celle de Patrocle, celle de l’irréprochable Antilochos, et celle d’Ajax, le plus fort et le plus beau des Grecs après le noble fils de Pélée. Tous étaient rassemblés autour de ce prince. Près d’eux en ce moment arrivait l’âme d’Agamemnon, fils d’Atrée, accablée de tristesse ; elle était accompagnée de tous ceux qui, dans le palais d’Égisthe, subirent le trépas avec lui. La première, l’âme du fils de Pélée, lui tient ce discours :
« Atride, nous pensions que de tous les héros tu devais être toujours le plus cher au formidable Zeus, parce que tu commandais à de nombreux et vaillants guerriers dans les champs troyens, où les Grecs ont éprouvé tant de maux. Cependant toi, l’un des premiers, tu péris victime de cette destinée funeste que ne peut éviter nul mortel qui vient au monde. Ah ! plutôt, pour jouir de l’honneur qui te fit notre chef, que n’as-tu subi la mort parmi le peuple des Troyens ! tous les Grecs t’auraient construit une tombe, et c’eût été dans l’avenir une grande gloire pour ton fils ; maintenant ta destinée est de périr d’une mort misérable. »
L’âme d’Agamemnon répondit en ces mots :
« Heureux fils de Pélée, Achille, semblable aux dieux, toi du moins tu succombas devant Ilion loin d’Argos ; autour de toi tombèrent en foule les nobles fils des Grecs et des Troyens combattant pour ton cadavre ; tandis qu’occupant un grand espace tu gisais dans un tourbillon de poussière, ayant oublié ton adresse à conduire un char. Nous combattîmes durant tout le jour ; sans doute nous n’eussions pas cessé le combat, si Zeus ne l’eût arrêté par une horrible tempête. Alors loin de la guerre nous te portâmes dans un navire, nous te déposâmes sur un lit funèbre, et nous lavâmes ton beau corps avec de l’eau tiède et de l’huile ; près de toi les enfants de Danaos versaient d’abondantes larmes, et coupaient leur chevelure. Alors ta mère, en apprenant cette nouvelle, arrive du sein des flots avec les déesses marines. Sur la mer retentit un bruit terrible, la crainte s’empare de tous les Achéens ; alors s’élançant, ils allaient monter sur leurs larges vaisseaux, si dans ce moment un héros qui savait beaucoup de choses anciennes ne les eût retenus : Nestor, dont avait déjà brillé le sage conseil ; plein de bienveillance pour les Grecs, il élève la voix, et leur dit :
« Arrêtez, Argiens, ne fuyez point, fils des Grecs ; c’est sa mère qui vient du sein des flots, avec les déesses marines, peur rendre les derniers honneurs à son fils. »
« À ces mots, les valeureux Grecs suspendent leur fuite ; autour de toi, les filles du vieillard marin gémissent avec amertume, et te couvrent de vêtements immortels. Les neuf Muses tour à tour de leur voix mélodieuse redisent un chant plaintif ; on ne voyait aucun des Argiens qui ne versât des larmes. Ainsi les excitait une Muse mélodieuse. Durant dix-sept nuits et pendant autant de jours nous pleurions tous, dieux immortels et faibles humains ; lorsque vint la dix-huitième journée, nous dressâmes un bûcher, et tout autour nous immolâmes un grand nombre de grasses brebis et les bœufs aux cornes recourbées. Ainsi ton corps fut consumé dans ses vêtements divins, dans une grande abondance de parfums et de miel plein de douceur ; plusieurs héros grecs, cavaliers et fantassins, portèrent leurs armures en faisant le tour du bûcher ; une grande clameur retentit. Le lendemain, lorsque la flamme d’Héphaïstos t’eut consumé, nous recueillîmes tes ossements, Achille, dans un vin pur, et dans le parfum ; ta mère nous fit présent d’une urne d’or, qu’elle disait être un don de Dionysos et le travail de l’illustre Héphaïstos. C’est dans cette urne que reposent tes os, noble Achille, confondus avec ceux de Patrocle, fils de Ménoetios ; à part sont les os d’Antilochos, celui de tes compagnons que tu chérissais le plus après la mort de Patrocle. Alors, pour couvrir ces restes, la vaillante armée des Grecs t’élève un grand tombeau sur le rivage qui domine le vaste Hellespont, pour être un monument visible au loin du milieu des mers, soit aux hommes de nos jours, soit à ceux qui naîtront dans l’avenir. Ta mère alors, après avoir demandé le consentement des dieux, dépose dans la lice des prix magnifiques destinés aux plus illustres des Grecs. Tu vis sans doute les funérailles d’un grand nombre de héros, lorsqu’à la mort de quelque roi les jeunes guerriers s’entourent d’une ceinture pour disputer le prix des jeux ; et pourtant ton âme aurait été frappée d’admiration en voyant les prix superbes qu’en ton honneur avait déposés une déesse, Thétis aux pieds d’argent ; car toujours tu fus cher aux immortels. Ainsi même après ta mort ton nom ne périra pas, ta gloire sera toujours éclatante parmi tous les hommes, Achille ; tandis que moi, quel fruit me reviendra-t-il d’avoir terminé cette guerre ? À mon retour Zeus m’a fait périr d’un trépas funeste par la main d’Égisthe et d’une infâme épouse. »
C’est ainsi que ces héros s’entretenaient ensemble. En ce moment arrive auprès d’eux le messager Hermès, conduisant les âmes des prétendants immolés par Ulysse ; à cette vue, les deux héros s’avancent avec étonnement. L’âme d’Agamemnon reconnaît le fils de Mélanée, l’illustre Amphimédon ; car il fut autrefois son hôte, et dans Ithaque il habita le palais de ce prince. Aussitôt l’âme d’Atride lui parle en ces mots :
« Amphimédon, qui donc, infortunés, vous à plongés dans la terre ténébreuse, vous héros d’élite et tous du même âge ? Nul homme désirant faire un choix ne réunirait dans une ville tant d’hommes vaillants. Poséidon vous a-t-il perdus dans vos navires, en excitant les vents impétueux et les vagues immenses ? Sur le continent des hommes ennemis vous ont-ils immolés, quand vous ravagiez leurs bœufs et leurs riches troupeaux de brebis ? ou serait-ce en combattant pour votre ville et pour vos femmes ? Répondez à mes questions ; je me glorifie d’avoir été votre hôte. Ne vous souvient-il plus du jour où j’arrivai dans votre palais avec le divin Ménélas, pour exciter Ulysse à nous suivre sur de larges navires devant Ilion ? Depuis un mois tout entier nous avions franchi la vaste mer, et c’est à peine alors que nous persuadâmes Ulysse, le destructeur des cités. »
« Noble Atride, roi des hommes, lui répondit Amphimédon, oui, je me ressouviens de toutes ces choses, comme vous les rappelez ; à mon tour je vous raconterai tout avec vérité, touchant le terrible événement de notre mort, tel qu’il est arrivé. Nous désirions épouser la femme d’Ulysse, absent depuis longtemps ; mais, sans repousser ce mariage funeste, et sans refuser de l’accomplir, elle nous préparait la mort et la noire destinée. Elle imagina donc dans son âme une ruse nouvelle ; assise dans ses demeures, elle ourdissait une grande toile, tissu délicat et d’une grandeur immense ; puis elle nous dit : « Jeunes hommes, mes prétendants, puisque Ulysse à péri, différez mon mariage, malgré vos désirs, jusqu’à ce que j’aie achevé ce tissu funèbre que je destine au héros Laërte (puissent mes travaux n’être pas entièrement perdus !) lorsqu’il subira les dures lois de la mort ; de peur que quelque femme parmi le peuple des Grecs ne s’indigne contre moi, s’il reposait sans linceul celui qui posséda de si grandes richesses. » Ainsi parlait Pénélope ; nos âmes généreuses se laissèrent persuader. Cependant durant le jour elle travaillait à cette grande toile ; mais la nuit, à la lueur des flambeaux, elle détruisait son ouvrage. Pendant trois années elle se cacha par ses ruses, et persuada les Grecs ; mais quand les heures dans leur cours amenèrent la quatrième année, que les mois et les journées nombreuses furent écoulées, une femme bien instruite nous avertit, et nous trouvâmes Pénélope défaisant cette belle toile. Alors, quoiqu’elle ne voulût pas, elle l’acheva par force. Elle nous montra le voile, cette toile immense qu’elle avait brodée, et l’ayant lavée, elle resplendissait comme le soleil ou la lune. Mais alors un dieu funeste reconduisit Ulysse à l’extrémité de son champ, où le gardien des porcs habitait une maison. C’est là que vint aussi le fils du divin Ulysse, en arrivant sur son vaisseau de la sablonneuse Pylos ; tous les deux ayant concerté le trépas des prétendants, se rendirent dans notre ville célèbre. Ulysse y vint le dernier, Télémaque l’avait précédé. Le gardien des porcs conduisit Ulysse revêtu de méchants haillons, s’appuyant sur un bâton, comme un pauvre mendiant, et comme un vieillard. Son corps étant ainsi couvert de ces tristes haillons, aucun de nous ne put le reconnaître en cet état, même les plus âgés, quand il nous apparut tout à coup ; mais nous l’accablâmes de coups et d’injures. Ce prince, outragé, frappé dans son propre palais, souffrit tout avec une constance inébranlable ; alors la pensée du puissant Zeus lui fit enlever avec Télémaque les armes superbes qu’il déposa dans la chambre nuptiale, dont il ferma soigneusement les portes ; ensuite, par un adroit stratagème, il ordonne à son épouse d’apporter aux prétendants l’arc avec les piliers de fer, jeux qui pour nous infortunés devinrent la cause de notre mort. Aucun de nous ne parvint à tendre le nerf de cet arc redoutable : nous fûmes trop faibles ; mais lorsque Ulysse est prêt à saisir l’arc immense, nous défendons avec des paroles menaçantes de lui donner cet arc, quoi qu’il puisse dire. Télémaque seul l’encourageant l’excite à le prendre. Sitôt qu’Ulysse le reçoit dans sa main, il tend l’arc sans effort, et traverse les piliers de fer ; puis s’élançant sur le seuil, debout, il répand à ses pieds les traits rapides, en jetant un regard terrible. Il frappe le prince Antinoos ; bientôt, visant en face, il accable tous les autres de ses flèches meurtrières : ils tombent entassés les uns sur les autres. Il était évident qu’un dieu protégeait Ulysse et les siens. Eux, aussitôt, cédant à leur vaillance, se précipitent dans la salle, et tuent de toutes parts ; alors retentit le bruit affreux des crânes fracassés, et le sol est inondé de sang. Agamemnon, c’est ainsi que nous avons perdu la vie, et maintenant encore nos cadavres sans sépulture sont étendus dans le palais d’Ulysse ; nos amis dans leurs demeures ne le savent pas, eux qui, lavant le sang de nos blessures, nous déposeraient en pleurant sur le bûcher, car ce sont les honneurs réservés aux morts. »
« Heureux fils de Laërte, ingénieux Ulysse, s’écrie Agamemnon, tu viens donc par ta grande valeur de reconquérir ton épouse C’est ainsi que de nobles pensées furent accordées à l’irréprochable Pénélope, la fille d’Icarios ; c’est ainsi qu’elle a gardé le souvenir d’Ulysse, de ce héros qu’elle épousa dans sa jeunesse. La gloire de sa vertu ne périra jamais ; les immortels inspireront aux hommes qui vivent sur la terre d’aimables chants en l’honneur de la sage Pénélope. Ce n’est point ainsi qu’en agit la fille de Tyndare, qui commit un forfait odieux en immolant celui qui l’épousa dans sa jeunesse ; des chants lugubres en garderont la mémoire parmi les hommes ; elle a préparé dans l’avenir une fâcheuse renommée à toutes les femmes, même à celle qui sera vertueuse. »
C’est ainsi que ces ombres discouraient ensemble, debout dans les royaumes d’Hadès, profonds abîmes de la terre.
Cependant, lorsque Ulysse et les siens sont sortis de la ville, ils se rendent au champ fertile et bien cultivé de Laërte, que jadis acquit ce héros, après avoir éprouvé bien des peines. C’est là qu’était la maison de Laërte ; tout autour régnait une galerie, où mangeaient, se reposaient et dormaient les serviteurs dont il avait besoin, et qui travaillaient à lui plaire. En ces lieux vivait une vieille femme sicilienne, qui prenait grand soin du vieillard dans ces campagnes éloignées de la ville. C’est là qu’Ulysse s’adressant à ses compagnons ainsi qu’à son fils, leur dit ces mots :
« Amis, entrez maintenant dans cette maison ; préparez pour le repas le porc le plus gras du troupeau ; moi, je vais essayer auprès de notre père s’il pourra me reconnaître à la première vue, ou s’il ne me reconnaîtra pas, après une si longue absence. »
Il dit, et remet aux pasteurs ses armes redoutables. Ceux-ci se hâtent d’entrer dans la maison ; cependant Ulysse se rend au verger fertile pour éprouver son père. En traversant ce vaste jardin, il ne trouve ni Dolios, ni ses fils, ni même aucun des serviteurs ; ils étaient allés chercher des buissons pour être la clôture de cette enceinte ; le vieux Dolios les avait conduits. Il trouve donc son père seul, occupé, dans ce verger fertile, à creuser la terre autour d’une plante. Laërte était revêtu d’une pauvre et méchante tunique, toute recousue ; il avait entouré ses jambes avec des bottines de peau rapiécées, redoutant les piqûres ; et sur ses mains étaient des gants, à cause des buissons ; enfin il avait sur la tête un casque de poil de chèvre, pour compléter son deuil. Quand le noble et patient Ulysse aperçut son père accablé de vieillesse, et nourrissant au fond de son âme un profond chagrin, il s’arrête sous un haut poirier, et répand des larmes. Alors il balance dans sa pensée s’il ira droit à lui pour l’embrasser et lui raconter en détail comment il est arrivé dans sa patrie, ou bien s’il doit interroger et l’éprouver sur chaque chose. Le parti qui lui semble préférable est d’abord d’éprouver le vieillard par des paroles piquantes. Dans ce dessein, le divin Ulysse va droit à son père ; celui-ci, la tête baissée, creusait la terre autour d’une plante. Ulysse s’arrête près de Laërte, et lui dit :
« O vieillard, non, vous n’êtes point sans expérience pour cultiver ce jardin, et vous en avez grand soin, car il n’est aucune plante, ni le figuier, ni la vigne, ni l’olivier, ni le poirier, ni les planches de jardinage qui manquent d’entretien. Toutefois, je dois vous le dire, ne vous irritez pas contre moi, vous ne prenez aucun soin de vous-même, mais vous êtes à la fois accablé par la triste vieillesse, une honteuse négligence et le désordre de vos vêtements. Ce n’est point sans doute à cause de votre paresse que votre maître ne vous soigne pas ; d’ailleurs, vos traits et votre taille n’annoncent point un pauvre esclave ; au contraire, vous paraissez être un roi. Vous êtes semblable à l’homme fortuné qui, lorsqu’il s’est baigné, qu’il à mangé, se repose mollement ; tel est le juste partage des vieillards. Mais dites-moi, parlez franchement, de quel maître êtes-vous le serviteur ? Pour qui cultivez-vous ce verger ? Apprenez-moi, pour que je le sache, s’il est vrai que je sois arrivé dans Ithaque, ainsi que vient de me le dire un homme que j’ai rencontré quand je venais en ces lieux, et qui s’est montré peu complaisant ; il n’a point voulu me répondre ni même écouter mes questions quand je m’informais si mon hôte vivait, et s’il existait encore, ou s’il était mort et descendu dans le royaume d’Hadès. Je vous interrogerai donc, prêtez quelque attention, écoutez moi ; jadis dans ma douce patrie j’accueillis un héros qui vint en notre palais ; nul autre de tous les étrangers arrivés des pays lointains ne me fut plus cher. Il se glorifiait d’être né dans Ithaque, et me disait que son père était Laërte, fils d’Arcisios. Je l’accueillis dans ma maison, en lui prodiguant avec zèle tous les biens qu’elle renfermait ; ensuite je lui donnai les présents de l’hospitalité, comme il convient ; je lui donnai sept talents d’or, une coupe toute d’argent ornée de fleurs sculptées, douze voiles simples, autant de tapis, autant de manteaux, et le même nombre de tuniques ; en outre, quatre belles femmes, habiles aux travaux irréprochables, et que lui-même avait voulu choisir. »
« Étranger, lui dit son père en versant des larmes, vous êtes en effet dans le pays que vous venez de nommer ; des hommes insolents et pervers le gouvernent maintenant. Les nombreux présents que vous avez prodigués sont devenus inutiles ; mais si vous aviez retrouvé votre hôte encore vivant, au milieu du peuple d’Ithaque, il vous eût renvoyé dans votre patrie, après vous avoir offert à son tour des présents et cette hospitalité généreuse que reçoit avec justice celui qui nous accueillit le premier. Cependant, dites-moi, racontez avec sincérité : combien s’est-il écoulé de temps depuis que vous avez reçu ce héros, votre hôte malheureux, mon fils, qui du moins l’était autrefois ? Maintenant, loin de sa patrie et de ses amis, il est peut-être au fond des mers, dévoré par les poissons, ou, sur le continent, il est devenu la proie des bêtes sauvages et des vautours. Sa mère n’a point pleuré sa mort, après l’avoir enseveli, non plus que son triste père, nous qui lui donnâmes le jour ; son épouse, la prudente Pénélope, n’a point versé de larmes sur le lit funèbre de son époux, et n’a pu, comme il convient, lui fermer les yeux, car tel est le tribut qu’on doit aux morts. Toutefois encore, répondez à mes questions, afin que je sache la vérité : dites-moi qui vous êtes ; quels peuples venez-vous de quitter ? Quels sont et votre patrie et vos parents ? Où donc est resté le vaisseau qui vous a conduits, vous et vos généreux compagnons ? Êtes-vous venu sur un navire étranger, et vous ayant déposé sur ce rivage, les matelots sont-ils partis ? »
« Je vous donnerai tous ces détails, lui répondit Ulysse. Je suis d’Alybante, où j’habite un superbe palais, et fils d’Aphidante, issu du roi Polypémon ; mon nom est Épéritos ; un dieu, me faisant errer loin de la Sicile, m’a conduit ici malgré moi ; mon navire est sur le rivage, à quelque distance de la ville. Quant au noble Ulysse, déjà cinq années se sont écoulées depuis le jour où ce héros malheureux a quitté ma patrie ; comme il allait partir, des oiseaux favorables volèrent à droite, et, charmé de cet augure, je hâtai son départ. Lui-même se réjouit en partant ; il espérait en son cœur que l’hospitalité nous réunirait encore, et qu’il me donnerait de superbes présents. »
Il dit ; un nuage de douleur obscurcit le front du vieillard ; de ses deux mains prenant une poussière aride, il la répand sur sa tête blanche en soupirant avec amertume. Cependant Ulysse se trouble en son âme, une vive émotion saisit ses narines en regardant son père. Alors il se précipite vers Laërte, le presse dans ses bras, et s’écrie :
« C’est moi-même, ô mon père, qui suis le fils que vous regrettez, et qui reviens enfin dans ma patrie, après vingt années d’absence. Cessez vos gémissements et votre lamentable deuil. Je vous raconterai tout, mais à présent il faut nous hâter ; sachez seulement que dans mon palais je viens d’immoler tous les prétendants, châtiant ainsi leur insolence et leurs forfaits odieux. »
« Ah ! si vous êtes Ulysse, reprend le vieillard à l’instant, si vraiment vous êtes mon fils qui revient en ces lieux, montrez-moi quelque signe certain pour m’en convaincre. »
Le prudent Ulysse lui répondit aussitôt :
« Voyez de vos yeux la blessure que j’ai reçue d’un sanglier aux dents éclatantes sur le mont Parnèse, quand je me rendis (vous et mon auguste mère m’envoyâtes) auprès d’Autolycos, le père chéri de ma mère, afin de recevoir les dons qu’il avait promis et juré de m’accorder. Mais je veux vous dire encore tous les arbres que dans cette riche enceinte vous m’avez donnés jadis, lorsque je vous en demandais, n’étant encore qu’un enfant, et que j’accompagnais vos pas dans ce verger ; vous, en parcourant ces allées d’arbres, vous comptiez ainsi ceux que vous m’aviez donnés. Treize poiriers, dix pommiers et quarante figuiers ; vous me promettiez encore de me donner cinquante rangs de vigne, dont chacun était chargé de fruits ; là naissent des grappes en abondance, lorsque les saisons de Zeus ramènent du haut du ciel l’instant de la fécondité. »
Le vieillard à ces mots sent ses genoux et son cœur défaillir en reconnaissant les signes certains que donne Ulysse de sa présence, et jette les bras autour de son fils : le noble héros soutient son père, prêt à s’évanouir. Lorsque Laërte a repris ses sens et rassemblé ses esprits, il s’écrie à son tour, et fait entendre ces paroles :
« Oui, sans doute, ô puissant Zeus, oui, dieux immortels, vous régnez dans l’Olympe, s’il est vrai que les prétendants ont expié leur insolence. Mais maintenant je redoute au fond de mon cœur que les habitants d’Ithaque ne fondent sur nous, et que de toutes parts ils n’envoient des ambassadeurs aux villes des Céphalléniens. »
« Rassurez-vous, lui répondit Ulysse ; que cet avenir ne trouble point votre âme. Mais rendons-nous à votre habitation située près de ce verger ; c’est là que je viens d’envoyer Télémaque avec Eumée et Philétios, afin qu’à l’instant ils nous préparent le repas. »
En achevant ces discours, ils se dirigent vers la maison de Laërte. Lorsqu’ils sont entrés dans ces belles demeures, ils trouvent Télémaque avec le pasteur des bœufs et le gardien des chèvres coupant les viandes, et mettant le vin dans les urnes.
En ce moment l’esclave sicilienne conduit Laërte au bain, le parfume d’essences, et le revêt d’une riche tunique ; Athéna, s’approchant de lui, donne une force nouvelle à ce pasteur des peuples, le fait paraître plus grand et plus majestueux qu’auparavant. Laërte s’éloigne du bain ; son fils est frappé d’étonnement, en le voyant ainsi semblable aux dieux ; alors il lui dit ces mots rapides :
« Sans doute, ô mon père, c’est l’un des immortels qui vous fait paraître si beau de taille et de figure ? »
Le sage vieillard reprend en ces mots :
« Zeus, Athéna, Apollon, comme je fus jadis, lorsque, régnant sur les Céphalléniens, je ravageai Néricos, ville superbe, située sur le rivage du continent, que n’étais-je hier dans nos demeures, les épaules couvertes de mes armes, pour attaquer et combattre les prétendants ! Sous mes coups un grand nombre auraient perdu la vie, et votre âme, ô mon fils, aurait été comblée de joie. »
C’est ainsi qu’ils discouraient ensemble. Quand les apprêts sont terminés, et que les mets sont préparés, tous s’asseyent en ordre sur des sièges et sur des trônes ; c’est là qu’ils prennent le repas. Près d’eux alors arrivent le vieillard Dolios et ses fils, qui revenaient du travail ; leur mère, la vieille Sicilienne, les avait appelés, elle qui les nourrit, et qui prodiguait les plus tendres soins à Dolios, car il était accablé par l’âge. Sitôt qu’ils aperçoivent Ulysse, ils le reconnaissent, et dans la salle des festins restent immobiles d’étonnement ; mais le héros leur adresse aussitôt ces douces paroles :
« Vieillard, asseyez-vous à notre table ; revenez de votre surprise ; depuis longtemps nous étions dans cette demeure, impatients de prendre quelque nourriture, en vous attendant toujours. »
Il dit ; aussitôt Dolios accourt en étendant les bras, baise la main d’Ulysse, et s’écriant, il lui parle en ces mots :
« Ami, puisque enfin vous nous êtes rendu, puisque les immortels vous ont ramené contre toute espérance, jouissez d’une longue vie, soyez heureux, et que les dieux vous comblent de biens. Mais parlez-moi sincèrement, pour que je sache si Pénélope est instruite de votre retour, ou si nous devons lui porter cette nouvelle. »
« Vieillard, répondit Ulysse, la reine sait mon arrivée ; pourquoi vous inquiéter de tels soins ? »
Il dit, et Dolios s’assied sur un siège magnifique. Alors ses enfants adressent à leur tour de respectueuses paroles au divin Ulysse, et lui baisent les mains ; puis ils se placent en ordre auprès de leur père. Eux alors prennent le repas dans les demeures de Laërte.
Cependant la Renommée, prompte messagère, en parcourant la ville de toutes parts, à bientôt annoncé la mort et la funeste destinée des prétendants. À cette nouvelle, tous les citoyens accourent de toutes parts, poussent des cris, de longs hurlements, et parviennent devant le palais d’Ulysse ; ils enlèvent les cadavres de dessous le portique, et leur donnent la sépulture ; mais les corps des princes venus des villes voisines sont ramenés dans leur patrie par des pêcheurs, qui les emportent sur leurs légers navires. Cependant les habitants d’Ithaque se rassemblent sur la place publique, le cœur rongé de tristesse. Lorsque l’assemblée est formée, qu’ils sont tous réunis, Eupithès se lève au milieu d’eux pour haranguer ; il éprouvait un vif chagrin de la mort de son fils Antinoos, que, le premier de tous, avait immolé le valeureux Ulysse ; il s’avance eu pleurant dans l’assemblée, et tient ce discours :
« O mes amis, cet homme vient de commettre un grand forfait parmi les Grecs. Jadis il entraîna sur ses navires de nombreux et vaillants guerriers, et laissa périr à la fois les navires et les hommes ; maintenant voilà qu’à son retour il immole les plus vaillants des Céphalléniens. Venez donc, avant qu’il se retire à Pylos, ou dans la divine Élide que possèdent les Épéens, marchons ; autrement, nous éprouverons un opprobre éternel ; notre honte retentira jusque dans les races futures. Si nous ne vengeons pas le trépas de nos enfants et de nos frères, pour moi désormais la vie sera sans charme ; je voudrais à l’instant descendre parmi les morts. Mais allons, de peur que nos ennemis ne nous préviennent, en s’éloignant de ces lieux. »
C’est ainsi qu’il parlait en versant un torrent de larmes ; tous les Grecs étaient émus de pitié. Mais alors s’avancent Médon et le chantre divin, qui sortaient du palais d’Ulysse, et qui venaient de s’arracher au sommeil ; ils s’arrêtent au milieu de l’assemblée ; chacun reste saisi d’étonnement. Alors le sage Médon fait en tendre ces paroles :
« Écoutez-moi, citoyens d’Ithaque ; ce n’est point sans la volonté des dieux qu’Ulysse accomplit ces exploits ; moi-même j’ai vu l’un des immortels se tenir auprès de ce héros : il était en tout semblable à Mentor. Tantôt cette divinité paraissait devant Ulysse en l’encourageant, tantôt, troublant les prétendants, elle les dispersait dans la salle : ils tombaient entassés les uns sur les autres. »
À ces mots, la pâle crainte s’empare de tous. Alors le sage Halithersès, fils de Mastor, veut aussi parler : lui seul connaissait l’avenir et le passé ; plein de bienveillance pour le peuple, il parlait ainsi dans l’assemblée :
« Écoutez ma voix, habitants d’Ithaque, et que je vous dise toute ma pensée. C’est à votre injustice, mes amis, que sont dus tous ces maux ; vous n’avez point suivi mes conseils, ni ceux de Mentor, pasteur des peuples, et vous n’avez point réprimé l’insolence de vos enfants ; eux, dans leur insigne folie, ont commis un grand crime, en dévorant les richesses, en outrageant l’épouse d’un homme vaillant ; ils pensaient qu’il ne reviendrait jamais. Voilà ce qu’il en est résulté ; mais obéissez-moi, comme je vous le conseille : ne marchons point contre Ulysse, de peur que l’un de vous ne trouve le mal qu’il s’est attiré. »
Il dit ; plus de la moitié du peuple se lève en poussant des cris tumultueux ; les autres demeurent rassemblés sur la place publique. Le conseil d’Halithersès ne plaît point à leur âme, ils suivent celui d’Eupithès ; soudain ils se couvrent de leur armure. Après avoir autour de leur corps revêtu l’airain étincelant, ils se rassemblent en grand nombre devant les murs de la ville. Eupithès se met imprudemment à leur tête : il pensait venger le trépas de son fils, mais il ne retournera point dans ses foyers, et lui-même en ces lieux recevra la mort. Cependant Athéna adresse ces paroles à Zeus, le fils de Cronos :
« O mon père, Zeus, le plus puissant des dieux, répondez à mes questions : quel nouveau dessein est caché dans votre âme ? Voulez-vous rallumer la guerre funeste et les tristes discordes, ou cimenter l’alliance entre les deux partis ? »
« Ma fille, répond le formidable Zeus, pourquoi m’interroger et vous enquérir de ces choses ? N’est-ce pas par votre conseil qu’Ulysse, en revenant dans sa patrie, s’est vengé de ses ennemis ? Faites comme vous le désirez ; mais je vous dirai ce qui me semble convenable. Puisque enfin Ulysse a puni les prétendants, qu’on immole les victimes, gages des serments, et qu’il règne toujours sur ses peuples. Nous, cependant, inspirons l’oubli du meurtre des enfants et des frères ; que tous se chérissent les uns les autres, comme auparavant ; et que reparaissent la paix et l’abondance. »
Ces mots ont ranimé l’ardeur d’Athéna ; elle s’élance avec rapidité des sommets de l’Olympe.
Lorsque, dans les demeures de Laërte, tous se sont rassasiés d’une nourriture succulente, le divin Ulysse leur donne cet ordre :
« Que l’un de vous en sortant voie si nos ennemis n’approchent pas de ces lieux. »
Il dit ; l’un des fils de Dolios sort aussitôt, comme le commande Ulysse ; il s’arrête sur le seuil de la porte, et voit tout le peuple qui s’approche ; soudain s’adressant au vaillant Ulysse, il s’écrie :
« Les voilà qui s’approchent ; armons-nous promptement. »
À ces mots, tous se lèvent, et prennent leurs armes : d’abord quatre guerriers, en comptant Ulysse, et les six enfants de Dolios ; Laërte et Dolios se couvrent aussi d’une armure, et, quoique blanchis par l’âge, ils sont forcés de combattre. Quand ils ont revêtu leur corps de l’airain étincelant, ils franchissent les portes, s’avancent dans la plaine, Ulysse est à leur tête.
Près d’eux arrive Athéna, la fille de Zeus, empruntant les traits et la voix de Mentor. Le noble Ulysse se réjouit en la voyant ; ce héros alors adresse ces mots à Télémaque, son fils chéri :
« Télémaque, aussitôt que vous verrez, en vous y mêlant, le combat des guerriers où se distinguent les plus braves, ne flétris sez pas la gloire de vos pères, nous qui par notre force et notre valeur avons brillé par toute la terre. »
Le prudent Télémaque lui répond à l’instant :
« Vous verrez, ô mon père chéri, si tel est votre désir au fond de votre âme, que je ne flétrirai point la gloire de mes ancêtres, ainsi que vous le recommandez. »
Il dit ; Laërte à ce discours éprouve une vive joie, et s’écrie :
« Quelle sera pour moi cette journée, dieux protecteurs ? Et pourtant je me réjouis ; mon fils et mon petit-fils disputent tous les deux de vaillance. »
Alors la déesse Athéna s’approche du vieillard, et lui dit :
« O fils d’Arcisios, le plus cher de tous mes compagnons, adresse ta prière à la vierge aux yeux d’azur, ainsi qu’à Zeus son père, puis, en la brandissant, lance ta longue javeline. »
Elle dit, et Athéna remplit Laërte d’une grande force. Ce héros alors implore la fille du grand Zeus, puis aussitôt, brandissant sa longue javeline, il la lance, et frappe Eupithès à travers le casque étincelant ; le trait n’est point arrêté, l’airain est traversé tout entier : Eupithès tombe avec fracas, et l’armure retentit autour de lui. Soudain Ulysse et son valeureux fils se précipitent sur les premiers rangs ; ils frappent tour à tour du glaive et de la lance. Ces deux guerriers les immolaient tous, et les privaient du retour, si Athéna n’eût fait entendre sa voix, et n’eût arrêté tout le peuple.
« Citoyens d’Ithaque, s’écrie-t-elle, cessez une guerre funeste, et sans plus de sang, séparez-vous à l’instant. »
Ainsi parle Athéna ; la pâle crainte s’empare d’eux, les armes échappent de leurs mains, tous leurs glaives tombent à terre à la voix de la déesse ; ils fuient vers la ville, désireux de sauver leurs jours. Ulysse pousse des cris terribles, et, rassemblant ses forces, fond sur eux comme un aigle au vol rapide. En ce moment, Zeus lance sa foudre étincelante, qui tombe aux pieds d’Athéna, fille d’un dieu puissant. Pallas aussitôt se tourne vers le héros, et lui dit :
« Fils de Laërte, noble et vaillant Ulysse, arrête, fais cesser les horreurs de la guerre cruelle, de peur que Zeus, le fils de Cronos, ne s’irrite contre toi. »
Ainsi parle Athéna ; Ulysse obéit à l’instant, et se réjouit dans son cœur. Bientôt entre les deux partis s’élèvent les gages sacrés des serments, que place Athéna elle-même, la fille du dieu de l’égide, Pallas, semblable à Mentor et par les traits et par la voix.
Fin de l’Odyssée
(Traduction de Jean-Baptiste Dugas-Montbel, 1835 –
Corrections Kulturica : re-hellénistation des noms propres)