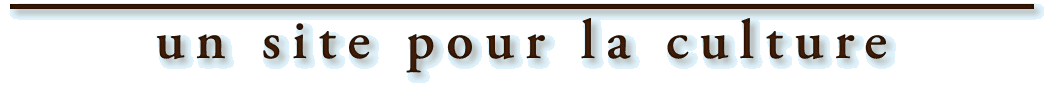L’Iliade et l’Odyssée dans la traduction de Jean-Baptiste Dugas-Montbel
L’Iliade : Chant 1 • Chant 2 • Chant 3 • Chant 4 • Chant 5 • Chant 6 • Chant 7 • Chant 8 • Chant 9 • Chant 10 • Chant 11 • Chant 12 • Chant 13 • Chant 14 • Chant 15 • Chant 16 • Chant 17 • Chant 18 • Chant 19 • Chant 20 • Chant 21 • Chant 22 • Chant 23 • Chant 24
L’Odyssée : Chant 1 • Chant 2 • Chant 3 • Chant 4 • Chant 5 • Chant 6 • Chant 7 • Chant 8 • Chant 9 • Chant 10 • Chant 11 • Chant 12 • Chant 13 • Chant 14 • Chant 15 • Chant 16 • Chant 17 • Chant 18 • Chant 19 • Chant 20 • Chant 21 • Chant 22 • Chant 23 • Chant 24
Entretiens d’Ulysse et de Pénélope. – Reconnaissance d’Ulysse par Euryclée.

Ulysse et ses compagnons, mosaïque du musée du Bardo à Tunis
Le divin Ulysse était resté dans l’intérieur du palais, méditant avec Athéna le trépas des prétendants ; aussitôt il adresse à Télémaque ces paroles rapides :
« Télémaque, il faut placer dans l’intérieur de la chambre nos armes terribles, toutes sans exception ; ensuite détournez les soupçons des prétendants par des discours spécieux, et lors qu’ils vous interrogeront dans le désir de posséder ces armes, dites-leur :
« Je les ai placées loin de la fumée ; elles ne sont déjà plus semblables à celles qu’Ulysse à laissées quand il partit pour Ilion ; mais elles ont perdu leur éclat, tant elles furent exposées à la vapeur de la flamme. D’ailleurs un dieu m’inspire une pensée plus forte : je redoute qu’en buvant le vin et prenant entre vous querelle, vous ne vous frappiez les uns les autres, et ne souilliez par le sang vos festins et les poursuites du mariage ; car le fer attire l’homme. »
Il dit ; Télémaque obéit aux ordres de son père ; et soudain appelant la nourrice Euryclée, il lui dit :
« Nourrice, renfermez les femmes de la reine dans leurs appartements, tandis que j’irai déposer dans la chambre les superbes armes de mon père, que la fumée a ternies dans ce palais, depuis sa longue absence ; jusqu’à ce jour je ne fus qu’un enfant, maintenant je veux les mettre à part, pour qu’elles ne soient plus exposées à la vapeur de la flamme. »
« Plût au ciel, mon fils, répond la nourrice Euryclée, qu’enfin vous soyez assez prudent pour prendre soin de votre maison et conserver tous vos biens ! Mais dites-moi qui portera devant vous un flambeau ? car vous ne permettrez pas aux servantes de sortir, elles qui doivent vous éclairer. »
« Cet étranger m’aidera, reprend le sage Télémaque. Je ne veux pas qu’il reste oisif, celui qui touche à mon boisseau, quoiqu’il vienne de loin. »
Ainsi parla le héros ; cette parole n’est point fugitive pour Euryclée. Elle ferme les portes des appartements habités. Alors Ulysse et son fils se hâtent d’enlever les casques, les boucliers arrondis, et les lances aiguës ; devant eux la déesse Pallas, portant un flambeau d’or, répandait une vive lumière. Aussitôt Télémaque, s’adressant au vaillant Ulysse :
« O mon père, dit-il, un prodige étonnant frappe mes yeux ; les murs de ce palais, ces superbes lambris, ces poutres de sapin, ces hautes colonnes, brillent à mes regards comme une flamme étincelante ; sans doute qu’en cette demeure est venu l’un des dieux qui possèdent le vaste ciel. »
« Silence, interrompt le sage Ulysse, retenez vos pensées en votre âme, ne m’interrogez pas ; en effet, telle est la coutume des dieux qui possèdent l’Olympe. Vous cependant, allez goûter quelque repos ; moi, je reste en ces lieux, afin d’éprouver les servantes et votre mère ; elle qui dans sa douleur m’interrogera sur chaque chose. »
Il dit ; alors Télémaque sort du palais, et se rend, à la lueur des flambeaux, dans la chambre où jusque alors il avait coutume de coucher quand venait le doux sommeil ; c’est là qu’il s’endort et qu’il attend la divine aurore. Ulysse cependant était resté dans le palais, méditant avec Athéna le trépas des prétendants.
En ce moment Pénélope quitte ses riches appartements, belle comme Artémis ou la blonde Aphrodite. Ses femmes placent devant le foyer le siège orné d’argent et d’ivoire où s’asseyait la reine, meuble que jadis façonna l’ouvrier Icmalios, et sous lequel il adapta pour les pieds une escabelle, qui tenait au siège lui-même, et qu’on recouvrait d’une large peau de brebis. C’est là que s’assied la sage Pénélope. Alors les servantes arrivent de l’intérieur du palais. Elles enlèvent une grande quantité de pain, les tables, et les coupes où burent les fiers prétendants ; elles jettent à terre le feu des brasiers ; mais elles y remettent beaucoup de bois, pour répandre la lumière et la chaleur. Mélantho cependant, une seconde fois, outrage Ulysse, et lui dit :
« Étranger, pourquoi te permettre, errant ainsi durant la nuit dans ce palais, d’épier les femmes ? Sors d’ici, misérable, sois satisfait d’avoir pris ton repas, ou soudain, frappé de ce tison, tu seras mis dehors. »
Le patient Ulysse, lançant sur elle de terribles regards, lui répond en ces termes :
« Malheureuse ! pourquoi me poursuivre ainsi d’une âme irritée ? Est-ce parce que je suis malpropre, couvert de méchants habits, et que je mendie par la ville ? Hélas ! la nécessité m’y contraint. Tels sont en effet les pauvres et les voyageurs infortunés. Moi-même, heureux autrefois, j’habitais aussi parmi les hommes un riche palais, et souvent je comblais de bien l’étranger, quel qu’il fût, quand il arrivait pressé par le besoin. Je possédais mille serviteurs et tous les biens échus à ceux qui vivent dans l’abondance et que l’on nomme opulents. Mais le fils de Cronos a tout détruit ; telle fut sa volonté. Redoute donc aussi, jeune fille, de perdre cet éclat de beauté dont tu parais ornée entre toutes tes compagnes ; crains que ta maîtresse irritée ne te punisse, ou qu’Ulysse ne revienne : le destin nous laisse encore quelque espérance. Mais serait-il mort et ne fût-il aucun espoir de retour, son fils est tel que lui par le secours d’Apollon, Télémaque, auquel pas une femme de ce palais ne pourra dérober ses crimes ; car il n’est plus aujourd’hui dans l’enfance. »
Il dit, et Pénélope entendit ce discours ; alors elle réprimande la servante, et lui parle en ces mots :
« Audacieuse, et la plus effrontée de toutes, ton crime ne m’est point caché, tu le payeras de ta tête. Tu savais tout pourtant, puisque toi-même as entendu de ma bouche que je voulais dans mes appartements interroger cet hôte sur le sort de mon époux ; car mon âme est profondément affligée. »
Ayant ainsi parlé, Pénélope donne cet ordre à l’intendante du palais :
« Eurynomé, apportez un siège, et recouvrez-le d’une peau de brebis, afin qu’assis près de moi l’étranger m’adresse une parole et m’écoute à son tour ; je veux l’interroger. »
Elle dit ; aussitôt Eurynomé apporte un siège élégant, et le recouvre d’une peau de brebis ; c’est là que s’assied le patient Ulysse. Pénélope alors commence l’entretien, et lui parle en ces mots :
« Étranger, je vous demanderai d’abord qui vous êtes ; quel peuple venez-vous de quitter ? Quels sont et votre ville et vos parents ?
« O reine, lui répondit Ulysse, il n’est pas un seul homme sur toute la terre qui vous fasse aucun reproche ; votre gloire s’est élevée jusqu’au vaste ciel ; vous êtes comme un prince irréprochable qui, plein de respect envers les dieux, règne sur des hommes nombreux et vaillants, et distribue la justice ; la terre fertile porte l’orge et le blé, les arbres sont chargés de fruits, les troupeaux sont féconds, la mer fournit du poisson en abondance ; grâce à son règne équitable, les peuples vivent heureux sous ses lois. Toutefois, maintenant dans votre maison, interrogez-moi sur tout autre sujet ; ne me questionnez pas sur ma famille, ma patrie, parce que vous rempliriez mon âme de douleurs si je rappelais ces souvenirs ; je suis surtout fertile en plaintes. Cependant je ne dois point m’asseoir dans une maison étrangère pour y soupirer et verser des larmes, parce qu’il est mal de gémir sans cesse avec amertume ; craignant d’ailleurs que vous-même, ou l’une de vos servantes, ne s’irrite contre moi, qu’elle ne dise, en me voyant répandre des pleurs, que mes esprits sont appesantis par le vin. »
La prudente Pénélope répondit en ces mots :
« Étranger, les dieux ont détruit ma force, ma taille, ma beauté, lorsque les Grecs s’embarquèrent pour Ilion, et qu’avec eux partit mon époux Ulysse. Si ce héros, en revenant ici, protégeait encore ma vie, j’en aurais bien plus de gloire et de beauté. Maintenant je languis dans la tristesse, tant sont nombreux les maux dont une divinité m’accable. Tous les princes qui règnent sur les îles voisines, Dulichium, Samé, la verte Zacynthe, ceux même qui se sont emparés du pouvoir dans l’âpre Ithaque, malgré moi, désirent m’épouser, et ravagent ma maison. Je ne puis donner mes soins aux étrangers, aux suppliants, ni même aux hérauts qui sont chargés d’un ministère public ; mais je regrette Ulysse, et mon cœur est consumé de chagrin. Eux cependant pressent mon mariage ; moi j’invente mille ruses. D’abord un dieu m’inspira de faire un vêtement funèbre, et d’ourdir, assise dans mon palais, une grande toile, tissu délicat, et d’une grandeur immense ; puis je leur ai dit : « Jeunes hommes, mes prétendants, puisque Ulysse a péri, différez mon mariage malgré vos désirs, jusqu’à ce que j’aie achevé ce tissu funèbre que je destine au héros Laërte (puissent mes travaux n’être pas entièrement perdus !), lorsqu’il subira les dures lois de la mort ; de peur que quelque femme parmi le peuple des Grecs ne s’indigne contre moi, s’il reposait sans un linceul, celui qui posséda de si grandes richesses. » C’est ainsi que je parlais ; leur âme se laissa persuader. Cependant, durant le jour je travaillais à cette grande toile, et la nuit, à la lueur des flambeaux, je détruisais mon ouvrage. Ainsi, pendant trois années, je me cachai par ruse, et je persuadai les Grecs ; mais quand les heures dans leur cours amenèrent la quatrième année, que les mois et les journées nombreuses furent écoulés, avertis par des servantes déboutées et sans pitié, les prétendants, survenant en ces lieux, me surprirent, et me menacèrent dans leurs discours. Ainsi, malgré moi, je fus contrainte par la nécessité d’achever mon ouvrage. Aujourd’hui je ne puis plus éviter le mariage, je ne vois plus aucun autre moyen ; d’ailleurs, mes parents me pressent de me marier. Mon fils, connaissant son malheur, voit avec peine qu’on dévore son héritage ; car le voilà maintenant homme capable de gouverner sa maison, et Zeus le comble de gloire. Mais vous, dites-moi quelle est votre famille, d’où vous êtes ; car sans doute vous n’êtes pas né du vieux chêne ou du rocher. »
« Vénérable épouse du fils de Laërte, répond Ulysse, ne cesserez-vous point de m’interroger sur ma naissance ? Eh bien, je vous la dirai ; mais vous me livrerez à des douleurs plus nombreuses que celles que j’éprouve : il doit en être ainsi pour tout homme éloigné de sa patrie depuis aussi longtemps que je le suis moi-même à présent, après avoir parcouru les nombreuses cités des hommes et souffert bien des maux. Cependant je vous les raconterai, puisque vous m’interrogez et le demandez avec instance.
Au milieu de la vaste mer est le pays de Crète, île belle et féconde ; elle renferme des hommes innom-brables, et quatre-vingt-dix villes. Divers langages y sont confondus ; là sont les Achéens, les magnanimes Crétois autochtones, les Cydoniens, les Doriens divisés en trois tribus, et les divins Pelages. Au milieu de ces peuples s’élève la grande ville de Cnossos ; c’est là que régna Minos, qui tous les neuf ans eut des entretiens avec Zeus, Minos, le père de mon père, le valeureux Deucalion. Oui, c’est à Deucalion que je dois le jour, ainsi qu’Idoménée, notre roi ; lui, sur ses larges vaisseaux, alla dans Ilion avec les Atrides ; moi, le plus jeune, je reçus le nom glorieux d’Éthon ; Idoménée était le premier et le plus vaillant. Ce fut en Crète que je vis Ulysse, et que je lui donnai les présents de l’hospitalité. La violence des vents, en l’éloignant du cap Malée, le poussa vers la Crète, quand il se rendait à Troie ; il s’arrêta sur le fleuve Amnisos, près de la grotte d’Ilithye, dans un port difficile ; ce héros n’échappa qu’avec peine à la tempête. Alors il s’informa d’Idoménée en venant à la ville ; car c’était, disait-il, son hôte vénérable et chéri. Mais déjà la dixième ou la onzième aurore avait brillé depuis qu’Idoménée sur ses forts navires était parti pour Ilion. Moi cependant, conduisant Ulysse dans notre palais, je lui donnai l’hospitalité ; je l’accueillis avec zèle, ayant à la maison de nombreuses provisions ; en outre, soit pour lui, soit pour les compagnons qui le suivirent, rassemblant des vivres du dépôt public, je leur donnai de la farine et du vin, afin qu’ils immolassent des bœufs et que chacun pût satisfaire ses désirs. Les Grecs demeurèrent douze jours dans la Crète ; ils étaient retenus par l’impétueux vent de Borée, qui sur la terre ne permettait pas qu’on restât debout ; une divinité terrible l’excitait ; enfin le vent tomba le treizième jour, et les Grecs s’éloignèrent. »
C’est ainsi que dans ses discours Ulysse donnait à des fables les apparences de la vérité ; Pénélope en l’écoutant versait des larmes, et son corps s’affaiblissait. Ainsi la neige, amoncelée par le Zéphyr sur les hautes montagnes, fond au souffle de l’Euros : les fleuves dans leurs cours en sont remplis ; de même est baigné de larmes le beau visage de Pénélope, qui ne cesse de pleurer son époux. Cependant Ulysse prend pitié dans son âme de sa gémissante épouse ; mais ses yeux restent fixes, comme de la corne ou du fer, et ses paupières sont immobiles ; par ruse il retient ses larmes. Quand Pénélope s’est longtemps rassasiée de pleurs et de regrets, elle adresse de nouveau la parole au vaillant Ulysse :
« Étranger, dit- elle, je désire maintenant vous éprouver, et savoir s’il est vrai qu’avec ses nobles compagnons vous ayez reçu mon époux dans vos demeures, comme vous l’annoncez ; dites-moi donc quels étaient ses vêtements, quel il était lui-même, et les amis qui le suivaient. »
« Grande reine, reprit Ulysse aussitôt, il me sera difficile de vous le dire, après un si long temps écoulé ; voilà déjà vingt années que ce héros aborda dans la Crète, et qu’il a quitté ma patrie. Cependant je vous raconterai tous ces détails comme mon imagination me les représente encore. Ulysse avait un large manteau de pourpre, d’une étoffe moelleuse ; il s’attachait par une agrafe d’or et ses deux anneaux ; sur le devant était une riche broderie : c’était un chien qui de ses deux pieds tenait un jeune cerf, et le regardait expirant. Chacun admirait ce travail, où les deux animaux étaient d’or. Le chien regardait le cerf en l’étouffant, et celui-ci, pour s’échapper, se débattait avec ses pieds. Autour de son corps j’aperçus aussi sa tunique élégante, semblable à l’enveloppe délicate de l’oignon, telle était sa finesse ; elle avait l’éclat du soleil, et beaucoup de femmes l’admiraient. Mais je dois vous le dire, remarquez bien ces paroles ; je ne sais pas si c’était là le vêtement qu’Ulysse portait à sa maison, ou si l’un de ses compagnons le lui donna quand il était sur son navire, ou bien quelque étranger ; car Ulysse était chéri d’un grand nombre, peu de héros parmi les Grecs le furent autant. Ainsi je lui donnai quand il partit une épée d’airain, un large et superbe manteau de pourpre, avec une longue tunique ; et je le renvoyai comblé d’honneurs sur son solide navire. Un héraut un peu plus âgé que lui l’accompagnait ; je vais le dépeindre tel qu’il était : il avait de larges épaules, la peau basanée, et les cheveux crépus, son nom était Eurybatès ; Ulysse l’honorait entre tous ses compagnons, parce qu’Eurybatès possédait un esprit plein de sagesse. »
À peine a-t-il achevé de parler, que Pénélope sent renaître plus vivement ses douleurs, en reconnaissant les signes que lui décrivait exactement Ulysse. Quand elle s’est rassasiée d’abondantes larmes, s’adressant encore à l’étranger, elle reprend en ces mots :
« Étranger, qui jusqu’à ce moment ne fûtes qu’un sujet de compassion, maintenant, dans mes demeures, vous me devenez un hôte respectable et chéri ; car c’est moi-même qui lui donnai les vêtements que vous venez de décrire, en les retirant tout pliés de la chambre du mariage ; j’attachai cette brillante agrafe pour être un ornement à cette parure. Mais, hélas ! je ne le recevrai plus à son retour dans sa douce patrie. Ce fut sous de cruels auspices qu’Ulysse partit dans son large navire pour l’infâme et funeste Ilion.
« Chaste épouse du fils de Laërte, reprend Ulysse aussitôt, ne détruisez point votre beauté, n’affligez point votre âme en pleurant votre époux ; et cependant je ne puis vous blâmer : toute femme pleure ainsi celui qui l’épousa quand elle était vierge, et dont elle eut des enfants en s’unissant à lui, surtout quand cet époux est Ulysse, qu’on dit être égal aux dieux. Mais calmez vos regrets, et retenez soigneusement mes paroles ; je vous parlerai sincèrement, et ne vous cacherai point ce que je sais touchant le retour d’Ulysse, qui près de ces lieux est plein de vie dans le pays des Thesprotes ; il apporte avec lui de nombreux et magnifiques trésors, qu’il a recueillis dans ses voyages ; mais il a perdu ses valeureux compagnons et son navire dans la mer profonde, en quittant l’île de Thrinacie. Zeus et le Soleil s’irritèrent contre lui ; car ses compagnons tuèrent les bœufs du Soleil. Tous ont péri dans les abîmes de la mer ; lui seul, échappant aux vagues sur la carène de son vaisseau, fut porté vers le continent, dans le pays des Phéaciens, qui tirent leur origine des dieux ; ces peuples, de leur plein gré, l’honorèrent comme une divinité, lui donnèrent des présents superbes, et voulaient le ramener chez lui sans dommage. Sans doute Ulysse serait depuis longtemps ici ; mais dans son âme il a jugé qu’il était préférable d’acquérir encore des richesses, en parcourant d’autres contrées ; votre époux l’emporte sur tous les hommes par ses nombreux stratagèmes, nul autre ne peut le lui disputer. Voilà ce que m’a raconté Pheidon, le roi des Thesprotes ; il m’a juré, lorsqu’il faisait des libations dans son palais, que le navire était sur le rivage, et que même étaient déjà prêts les compagnons qui doivent reconduire Ulysse dans sa patrie. Pheidon me renvoya le premier ; il saisit l’occasion d’un vaisseau thesprote qui faisait voile pour la fertile Dulichium ; il me montra les nombreuses richesses qu’Ulysse avait acquises ; elles nourriraient une famille entière jusqu’à la dixième génération : tels sont les trésors accumulés pour lui dans le palais du roi. Ce prince me dit qu’Ulysse était allé dans la forêt de Dodone, afin d’entendre du chêne divin à la haute chevelure le conseil de Zeus, et savoir s’il reviendrait dans sa patrie, après une si longue absence, ouvertement ou bien en secret. Ainsi donc il est plein de vie, il arrivera bientôt en ces lieux, et ne sera pas longtemps encore éloigné de ses amis et de sa patrie ; je vous en ferai le serment solennel. J’en atteste donc d’abord Zeus, le plus grand et le plus puissant des dieux, et ce foyer de l’irréprochable Ulysse, où je trouve un asile ; oui, toutes ces choses s’accompliront comme je le prédis. Dans le courant de cette année, Ulysse reviendra dans son palais, avant même la fin du mois, ou les premiers jours du mois suivant. »
La prudente Pénélope lui répondit aussitôt :
« Plût aux dieux, cher étranger, que cette parole s’accomplît ! vous éprouveriez bientôt ma reconnaissance, et vous recevriez de moi tant de biens que chacun en vous voyant vanterait votre félicité. Mais voici ce que je pense en mon âme, et ce qui s’accomplira. Non, Ulysse ne reviendra jamais dans sa maison, et vous n’obtiendrez point le retour, parce que ceux qui dominent dans cette demeure ne sont point tels qu’était Ulysse pour les étrangers (que ne l’est-il encore !), lui qui toujours accueillit les hôtes vénérables et leur procura le retour. Cependant, mes servantes, lavez l’étranger, et préparez sa couche, avec des couvertures, des manteaux et des tapis éclatants, afin qu’il puisse, à l’abri du froid, attendre le retour de l’Aurore sur son trône d’or. Demain encore vous le baignerez et le parfumerez d’essences, afin qu’assis dans le palais il prenne son repas auprès de Télémaque. Malheur à celui qui, cruel en son âme, oserait l’outrager ! il n’aura plus rien à faire en ces lieux, quel que soit le sujet de son courroux. Comment en effet, cher étranger, reconnaîtriez-vous que je l’emporte sur toutes les femmes par la sagesse et par ma prudence, si je vous laissais, malpropre et mal vêtu, partager nos festins dans ce palais ? Les hommes ne vivent que peu d’instants ; celui qui fut injuste, et qui conçut de mauvais desseins, tous le chargent d’imprécations pour l’avenir, durant sa vie entière ; tous le maudissent encore quand il est mort ; mais celui qui fut irréprochable, et qui conçut de bons desseins, les étrangers lui fondent une gloire immense parmi tous les hommes, et plusieurs le disent généreux. »
Le patient Ulysse reprend aussitôt, et fait entendre ces paroles :
« Vénérable épouse du fils de Laërte, les tuniques, les riches tapis, me sont odieux depuis le jour où sur un navire j’ai quitté les hautes montagnes de la Crète. Je me coucherai comme auparavant, quand je passais les nuits sans sommeil ; car j’ai passé bien des nuits sur une couche misérable, et j’attendais patiemment le retour de la divine Aurore. Le bain qu’on prépare pour mes pieds ne m’est plus agréable ; aucune des femmes qui servent dans ce palais ne touchera mes pieds, à moins que ce ne soit une femme âgée et prudente, et qui dans son âme ait souffert autant de maux que j’en ai supporté moi-même ; alors je ne m’opposerai point à ce qu’elle touche mes pieds. »
« Étranger, lui répondit Pénélope, de tous les hôtes chéris qui des pays lointains sont venus dans ce palais, aucun ne me parât aussi sensé que vous ; ainsi tout ce que vous dites est rempli de prudence. Eh bien, je possède une femme âgée, dont l’esprit est fertile en sages conseils, qui jadis nourrit, éleva le malheureux Ulysse, et le reçut dans ses mains quand l’enfanta sa mère ; elle lavera vos pieds, quoiqu’elle soit bien faible. Hâtez-vous donc, sage Euryclée, baignez l’étranger du même âge que votre maître ; tel est peut-être Ulysse, tels sont ses pieds et ses mains, car dans le malheur les hommes vieillissent beaucoup. »
Ainsi parle Pénélope ; cependant Euryclée cache son visage avec ses mains, et, versant d’abondantes larmes, elle prononce ces tristes paroles :
« Hélas ! c’est à cause de vous, mon fils, que me voilà sans force ; sans doute plus que tous les hommes Zeus vous abhorre, vous dont l’âme était si pieuse. Jamais nul mortel pour le maître de la foudre ne brûla les cuisses de tant de victimes, n’offrît tant de parfaites hécatombes que vous-même à cette divinité, lui demandant d’atteindre une douce vieillesse et d’élever votre illustre fils ; mais maintenant je crois que pour vous est entièrement perdu le jour du retour. Peut-être les femmes des peuples lointains insultent ce héros, quand il arrive dans de riches demeures, comme toutes ces impudentes vous ont vous-même insulté ; c’est sans doute pour éviter cet outrage et ces nombreuses avanies que maintenant vous ne leur permettez pas de vous baigner. Mais pour moi, ce n’est pas contre mon gré que me commande la fille d’Icarios, la prudente Pénélope. Je laverai vos pieds, à cause de Pénélope elle-même et de vous aussi ; parce qu’au fond de mon âme ma pensée a réveillé toutes mes douleurs. Vous, cependant, recueillez la parole que je vais prononcer : plusieurs étrangers malheureux sont venus ici, mais je déclare qu’aucun jamais, ni par sa taille, sa voix, ou sa démarche, ne me parut si semblable au valeureux Ulysse. »
« O femme, repartit le héros, tous ceux qui nous ont vus l’un et l’autre disent aussi qu’il existe entre nous une grande ressemblance ; ainsi vous venez de parler avec prudence. »
Il dit ; alors la vieille Euryclée apportant un bassin éclatant pour lui laver les pieds, y verse en abondance de l’eau froide ; ensuite au-dessus elle répand l’eau chaude. Ulysse, assis près du foyer, se tourne à l’instant du côté de l’ombre ; car il pense en lui-même qu’Euryclée en le lavant pourrait découvrir sa blessure, et que tous ses projets seraient dévoilés. Cependant elle s’approche de son maître, et lui baigne les pieds ; aussitôt elle reconnaît la blessure que lui fit jadis un sanglier aux dents d’ivoire, lorsqu’il parcourait le mont Parnèse avec Autolycos et les fils d’Autolycos, le père vaillant de sa mère, lui qui l’emportait sur tous les hommes par la ruse et par le serment ; un dieu même lui procura ces dons, le dieu Hermès, car il brûlait pour lui les cuisses délectables des chèvres et des agneaux : ainsi ce dieu lui fut toujours favorable. Cependant Autolycos, étant allé visiter le peuple fortuné d’Ithaque, trouva l’enfant nouveau-né de sa fille ; la nourrice Euryclée le plaça sur les genoux du héros, lorsqu’il finissait son repas ; puis elle l’appelle, et lui dit ces mots :
« Autolycos, trouvez maintenant un nom pour le donner à l’enfant de votre fille, lui qui fut l’objet de tous vos vœux. »
« Mon gendre, et vous, ma fille, répondit Autolycos, donnez-lui le nom que je vais vous dire ; comme j’arrive en ces lieux en étant irrité contre plusieurs hommes et plusieurs femmes, sur la terre fertile, que son nom significatif soit Ulysse. Je veux aussi, lorsqu’il atteindra l’adolescence, qu’il vienne dans la vaste maison maternelle, sur le mont Parnèse, où je possède des richesses ; je lui ferai part de ces biens, et le renverrai comblé de joie. »
Ainsi donc Ulysse partit dans la suite, afin que son grand-père lui donnât ces riches présents. Autolycos et les fils d’Autolycos, lui serrant les mains, l’accueillirent par de douces paroles ; Amphithée, la mère de sa mère, le tenant embrassé, lui baisait la tête et les yeux. Cependant le roi commande à ses illustres fils de préparer le repas ; ils obéisssent à cet ordre ; bientôt ils amènent un bœuf âgé de cinq ans ; ils entourent la victime, l’écorchent, la dépècent tout entière, et la divisent habilement en morceaux, qu’ils percent avec des broches, qu’ils rôtissent avec soin, et dont ils distribuent les parts. Durant tout le jour, et jusqu’au coucher du soleil, ils prennent le repos ; nul n’eut rien à désirer de ce festin délicieux. Lorsque le soleil disparut, que vinrent les ténèbres, ils se couchèrent, et goûtèrent les bienfaits du sommeil.
Le lendemain, dés que l’Aurore aux doigts de rose brille dans les airs, les fils d’Autolycos, suivis de leurs chiens, partent pour la chasse ; le divin Ulysse partit avec eux. Ils gravirent la haute montagne du Parnèse, couverte d’une forêt ; bientôt ils pénétrèrent dans les cavités où s’engouffrent les vents. Déjà le soleil naissant éclairait les campagnes, et s’élevait du sein paisible de l’Océan. Cependant les chasseurs s’enfoncent dans un vallon ; devant eux les chiens marchaient en cherchant la piste ; les fils d’Autolycos étaient en arrière, mais le divin Ulysse se tenait près des chiens en agitant sa longue lance. Là, dans un bois touffu, gisait un énorme sanglier ; jamais à travers cette retraite n’avait soufflé la violence des vents humides, le soleil ne la frappa jamais de ses rayons, et la pluie ne l’avait jamais pénétrée, tant elle était épaisse ; dans l’intérieur se trouvait un vaste amas de feuilles. Cependant le bruit formé par les pas des hommes et des chiens arrive jusqu’à lui, lorsque les chasseurs s’avancent ; de son repaire il court à leur rencontre. Le poil de sa tête est hérissé, la flamme est dans ses yeux ; en les regardant il s’arrête non loin d’eux. Le premier de tous, Ulysse se précipite, et d’une main vigoureuse dirige contre lui sa longue lance, impatient de le frapper ; mais le sanglier, plus prompt, le blesse au-dessous du genou. D’un coup de sa défense, s’élançant obliquement, il déchire la peau ; mais il n’atteint point jusqu’à l’os du héros. Alors Ulysse le frappe heureusement à l’épaule droite, et la pointe de la lance étincelante lui traverse le corps ; il tombe dans la poussière en mugissant, et sa vie l’abandonne. Alors les fils d’Autolycos s’empressent autour d’Ulysse ; ils bandent soigneusement la plaie, ils arrêtent le sang noir par un enchantement ; puis ils retournent aussitôt dans le palais de leur père. Autolycos et ses fils l’ayant guéri de sa blessure, et lui donnant de superbes présents, se hâtèrent de le renvoyer comblé de joie dans sa chère patrie ; le père et la mère vénérable d’Ulysse, charmés de son retour, l’interrogent sur chaque chose, et sur la blessure qu’il reçut ; le héros leur raconte avec détail comment un sanglier le frappa de sa dent d’ivoire, pendant qu’il chassait sur le Parnèse avec les fils d’Autolycus.
La vieille Euryclée ayant touché cette blessure en baissant les mains, la reconnaît, et laisse échapper le pied qu’elle tenait : la jambe retombe dans le bassin ; l’airain retentit, et le vase est renversé : toute l’eau coule sur la terre. Cependant la douleur et la joie saisissent en même temps l’âme d’Euryclée ; ses yeux se remplissent de larmes, sa faible voix est arrêtée. Enfin, portant la main jusqu’au menton du héros :
« Oui, dit-elle, vous êtes Ulysse, mon enfant chéri ; mais je n’ai pu vous reconnaître avant d’avoir touché cette blessure, qui témoigne que vous êtes mon roi. »
Elle dit, et jette les yeux sur Pénélope, voulant l’avertir que son époux est arrivé. Mais celle-ci, quoiqu’en face, ne l’aperçut pas, et ne découvrit rien : Athéna détourna l’esprit de la reine. Ulysse alors se penche vers Euryclée ; de la main droite il lui ferme la bouche, et de l’autre l’attirant à lui :
« Nourrice, dit-il, voulez-vous me perdre ? C’est vous qui m’avez nourri du lait de votre sein, et maintenant, ayant souffert bien des maux, j’arrive après vingt années dans ma patrie. Mais puisque vous avez tout découvert, et qu’un dieu déposa mon secret dans votre âme, silence, que nul autre ne l’apprenne en cette demeure. Car, je le déclare ainsi, ma menace s’accomplira : si jamais un dieu dompte sous mes coups les prétendants audacieux, bien que vous soyez ma nourrice, je ne vous épargnerai pas, lorsque j’exterminerai dans mon palais les esclaves infidèles. »
« O mon fils, repartit Euryclée, quel discours s’est échappé de vos lèvres ! Vous savez combien mon âme est constante, elle est inébranlable : je serai comme la pierre ou le fer. Mais je dois vous le dire, gravez ces paroles en votre âme : si quelque dieu dompte sous vos coups les prétendants audacieux, alors je vous désignerai les femmes qui vous méprisent et celles qui sont innocentes. »
Le sage et patient Ulysse répond ainsi :
« Nourrice, pourquoi vouloir me les désigner ? il n’en est pas besoin. Moi-même j’examinerai tout soigneusement, et découvrirai chacune d’elles ; vous, retenez vos paroles, et confiez-vous aux dieux. »
À ces mots, la vieille Euryclée quitte l’intérieur de la salle pour apporter un autre bain ; car toute l’eau du premier avait été répandue. Après avoir lavé les pieds de son maître, et les avoir parfumés d’une huile onctueuse, Ulysse approche le siège du foyer pour se réchauffer, et cache la cicatrice avec ses pauvres vêtements. Alors, recommençant l’entretien, la prudente Pénélope fait entendre ces paroles :
« Étranger, je désire vous interroger encore : voici bientôt l’heure du repos, l’instant où chacun, malgré ses peines, goûte le doux sommeil. Moi, cependant, un dieu m’accable d’une douleur sans borne ; pendant le jour, triste et gémissante, je me plais à veiller sur mes travaux et ceux de mes servantes dans cette maison ; puis lorsque la nuit arrive, que le sommeil s’empare de tous les mortels, étendue sur ma couche, mille pensées dévorantes déchirent mon triste cœur. Comme la fille de Pandaros, la jeune Aédon, chante avec mélodie au retour du printemps, assise parmi les feuilles épaisses des arbres, où sans cesse elle revient et laisse couler les nombreuses modulations de sa voix, en gémissant sur Itylos son enfant et le fils du roi Zéthos, qu’elle immola par erreur avec un fer cruel ; ainsi mon cœur est agité par deux sentiments opposés, incertaine si je resterai près de mon fils pour lui conserver intact tout son héritage, mes richesses, mes esclaves, et ce superbe palais, en respectant la couche de mon époux et ma renommée parmi le peuple, ou si je suivrai celui des Grecs qui, le plus illustre, me conduira dans sa demeure, en m’offrant de nombreux présents de noces. Tant que mon fils n’était qu’un enfant sans expérience, il ne me permettait pas de me marier, en abandonnant cette maison ; maintenant qu’il est grand, et qu’il atteint l’âge de l’adolescence, il désire que j’abandonne ces lieux s’affligeant sur ses possessions, que dévorent les Grecs. Toutefois, expliquez-moi ce songe ; écoutez. Dans ma maison vingt oies mangent le froment détrempé dans de l’eau, je me plais à les considérer ; mais, s’élançant de la montagne, un grand aigle au bec recourbé brise le cou de tous ces oiseaux, et les tue ; elles gisaient en foule dans le palais ; l’aigle remonte triomphant dans les airs. Je pleurais, je gémissais, quoique ce fût un songe ; les femmes des Grecs étaient rassemblées autour de moi, qui me lamentais de ce que l’aigle avait tué les oiseaux. Mais bientôt après cet aigle se place sur le toit élevé ; prenant alors une voix humaine, il me dit :
« Rassurez-vous, fille de l’illustre Icarios ; ce n’est point un songe, mais un présage certain, l’événement s’accomplira. Ces oiseaux sont les prétendants ; moi, j’étais l’aigle tout à l’heure, mais maintenant je suis votre époux, qui viens en ces lieux, et qui donnerai la mort à tous les prétendants. »
À ces mots, le doux sommeil m’abandonne. Alors, regardant avec attention, je vis les oies qui becquetaient le froment dans un large bassin, comme auparavant. »
« O reine, lui dit alors le sage héros, il ne faut point autrement interpréter votre songe, puisque c’est Ulysse lui-même qui vous à dit comment il s’accomplira ; le trépas apparaît à tous les prétendants, aucun d’eux n’évitera la mort et le destin. »
La prudente Pénélope lui répondit en ces mots :
« Étranger, les songes sont vains, et leurs paroles incertaines ; ils n’accordent pas aux hommes tout ce qu’ils promettent. Il existe deux portes pour les songes légers ; l’une est de corne, et l’autre est d’ivoire ; ceux qui traversent la porte d’ivoire sont trompeurs, et n’apportent que des paroles qui ne s’accomplissent pas ; ceux, au contraire, qui traversent la porte de corne prédisent la vérité, quand ils nous apparaissent. Mais je ne crois pas que le songe qui m’a frappée m’arrive de là ; ce serait un grand bonheur pour mon fils et pour moi. Toutefois, je dois vous le dire, gravez mes paroles dans votre âme : voici bientôt l’aurore funeste qui m’éloignera de la maison d’Ulysse ; mais je vais leur proposer maintenant un combat, celui des piliers de fer troués, que ce héros dans son palais alignait au nombre de douze, comme les poutres d’un navire ; puis se tenant à distance, il les traversait avec sa flèche. Maintenant je proposerai ce combat aux prétendants ; s’il en est un qui de ses mains tende facilement l’arc d’Ulysse, et fasse passer un trait dans tous les douze piliers de fer, je le suivrai, j’abandonnerai ce palais qui me reçut vierge, palais superbe, rempli d’abondantes provisions ; je m’en ressouviendrai, je pense, même dans mes songes. »
« Épouse auguste du fils de Laërte, s’écrie Ulysse aussitôt, ne différez point ce combat dans votre demeure ; Ulysse sera de retour en ces lieux avant que ces princes, en maniant l’arc étincelant, puissent tendre le nerf, et traverser avec une flèche les piliers de fer. »
« Cher étranger, reprend Pénélope, si vous vouliez me charmer encore, en restant assis dans cette chambre, le sommeil n’approcherait pas de mes yeux. Mais il n’est pas possible que les hommes restent toujours sans sommeil ; en chaque chose les dieux ont assigné des bornes aux hommes sur la terre féconde. Je vais donc, remontant dans mes appartements élevés, retrouver cette couche qui m’est devenue odieuse, et que je ne cesse d’arroser de mes larmes depuis le jour où mon époux s’embarqua pour l’infâme et funeste Ilion. C’est là que je goûterai quelque repos ; vous, étranger, couchez en ces lieux, en étendant des peaux à terre, ou bien mes serviteurs vous dresseront un lit.
En achevant ces mots, la reine monte dans ses superbes demeures, non point seule ; plusieurs suivantes accompagnent ses pas. Quand Pénélope est parvenue dans les appartements supérieurs avec les femmes qui la servent, elle pleure encore Ulysse, son époux chéri, jusqu’à ce qu’enfin Athéna envoie le doux sommeil sur ses paupières.
Fin du chant 19 de l’Odyssée
(Traduction de Jean-Baptiste Dugas-Montbel, 1835 –
Corrections Kulturica : re-hellénistation des noms propres)