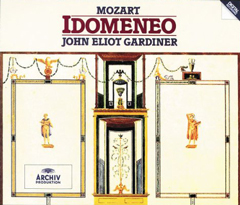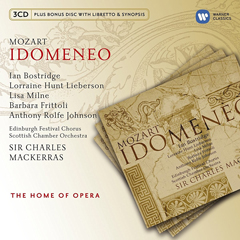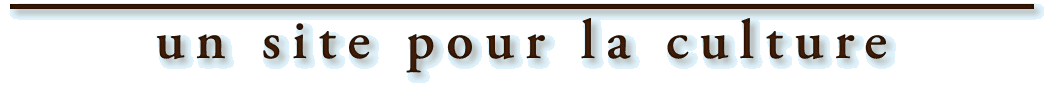1951 – Busch à Glyndebourne
Il existe plusieurs témoignages, édités sous des labels différents, de la production de Glyndebourne de 1951, sous la direction de Fritz Busch, avec Richard Lewis, Sena Jurinac, Léopold Sinoneau et Birgit Nilsson, alors à ses débuts, et dont la voix déjà immense se pliait assez mal au « moule » mozartien. Nous ne saurions les conseiller – le son est de très mauvaise qualité – qu’aux mélomanes avertis, qui en retirons malgré tout de grandes joies. Préférer, pour le moment, l’édition Immortal Performances.
Il existe également un enregistrement de studio EMI de 1951, avec Richard Lewis et Sena Jurinac sous la direction de Busch, mais sans Léopold Simoneau ni Birgit Nilsson. Il s’agit d’un CD d’extraits, à la qualité sonore nettement meilleure que les éditions précédentes – mais il ne faut pas trop espérer d’un enregistrement de 1951, même de studio – et contenant quelques pages d’anthologies, et d’autres dont les options interprétatives sont datées. Il peut constituer une alternative très satisfaisante pour qui souhaite conserver le témoignage de la « résurrection » de l’oeuvre.
1956 – Pritchard
La première version Pritchard date de 1956. C’est la production de 1951, avec un autre chef, et quelques changements de distribution, mais les perles de la création sont toujours là : Lewis, Jurinac, Simoneau. Et il est surprenant de voir à quel point le style a évolué en 5 années et à quel point cette version semble encore presque actuelle, avec ses transparences et sa dynamique. Pritchard tenait le clavecin durant les « années Busch », mais sa direction est, contrairement à ce que l’on a affirmé, très personnelle : elle est séduisante dès l’ouverture, fluide et élégante, dynamique sans être brutale, digne sans être pompeuse et légère sans être froide ni frivole. Pritchard fait partie de ces musiciens dotés d’une véritable élégance : en osmose totale avec la musique qu’ils servent, on remarque à peine qu’il y a un chef dans la fosse, d’où sans doute sa réputation de chef sans personnalité. Idamante est, comme rarement au disque, chanté par un ténor, ici, Léopold Simoneau, au delà de tout éloge. Pour notre part, Mozart a écrit le rôle d’Idamante pour un homme, un castrat dans la première version, un ténor dans la seconde, et non pour une femme (bien qu’il ait écrit par ailleurs des rôles d’hommes destinés à être chantés par des femmes – Cherubino des Nozze di Figaro, Annio de La Clemenza di Tito…). Remplacer un castrat par un mezzo relève d’une convention contemporaine qui soulève autant de questions que le remplacement par un ténor, voire un contre-ténor. La solution du ténor est plus crédible dramatiquement, et supprime tous les problèmes de confusion entre les rôles féminins. Richard Lewis est un très digne Idomeneo, son timbre est plus doux mais aussi plus mûr que celui de Simoneau, et il vit littéralement tous les dilemmes du père et du roi. Mais c’est surtout la divine Sena Jurinac qui retiendra notre attention, avec son timbre riche et sa manière de saisir le rôle d’Ilia qui défient toute description. En fait, elle n’a plus tout à fait la voix du rôle, le médium s’est épanoui depuis 1951, mais son interprétation d’Ilia en devient d’autant plus passionnante, et reste toujours crédible.
Pour beaucoup, cette version sera celle que l’on aimera et que l’on réécoutera souvent, malgré les réalisations ultérieures « objectivement meilleures », « historiquement informées », version à laquelle Kulturica décerne sa rose d’argent. Ne vous laissez pas décourager par la présentation indigente de la dernière version EMI (sortie en 2000), en coffret mince, mais au son réellement amélioré.
1977 – Böhm
La version de Karl Böhm est superbement dirigée. Elle fait appel à un ténor, Peter Schreier, pour le rôle d’Idamante et elle est la seule à offrir les scènes alternatives de la version de Vienne, des choix que nous approuvons. Malheureusement, le plateau, exclusivement germanophone, peine avec l’italien, notamment le « couple vedette » Edith Mathis-Peter Schreier, qui n’ont sans doute jamais de leur vie chanté de notes aussi vilaines. Seule Julia Varady tire son épingle du jeu et nous offre une Elettra de toute beauté, toutes griffes dehors, mais ce au détriment de l’articulation. Mieux vaut jeter un voile pudique sur le reste du plateau.
1980 – Harnoncourt
La version Harnoncourt est aussi une déception. C’était la première incursion du chef dans le domaine de l’opéra mozartien, et c’est un échec. Le chef dirige avec brutalité et sans goût un orchestre d’instruments modernes. Les voix sont toutes allemandes, et l’italien « coule mal », ce qui ralentit le rythme, et annihile la continuité dramatique. En fait, c’est une version à peine écoutable. Dommage, parce qu’avec le ballet final et le CD d’airs alternatifs (dont les KV 489 et 490) et la gavotte de l’intermezzo, on tenait la version la plus complète de l’opéra.
1987 – Pritchard
La seconde version officielle de Pritchard le montre aussi bon chef qu’en 1956, mais à Vienne, avec un plateau de grands noms des scènes internationales : Pavarotti, la perfection sonore en Idomeneo (pas seulement vocale, la diction est un enchantement), mais il n’atteint pas les sommets expressifs de Richard Lewis; Lucia Popp en Ilia, enchanteresse malgré son état de santé, servira de modèle à presque toutes les Ilia qui suivront. Elle est l’incarnation moderne de l’idéal féminin de Mozart, jeunesse et féminité, capable d’amour et de courage, une soeur jumelle de la Tamina de la Flûte enchantée; Edita Gruberova nous offre une Elettra très juste dramatiquement; très bel Idamante de Baltsa, au timbre magnifiquement androgyne dans les graves, mais les aigus se confondent parfois avec ceux d’Ilia et d’Elettra.
N.B : Il existe un troisième enregistrement dirigé par Pritchard, avec Pavarotti cette fois en Idamante; nous retrouvons avec grand plaisir le merveilleux Idomeneo de Richard Lewis; Gundula Janowitz est une Ilia douce et innocente (mais l’Elettra est très décevante) : un enregistrement « pirate » de 1964, que l’on peut se procurer, dans la meilleure qualité sonore possible, chez OperaDepot.
1990 – Gardiner
Dans la version Gardiner, le manque de sens dramatique du chef se révèle un peu moins gênant que d’habitude, parce qu’il s’agit d’un composite de plusieurs soirées (mais on se demande pourquoi il n’y a aucun bruit de scène ni applaudissement). Sur le plan sonore, c’est de toute beauté, à commencer par le Monteverdi Choir et une orchestre de grande qualité, von Otter dans un rôle qu’elle investit parfaitement stylistiquement, Sylvia McNair, malgré quelques fausses notes dans les récitatifs, toutes excusées par la tension dramatique, dans une tessiture très semblable à celle de Lucia Popp, mais avec plus de dynamique et d’« abandon », le très bel Idomeneo d’Anthony Rolfe-Johnson, qui a toujours été à l’aise dans les répertoires baroque et mozartien, et Hillevi Martinpelto, alors presque à ses débuts et qui s’est révélée excellente mozartienne. Grâce à cette distribution, cette version devrait satisfaire qui veut son Idomeneo sur instruments anciens. Mais, comme toujours avec Gardiner, il faudra passer par des tunnels d’ennui, comme la quasi-totalité du second acte, heureusement le plus court de l’opéra.
1994 – Levine
Levine, qui a fait de l’orchestre du Met l’une des meilleures phalanges d’opéra au monde, aurait-il dû diriger Idomeneo ? Non, diraient les spécialistes. Et ils auraient raison : Levine n’a a priori que peu d’affinités avec le style mozartien. Mais qu’importe : Monsieur Levine était un chef d’opéra et Idomeneo est un opéra. Alors où est le problème ? Levine saisit ce drame musical, sans jamais le lâcher, comme il le ferait pour le Trouvère ou la Tosca. Et, malgré le studio et ses inévitables coupures, raccords, reprises, Levine tient fermement l’action, dans un continuum dramatique qui nous emporte, éblouis, au paradis de l’opéra où le facteur temps est inexistant. De Mozart à Puccini, en passant par Wagner et Tchaïkovski, ils sont tous contemporains et éternels, et, pour paraphraser Einstein, « celui qui est emporté dans le temps ne le sent pas passer ». Admirable est le timbre de Domingo, au sommet de sa maturité, riche, superbe sans complaisance ni étalage (mais on peut s’étonner qu’un musicien aussi accompli réussisse aussi mal ses vocalises). On regrette (mais le regrette-t-on vraiment ?) la chair toute féminine de la voix de la Bartoli, qui ne trompe personne en Idamante, et l’on se réjouit qu’à cette époque, elle ne réduisait pas sa voix en petits filets, mais laissait couler généreusement de sa bouche l’or liquide de son timbre splendide. Carol Vaness, un mozartienne accomplie, une très grande dame du chant, méconnue, dont on ne se lasse jamais, compose une Elettra au bord de la rupture. Pour Ilia, Levine a choisi Heidi Grant Murphy, membre du Met, qui incarne très bien la douceur et la vaillance de la « petite femme mozartienne ». Les autres rôles, souvent sacrifiés, sont magnifiquement tenus par Hampson, Lopardo et Terfel, le grand luxe. Les tenants d’un certain style mozartien feraient toutefois mieux de se tenir à l’écart de cet enregistrement, très épicé.
2001 – Mackerras
Semi déception avec Mackerras, malgré le génie du chef qui nous offre, avec Pritchard et Böhm, l’une des plus belles directions de cette discographie et une version très complète – manquent seulement les KV 489 et 490. Il est clair que Ian Bostridge n’a pas le timbre d’un Idomeneo : on ne passe pas 9 ans à la guerre de Troie sans détruire cette beauté juvénile, ces accents pleins de grâce et d’émotion. Par contre, il aurait fait un Idamante de rêve. Y aurait-il eut le projet d’enregistrer la version de Vienne de 1786 ? Anthony Rolfe-Johson est surdimensionné pour le rôle d’Arbace et aurait sans doute repris avec autant de succès le rôle-titre qu’il avait magnfiquement chanté pour Gardiner, malgré quelques instabilités dans les récitatifs. Lorraine Hunt, qui allait s’éloigner de la scène pour raison de santé un peu plus tard, paraît éteinte en Idamante. Lisa Milne, jeune soprano écossaise preque inconnue, en Ilia, est une bonne surprise, mais Barbara Frittoli, en Elettra, en est une bien meilleure encore. Quelle classe, quel style, quelle science et quelle beauté ! Barbara Frittoli est réellement l’une des meilleures chanteuses de notre temps et surpasse aisément les stars surmédiatisées des majors.
2008 – Jacobs
Déception encore plus grande avec René Jacobs. Mieux vaut l’entendre dans La Clemenza di Tito, qu’il réussit beaucoup mieux. Ici, entre l’orchestre de cirque (les cuivres et les percussions jouent plusieurs tons plus fort que les cordes et les bois), qui n’arrive pas à suivre le rythme parfois endiablé qu’on lui impose et savonne ses doubles-croches, le « pianoforte bastringue » (alors la partition indique que la basse continue des récitatifs doit être tenue par un clavecin et un violoncelle), les flagrantes erreurs de distribution (à commencer par l’Elettra spectaculaire mais caricaturale de Pendachanska), et toutes sortes de partis pris, on peine à poursuivre l’écoute. Dommage, car les ailes de la grâce caressent cet enregistrement à de nombreuses reprises, chaque fois que Jacobs oublie son désir d’étonner pour être « l’umile ancello del genio creatore ».
Malgré quelques réalisations enthousiasmantes, la version idéale d’Idomeneo n’a pas encore été enregistrée. Cette revue discographique montre que cet opera seria n’est pas l’apanage du mouvement baroque, et que des chefs « traditionnels » peuvent y exceller. Nous rêvons d’un Idamante ténor, ou contre-ténor, pour le respect de la vérité dramatique. Nous rêvons aussi des KV 489 et 490, beaucoup plus beaux que les airs qu’ils remplacent et qui subliment l’amour que se portent Ilia et Idamante. Nous rêvons d’un plateau avec quelques italiens pour la diction. Nous rêvons d’un orchestre léger et virtuose, comme l’Orchestra of the Age of the Enlightenment ou le Mahler Chamber Orchestra, que Barbara Frittoli revienne chanter Elettra, que l’on retrouve la partition de la version de Vienne… Est-ce trop demander ?