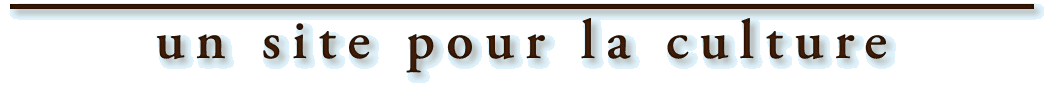L’Iliade et l’Odyssée dans la traduction de Jean-Baptiste Dugas-Montbel
L’Iliade : Chant 1 • Chant 2 • Chant 3 • Chant 4 • Chant 5 • Chant 6 • Chant 7 • Chant 8 • Chant 9 • Chant 10 • Chant 11 • Chant 12 • Chant 13 • Chant 14 • Chant 15 • Chant 16 • Chant 17 • Chant 18 • Chant 19 • Chant 20 • Chant 21 • Chant 22 • Chant 23 • Chant 24
L’Odyssée : Chant 1 • Chant 2 • Chant 3 • Chant 4 • Chant 5 • Chant 6 • Chant 7 • Chant 8 • Chant 9 • Chant 10 • Chant 11 • Chant 12 • Chant 13 • Chant 14 • Chant 15 • Chant 16 • Chant 17 • Chant 18 • Chant 19 • Chant 20 • Chant 21 • Chant 22 • Chant 23 • Chant 24
Récits chez Alcinoos. – Cyclopée.

Ulysse et ses compagnons, mosaïque du musée du Bardo à Tunis
Alors l’ingénieux Ulysse lui répondit en ces mots : « Puissant Alcinoos, et le plus illustre parmi tous ces peuples, combien il est doux d’entendre un tel chanteur, qui par le charme de sa voix est égal aux dieux. Non, sans doute, on ne peut, je pense, se proposer de but plus agréable que de voir la joie régner parmi tout un peuple, de voir ces convives écoutant un chanteur dans le palais, tous assis en ordre autour des tables chargées de pains et de viandes, tandis que l’échanson puise le vin dans les urnes et le porte pour remplir les coupes ; c’est là ce qui dans mon âme me paraît le plus beau. Mais puisque votre désir est d’apprendre mes lamentables infortunes, il faut que je soupire encore en versant des larmes. Par où commencer, et comment terminer ce récit ? Les dieux du ciel m’ont accablé de bien des douleurs. Maintenant donc je vous dirai mon nom, afin que vous le connaissiez ; car si j’évite le jour funeste, je veux être votre hôte, quoique habitant des demeures lontaines.
Je suis le fils de Laërte, Ulysse, qui par mes stratagèmes me suis fait connaître à tous les hommes, et dont la gloire est montée jusqu’aux cieux. J’habite l’occidentale Ithaque ; dans cette île est une superbe montagne, le Néritos, couvert d’arbres ; tout autour sont des îles nombreuses et rapprochées entre elles : Dulichios, Samé, Zacynthos ombragée de forêts ; Ithaque, dont le rivage s’élève à peine au sein de la mer, et la plus rapprochée du couchant (les autres sont en face de l’aurore et du soleil), est couverte de rochers ; mais elle nourrit une jeunesse vigoureuse. Je ne puis voir un autre lieu qui me soit plus doux que mon pays. La nymphe Calypso m’a longtemps retenu dans ses grottes profondes, désirant avec ardeur que je devinsse son époux ; de même l’astucieuse Circé, qui règne dans l’île d’Éa, m’a retenu dans son palais, désirant aussi que je fusse son époux ; mais elles ne persuadèrent point mon cœur. Non, rien n’est plus cher à l’homme que sa patrie et ses parents, quand bien même il habiterait une riche demeure dans une terre étrangère, loin de sa famille. Mais, puisque vous le désirez, je vous raconterai mon retour, avec tous les maux que m’envoya Zeus quand je partis de Troie.
« En quittant Ilion, les vents me portèrent dans le pays des Ciconiens, vers la ville d’Ismaros ; je ravageai cette ville, et fis périr ses habitants. Ayant enlevé leurs épouses et de nombreuses richesses, nous fîmes le partage, et nul ne se retira sans avoir une part égale. Je les exhortais à fuir d’un pied rapide ; mais les insensés ne m’obéirent pas. Là, buvant le vin en abondance, ils immolaient sur le rivage de nombreux troupeaux de bœufs et de brebis. Pendant ce temps, quelques Ciconiens s’étant enfuis, appellent d’autres Ciconiens leurs voisins les plus proches et les plus vaillants, habitant l’intérieur des terres, sachant sur un char combattre leurs ennemis, et les attendre aussi de pied ferme. Dès le point du jour ils accourent, aussi nombreux que les feuilles et les fleurs dans la saison du printemps ; alors la funeste destinée de Zeus s’attache à nous, malheureux, pour nous faire souffrir bien des maux. Rangés en ordre, ils nous livrent le combat devant les navires, et tour à tour nous attaquent de leur lances d’airain. Durant tout le matin, et tant que s’élève l’astre sacré du jour, nous résistons à nos ennemis, quoique supérieurs en nombre ; mais quand le soleil décline, et ramène l’heure où l’on délie les bœufs, les Ciconiens fondent sur les Grecs, et les mettent en fuite. Chacun de mes vaisseaux perdit six guerriers, les autres échappèrent à la mort.
« Nous nous rembarquons, heureux d’éviter le trépas, mais le cœur navré d’avoir perdu nos compagnons. Cependant nos larges navires ne s’éloignent pas sans que nous ayons appelé trois fois les amis infortunés qui périrent sur ce rivage, vaincus par les Ciconiens. Alors le puissant Zeus excite contre nous le vent Borée, accompagné d’une affreuse tempête, et cache sous d’épais nuages la terre et les ondes ; la nuit tout à coup tombe des cieux. Nos vaisseaux sont emportés au loin sans direction, et les voiles sont déchirées en lambeaux par la violence du vent ; nous les déposons dans les navires pour éviter la mort, et nous dirigeons aussitôt la flotte vers le plus prochain continent. Pendant deux jours et deux nuits nous restons sur cette rive, en nous rongeant le cœur de douleurs et de tourments. Mais lorsque l’Aurore à la belle chevelure eut ramené le troisième jour, nous dressons les mâts, nous déployons les voiles, et remontons dans les vaisseaux, que guident le vent et les pilotes. J’espérais enfin arriver heureusement aux terres de la patrie, lorsqu’on doublant le cap Malée, Borée et les rapides courants de la mer me repoussent et m’éloignent de Cythère.
« Pendant neuf jours je fus emporté par les vents contraires sur la mer poissonneuse ; mais le dixième j’abordai dans le pays des Lotophages, qui se nourrissent de la fleur d’une plante. Nous descendons sur le rivage, et nous puisons l’eau des fontaines ; mes compagnons ensuite prennent le repas près des navires. Quand nous avons achevé de manger et de boire, je résolus d’envoyer mes compagnons à la découverte, en choisissant d’eux d’entre eux ; le troisième qui les accompagnait était un héraut, pour s’informer quels peuples en ces lieux se nourrissaient des fruits de la terre. Ceux-ci donc étant partis se mêlèrent aux peuples lotophages ; mais les Lotophages ne méditèrent point la mort de nos compagnons, et leur donnèrent à goûter du lotos. Ceux d’entre eux qui mangeaient le doux fruit du lotos ne voulaient plus venir rendre compte du message ni retourner, mais ils désiraient, au contraire, rester parmi les peuples lotophages, et pour se nourrir du lotos ils oubliaient le retour. Cependant je les contraignis de remonter en pleurant dans les navires, et je les attachai sur les bancs des rameurs. J’ordonne à l’instant à mes autres compagnons de monter sur les vaisseaux légers, de peur qu’eux-mêmes, en mangeant du lotos, n’oubliassent aussi le retour. Ils montent aussitôt, se placent sur les bancs, et tous assis en ordre ils frappent de leurs rames la mer blanchissante.
« Loin de ces lieux nous recommençons à naviguer, le cœur navré de douleur. Nous arrivâmes ensuite dans le pays des violents Cyclopes, qui vivent sans lois, et qui, se confiant aux dieux immortels, ne sèment aucune plante de leurs mains et ne labourent pas ; mais là toutes choses poussent sans être semées ni cultivées : la pluie de Zeus fait croître pour eux l’orge, le froment, et les vignes, qui, chargées de grappes, donnent un vin délicieux. Ils n’ont point d’assemblées, ni pour tenir le conseil ni pour rendre la justice ; mais ils vivent sur les sommets des montagnes, dans des grottes profondes ; chacun d’eux gouverne ses enfants et son épouse, ne prenant aucun soin les uns des autres.
« Vis-à-vis du port, ni trop près, ni trop loin du pays des Cyclopes, est une île de peu d’étendue, et couverte de forêts ; là naissent en foule des chèvres sauvages, car les pas des hommes ne les mettent point en fuite. Cette île n’est point visitée par les chasseurs, qui supportent tant de fatigues dans les bois en parcourant les sommets des montagnes ; elle n’est point habitée par des bergers ni par des laboureurs, mais privée d’hommes, elle reste toujours sans semence et sans culture, et nourrit seulement des chèvres bêlantes. Car chez les Cyclopes il n’est point de navires aux proues de vermillon, chez eux point d’ouvriers qui construisent de larges vaisseaux, avec lesquels on accomplit chaque chose et l’on visite les cités des peuples ; tels sont les desseins nombreux qu’exécutent les hommes en traversant les mers. Ainsi les Cyclopes auraient pu cultiver cette île et la rendre habitable : elle n’est point stérile, et porterait des fruits en toute saison. Là, sur le rivage de la mer blanchissante, s’étendent des prairies humides et touffues ; les plants des vignes y seraient surtout d’une longue durée. Elle est d’un facile labourage ; on y recueillerait dans la saison une moisson abondante, parce que le sol est gras et fertile. Cette île possède encore un port commode, où jamais il n’est besoin de cordage, où l’on ne jette point l’ancre, où nul lien n’attache les navires ; et quand ils abordent en ces lieux, ils y restent jusqu’à ce que les nautoniers désirent partir et que les vents viennent à souffler. À l’extrémité de ce port coule une onde limpide, la fontaine est sous une grotte ; tout autour s’élèvent des peupliers. C’est là que nous arrivâmes, et qu’un dieu nous conduisit durant la nuit obscure : nul objet ne frappait alors notre vue ; un épais brouillard enveloppait nos vaisseaux, et la lune ne brillait pas dans les cieux ; elle était cachée par les nuages. Aucun d’entre nous n’avait découvert cette île ; même nous n’aperçûmes point les vagues énormes qui se roulaient sur le rivage, avant que d’être abordés sur nos larges navires. Dès qu’ils sont entrés, nous plions les voiles, puis nous descendons sur le bord de la mer, et là nous nous endormons en attendant le retour de l’aurore.
« Le lendemain, aux premiers rayons du jour, nous parcourons cette île, et nous en sommes ravis d’admiration. Alors les nymphes, filles du puissant Zeus, nous envoient les chèvres des montagnes pour le repas de mes compagnons. Aussitôt nous apportons de nos vaisseaux les arcs recourbés, les longs javelots, et, partagés en trois bandes, nous lançons nos traits ; bientôt un dieu nous accorde en peu de temps une chasse abondante. Douze vaisseaux m’avaient suivi ; chacun d’eux obtint neuf chèvres en partage ; mes compagnons en choisirent dix pour moi seul. Pendant tout le jour, jusqu’au coucher du soleil, nous savourons les mets abondants et le vin délectable. Le vin de nos navires n’était point épuisé, mais il en restait encore ; car nous en puisâmes une grande quantité dans nos urnes quand nous ravageâmes la ville des Ciconiens. Cependant nous découvrions à peu de distance la fumée qui s’élevait dans le pays des Cyclopes, et nous entendions leurs voix mêlées aux bêlements des chèvres et des brebis. Quand le soleil eut terminé sa carrière, et que vinrent les ténèbres du soir, nous nous couchâmes sur le rivage de la mer. Dès le retour de la brillante aurore je rassemble tous les miens, et leur dis :
« Restez en ces lieux, ô mes compagnons fidèles ; moi cependant, avec ceux qui montent mon navire, j’irai m’informer quels sont ces hommes ; s’ils sont cruels, sauvages, sans justice, ou s’ils sont hospitaliers, et si leur âme respecte les dieux. »
« En achevant ces mots, je monte dans le vaisseau, j’ordonne à mes compagnons de me suivre et de délier les cordages. Aussitôt ils montent dans le navire, se placent sur les bancs, et tous, assis en ordre, ils frappent de leurs rames la mer blanchissante. Lorsque nous touchons au pays dont nous étions si près, nous apercevons à l’extrémité du port, près de la mer, une grotte élevée, ombragée de lauriers : là reposaient de nombreux troupeaux de chèvres et de brebis ; la cour était fermée par une enceinte de rochers enfoncés dans la terre, par de grands pins et des chênes à la haute chevelure. C’est là que demeurait un homme énorme, qui, seul, faisait paître au loin ses troupeaux ; il ne fréquentait point les autres Cyclopes, mais, toujours à l’écart, il ne connaissait que la violence. C’était un monstre horrible, non semblable à l’homme qui se nourrit de blé, mais au sommet boisé des hautes montagnes, il paraissait au-dessus de tous les autres.
« Je dis à mes compagnons de rester dans le navire pour le garder ; seulement, en choisissant douze des plus vaillants, je m’éloignai ; je pris cependant une outre de peau de chèvre remplie d’un vin délicieux, que me donna Maron, fils d’Évanthéos, prêtre d’Apollon, demeurant dans la ville d’Ismaros, parce que, pleins de respect, nous le protégeâmes, lui, sa femme et ses enfants. Il habitait le bois sacré du brillant Apollon. Il me combla de présents magnifiques ; il me donna sept talents d’un or choisi, puis une coupe toute d’argent, et remplit ensuite douze urnes d’un vin délectable et pur, breuvage divin. Nul dans sa maison, ni ses esclaves, ni ses serviteurs, ne connaissait ce vin, mais lui seul, sa femme, et l’intendante du palais. Lorsqu’il buvait de cette liqueur délicieuse et colorée, ne remplissant qu’une coupe, il la versait sur vingt mesures d’eau ; du cratère alors s’exhalait un suave et divin parfum ; nul ne pouvait résister à ce charme. J’emportai donc cette outre pleine, et dans un sac de cuir je mis des provisions ; car déjà je pensais au fond de mon cœur que je rencontrerais un homme d’une force immense, un cruel, qui ne connaissait ni la justice ni les lois.
« Bientôt nous arrivons à son antre ; nous ne l’y trouvons point, il avait conduit aux pâturages ses gras troupeaux. Alors, pénétrant dans la caverne, nous admirons chaque chose : les paniers de jonc étaient chargés de fromages, les chevreaux et les agneaux remplissaient la bergerie, mais ils étaient séparés dans différentes enceintes ; d’abord ceux qui naquirent les premiers, puis les moins grands, enfin ceux qui ne venaient que de naître ; tous les vases, ceux qui contenaient le petit-lait, les terrines et les bassines où le Cyclope trayait ses troupeaux, étaient rangés en ordre. Mes compagnons me suppliaient de prendre quelques fromages, et de retourner ; ils m’exhortaient d’enlever promptement des chèvres, des brebis, de les conduire dans le navire, et de franchir l’onde amère : je ne me laissai point persuader (c’était pourtant le parti le plus sage), parce que je voulais voir le Cyclope, et savoir s’il m’accorderait les dons de l’hospitalité ; mais sa présence ne devait pas être heureuse à mes compagnons.
« Ayant allumé le feu, nous faisons les sacrifices, puis ayant pris quelques fromages, nous les mangeons ; et, restant assis dans l’intérieur de la caverne, nous attendîmes jusqu’au moment où le Cyclope arriva des champs. Il portait un énorme fardeau de bois desséché pour apprêter son repas. Il le jette en dehors de la caverne, et sa chute produisit un grand bruit ; épouvantés, nous fuyons jusqu’au fond de l’antre. Alors il fait entrer dans cette large grotte ses troupeaux, tous ceux du moins qu’il veut traire, et laisse les mâles à l’entrée, les boucs et les béliers restent en dehors de la vaste cour. Cependant, pour fermer sa demeure il soulève un énorme rocher : vingt-deux forts chariots à quatre roues n’auraient pu l’arracher du sol, tant était immense cette pierre qu’il place à l’entrée de la cour. S’étant assis, il trait avec le plus grand soin ses brebis, ses chèvres bêlantes, et rend ensuite les agneaux à leurs mères. Puis laissant cailler la moitié de ce lait, il le dépose dans des corbeilles tressées avec soin, et met l’autre moitié dans des vases pour se désaltérer et pour être son repas du soir. Après avoir en toute hâte terminé ces apprêts, il allume alors du feu, nous aperçoit, et nous dit :
« Étrangers, qui donc êtes-vous ? D’où venez-vous à travers les plaines humides ? Est-ce pour votre négoce, ou sans dessein errez-vous comme des pirates qui parcourent les mers en exposant leur vie et portant le ravage chez les étrangers ? »
Il dit ; nos cœurs sont brisés, nous frémissons de cette voix formidable et de cet affreux colosse. Moi cependant je lui réponds en ces mots :
« Nous sommes des Grecs, qui depuis notre départ d’Ilion, emportés par les vents contraires, avons parcouru la vaste étendue de la mer, et quoique désireux de notre patrie, nous arrivons ici détournés de notre route, et suivant d’autres sentiers ; ainsi l’a voulu Zeus. Nous nous glorifions d’être les soldats d’Agamemnon, fils d’Atrée, dont aujourd’hui la gloire est immense sous la voûte des cieux, tant est grande la ville qu’il a renversée et nombreux les peuples qu’il a vaincus ; nous, cependant, venons embrasser vos genoux, afin que vous nous donniez le présent d’hospitalité, du moins que vous nous accordiez quelque subsistance, comme il est juste de l’offrir aux étrangers. Puissant héros, respectez les dieux; nous sommes vos suppliants. Zeus hospitalier est le vengeur des suppliants et des hôtes ; il accompagne les étrangers qui sont dignes de respects. »
Telles furent mes paroles ; mais lui, sans pitié, me répond aussitôt :
« Étranger, tu perds la raison, ou tu viens de loin, toi qui m’ordonnes de craindre et de respecter les dieux. Les Cyclopes ne s’inquiètent point de Zeus ni de tous les immortels ; nous sommes plus puissants que les dieux fortunés. Pour éviter le courroux de Zeus, je n’épargnerai ni toi ni tes compagnons, si tel n’est point mon désir. Mais dis-moi maintenant où tu laissas ton navire ; apprends-moi s’il est à l’extrémité de l’île, ou près d’ici, pour que je le sache. »
C’est ainsi qu’il me parlait en m’éprouvant ; mais je n’oubliai point mes nombreuses ruses : je lui répondis à mon tour par ces paroles trompeuses :
« Le puissant Poséidon a brisé mon navire, en le jetant contre un rocher, au moment où j’allais toucher le promontoire qui s’élève sur les bords de votre île, et le vent, sur les flots, en a dispersé les débris ; moi seul avec ces compagnons avons évité le trépas. »
« Je parlais ainsi ; le cruel ne répond point à ce discours, mais, s’élançant, il porte ses mains sur mes compagnons, en saisit deux, et les écrase contre la pierre comme de jeunes faons ; leur cervelle coule à terre, elle inonde le sol. Alors, divisant les membres palpitants, il prépare son repas, et mange, semblable au lion des montagnes, sans laisser aucun vestige ni de la chair, ni des entrailles, ni des os remplis de moelle. À la vue de ces horribles forfaits, nous élevons en pleurant les mains vers Zeus, et le désespoir s’empare de nos âmes. Quand le Cyclope a rempli son vaste corps, en dévorant la chair humaine, il boit un lait pur, et se couche dans la caverne, étendu parmi ses troupeaux. Moi, cependant, je voulais en mon cœur magnanime, m’approchant de ce monstre, et tirant le glaive que je portais à mon côté, le frapper dans le sein, à l’endroit où les muscles retiennent le foie, et le terrasser de ma main ; mais une autre pensée m’arrêta. Nous périssions là d’une mort affreuse ; car avec nos bras nous ne pouvions enlever l’énorme pierre qu’il avait placée devant la porte. Nous attendîmes donc en soupirant le retour de la divine Aurore.
« Le lendemain, aux premiers rayons du jour, le Cyclope allume du feu, trait ses superbes troupeaux, dispose tout avec ordre, et rend ensuite les agneaux à leurs mères. Après avoir en grande hâte terminé ces apprêts, saisissant de nouveau deux de mes compagnons, il en fait son repas. Ce repas achevé, le monstre chasse hors de l’antre ses grasses brebis, en enlevant sans effort la porte immense ; puis il la replace, comme il aurait placé le couvercle d’un carquois. Le Cyclope alors, au son d’un long sifflement, conduit ses grasses brebis sur la montagne. Moi cependant j’étais resté, méditant d’affreux desseins, afin de me venger, si Athéna m’en accordait la gloire. Voici le parti qui, dans mon âme, me sembla le meilleur. Le Cyclope au fond de l’étable avait placé l’énorme branche d’un verdoyant olivier, qu’il avait coupée pour s’en servir quand elle serait desséchée ; nous la comparions au mât d’un large et pesant navire de vingt rames qui doit un jour sillonner les vastes ondes ; telles nous apparurent et sa grosseur et sa hauteur. J’en coupe environ trois coudées, puis je donne cette branche à mes compagnons, et leur commande de la dégrossir : ceux-ci la rendent très-unie ; j’en aiguise aussitôt la pointe, et pour la durcir je la passe à la flamme étincelante. Alors je la dépose avec soin et la cache sous un grand tas de fumier qui fut avec abondance amoncelé dans la bergerie.
J’ordonne ensuite à mes compagnons de tirer au sort ceux qui d’entre eux oseront avec moi plonger ce pieu dans l’œil du Cyclope quand il goûtera le doux sommeil. Les quatre que désigne le sort, moi-même j’aurais voulu les choisir ; je faisais le cinquième avec eux. Vers le soir, il revient conduisant ses brebis à la toison éclatante ; il pousse dans l’intérieur ses gras troupeaux ; ils entrent tous, et le Cyclope n’en laisse aucun en dehors de la cour, soit que lui-même en eût conçu le dessein, soit qu’un dieu l’eût ainsi voulu. Puis, en la soulevant, il replace la porte immense, et s’étant assis, il trait ses brebis, ses chèvres bêlantes, dispose tout avec ordre, et rend ensuite les agneaux à leurs mères. Après avoir en grande hâte terminé ces apprêts, saisissant de nouveau deux de mes compagnons, il en fait son repas. En ce moment je m’approche de lui, tenant dans mes mains une écuelle de lierre remplie d’un vin délicieux, et je lui dis :
« Cyclope, tenez, buvez de ce vin, après avoir mangé de la chair humaine ; afin que vous sachiez quel breuvage j’avais caché dans mon navire, je vous en apporte comme une libation, dans l’espoir que, prenant pitié de moi, vous me renverrez dans ma patrie ; vos fureurs n’ont-elles donc point de mesure, insensé ? Qui désormais parmi les hommes voudra venir en ces lieux ? Vous agissez contre toute justice. »
C’est ainsi que je parlais ; lui prend la coupe, et boit ; il goûte un vif plaisir en savourant ce doux breuvage, et m’en demande une seconde fois :
« Pour moi bienveillant, verse encore, et maintenant dis-moi tout de suite quel est ton nom, afin que je te donne un présent d’hospitalité qui te réjouisse. La terre féconde produit aux Cyclopes la vigne et ses belles grappes que fait croître pour eux la pluie de Zeus ; mais ce breuvage est une émanation du nectar et de l’ambroise. »
Il dit ; aussitôt je lui verse de cette liqueur étincelante ; trois fois j’en donne au Cyclope, et trois fois il en boit sans mesure. Cependant aussitôt que le vin s’est emparé de ses esprits, je lui dis ces douces paroles :
« Cyclope, vous me demandez mon nom : je vais vous le dire; mais vous, donnez-moi le présent d’hospitalité, comme vous l’avez promis. Mon nom est Personne ; c’est Personne que m’appellent mon père, ma mère, et tous mes compagnons. »
Telles furent mes paroles ; mais lui me répond avec la même férocité :
« Personne, je te mangerai le dernier, après tes compagnons ; les autres périront auparavant ; tel sera pour toi le présent d’hospitalité. »
En parlant ainsi, le Cyclope tombe étendu sur le dos ; son énorme cou reste incliné sur ses épaules ; et le sommeil, qui dompte tout ce qui respire, s’empare de lui ; de sa bouche s’échappent le vin et les lambeaux de chair humaine, il les rejette dans sa pesante ivresse. Alors j’introduis le pieu sous une cendre abondante pour le rendre brûlant ; et par mes discours j’encourage mes compagnons, de peur qu’effrayés ils ne m’abandonnent. Sitôt que la branche d’olivier doit être assez échauffée, et quoique verte, lorsqu’elle brille déjà d’une vive flamme, je la retire du foyer, et mes compagnons restent autour de moi ; sans doute un dieu m’inspira cette audace. Eux cependant, saisissant cette branche d’olivier acérée par la pointe, l’enfoncent dans l’œil du Cyclope ; et moi, m’appuyant au-dessus, je la faisais tourner. Ainsi lorsqu’un homme perce avec une tarière la poutre d’un navire, au-dessous de lui, d’autres ouvriers, tirant une courroie des deux côtés, précipitent le mouvement, et l’instrument tourne sans s’arrêter : de même nous faisons tourner la branche embrasée dans l’œil du Cyclope, et le sang ruisselle autour de ce pieu. Une ardente vapeur dévore les sourcils et les paupières, la prunelle est toute consumée ; ses racines crient, déchirées par la flamme. Ainsi quand un forgeron, trempant le fer, car c’est là que réside sa force, plonge dans l’onde glacée une forte hache, ou bien une doloire, elle frémit à grand bruit ; de même siffle son œil percé par la branche d’olivier. Le Cyclope alors pousse d’affreux hurlements; tout le rocher en retentit; nous fuyons en tremblant. Il arrache de son œil ce bois dégouttant de sang ; ensuite de sa main il le rejette loin de lui. Cependant il appelle à grands cris les autres Cyclopes, habitant dans des grottes sur les sommets exposés au vent. Eux entendant ces cris, accourent de toutes parts ; et, se tenant à l’entrée de la grotte, ils lui demandent ce qui l’afflige : « Pourquoi, Polyphème, pousser ainsi de tristes clameurs durant la nuit et nous arracher au sommeil ? Quelqu’un parmi les mortels t’aurait-il enlevé, malgré toi, tes troupeaux ? quel qu’un t’aurait-il dompté par ruse ou par violence ? »
Polyphème du fond de son antre répond en ces mots : « Mes amis, Personne m’a dompté par ruse et non par force. »
Les Cyclopes lui répondent aussitôt : « Puisque nul homme ne t’outrage dans ta solitude, il n’est pas possible d’écarter les maux que t’envoie le grand Zeus ; mais adresse tes vœux à ton père, le puissant Poséidon. »
À ces mots tous les Cyclopes s’éloignent ; moi cependant je riais au fond de mon cœur en voyant comme ils étaient trompés par ce nom et par ma prudence irréprochable. Alors le Cyclope en soupirant, et souffrant de vives douleurs, tâtonne avec ses mains, et saisit la pierre qui fermait l’entrée ; puis, s’asseyant devant la porte, il étend ses mains, afin de prendre quiconque voudrait s’échapper en se confondant avec les troupeaux ; c’est ainsi qu’il espérait en son âme que j’étais un insensé. Cependant je songeais à trouver quel serait le meilleur moyen d’arracher mes compagnons à la mort, et de l’éviter moi-même ; j’imaginais mille ruses, mille stratagèmes, car notre vie en dépendait ; un grand danger nous menaçait. Voici, dans ma pensée, le parti qui me sembla préférable. Là se trouvaient de gras béliers, à l’épaisse toison, grands, beaux et couverts d’une laine noire ; je les lie avec les osiers flexibles sur lesquels dormait le Cyclope, monstre terrible, habile en cruautés, et je réunis ensemble trois de ces béliers ; celui du milieu portait un homme, et de chaque côté se tenaient les deux autres, qui protégeaient la fuite de mes compagnons. Ainsi trois béliers sont destinés à porter un homme ; pour moi, comme il restait le plus beau bélier de tous ces troupeaux, je le saisis par le dos, et me glissant sous son ventre, je m’attache à sa laine ; de mes deux mains je tenais avec force cette épaisse toison, et d’un cœur inébranlable j’y restais suspendu. C’est ainsi qu’en soupirant nous attendîmes le retour de la divine Aurore.
Dès que l’Aurore a brillé dans les cieux, les béliers sortent pour se rendre aux pâturages, et les brebis, que le Cyclope n’avait pu traire, bêlaient dans l’intérieur de la grotte, car leurs mamelles étaient chargées de lait. Le roi de cet antre, tourmenté par de vives douleurs, passe la main sur le dos des béliers qui s’élevaient au-dessus des autres ; mais l’insensé ne soupçonnait pas que sous leur ventre touffu mes compagnons étaient attachés. Enfin, le dernier de tous, le plus beau bélier du troupeau, franchit la porte à la fois chargé de son épaisse toison et de moi, qui conçus un dessein plein de prudence. Alors le terrible Polyphème, le caressant de la main, lui parle en ces mots :
« Cher bélier, pourquoi donc ainsi sors-tu le dernier de ma grotte ? Jamais auparavant tu ne restais en arrière des brebis ; le premier tu paissais les tendres fleurs de la prairie, en marchant à grands pas, et le premier tu parvenais aux courants du fleuve, le premier, enfin, tu te hâtais de rentrer dans l’étable quand venait le soir ; aujourd’hui cependant te voilà le dernier de tous. Regretterais-tu l’œil de ton maître ? Un vil mortel, aidé de ses odieux compagnons, m’a privé de la vue, après avoir dompté mes sens par la force du vin, Personne, qui, je l’espère, n’évitera pas longtemps le trépas. Puisque tu partages mes peines, que n’es-tu doué de la parole, pour me dire où cet homme se dérobe à ma fureur : à l’instant, le crâne brisé contre le sol, sa cervelle serait répandue de toutes parts dans cette caverne ; du moins alors mon cœur serait un peu soulagé de tous les maux que m’a causés ce misérable Personne. »
En achevant ces paroles, il pousse le bélier loin de la porte. Quand nous sommes à quelque distance de la grotte et de la cour, le premier, je me détache de dessous le bélier, et délie ensuite mes compagnons. Aussitôt nous choisissons les plus grasses brebis, et les chassons devant nous jusqu’à ce que nous soyons arrivés vers notre vaisseau. Tranquilles enfin, nous apparaissons à nos amis, nous qui venions d’éviter la mort ; mais ils regrettent les autres en gémissant. Cependant je ne leur permets point de pleurer ; alors, faisant signe de l’œil à chacun d’eux, j’ordonne de conduire promptement ces superbes troupeaux dans le navire, et de fendre l’onde amère. Ils s’embarquent aussitôt, et se placent sur les bancs ; puis, assis en ordre, ils frappent de leurs rames la mer blanchissante. Quand nous sommes éloignés de toute la portée de la voix, j’adresse au Cyclope ces mots outrageants :
« O Cyclope, non, tu ne devais pas, au fond de ta grotte obscure, abuser de tes forces pour manger les compagnons d’un homme sans défense ; tes forfaits odieux devaient être châtiés, misérable, puisque tu n’as pas craint de dévorer des hôtes dans ta demeure ; voilà pourquoi Zeus et tous les autres dieux t’ont puni. »
C’est ainsi que je parlais ; le Cyclope alors, au fond de son cœur, sent redoubler sa rage. Il lance un roc énorme qu’il arrache de la montagne ; il le jette au delà même du navire à la proue azurée ; peu s’en fallut qu’il n’effleurât les bords du gouvernail ; la mer est bouleversée par la chute de ce rocher ; la vague émue, refluant avec violence, repousse mon vaisseau vers la terre, et, soulevé par les ondes, il est près de toucher le rivage. Alors, de mes deux mains saisissant un fort aviron, je m’éloigne du bord ; puis, exhortant mes compagnons, je leur commande, d’un signe de tête, de se courber sur les rames pour éviter le malheur ; eux alors en se baissant rament avec effort. Quand nous fûmes en mer deux fois aussi loin, je voulus m’adresser au Cyclope ; mais autour de moi mes compagnons tâchent à l’envi de m’en détourner par des paroles persuasives.
« Malheureux ! me disent-ils, pourquoi vouloir irriter encore cet homme cruel ? C’est lui qui, lançant cette masse dans la mer, a repoussé notre vaisseau vers le rivage, où nous avons pensé mourir. Sans doute, s’il entend de nouveau ta voix et tes menaces, il va tout à la fois fracasser nos têtes et les planches du navire sous le poids d’un énorme rocher ; tant il peut le lancer avec force. »
Ainsi parlent mes compagnons ; mais ils ne persuadent point mon cœur magnanime. Alors dans mon ardeur, je m’écrie de nouveau :
« Cyclope, si quelqu’un parmi les mortels t’interroge sut la perte funeste de ton œil, dis qu’il te fut ravi par le fils de Laërte, Ulysse, le destructeur des cités, possédant une maison dans Ithaque. »
Je parlais ainsi ; lui, gémissant, répondit alors en ces mots :
« Grands dieux ! le voilà donc accompli cet oracle qui me fut autrefois révélé. Jadis en cette île était un devin, homme fort et puissant, Télémos, fils d’Eurymeos, qui l’emportait sur tous dans la divination, et qui vieillit au milieu des Cyclopes en leur prédisant l’avenir ; il m’annonça tout ce qui devait s’accomplir plus tard, et me dit que je perdrais la vue par les mains d’Ulysse. Aussi m’attendais-je toujours à voir arriver dans ma demeure un héros grand, superbe, et revêtu de force ; pourtant aujourd’hui c’est un homme petit, faible et misérable qui m’arrache l’œil, après m’avoir dompté par le vin. Reviens donc, Ulysse, pour que je t’offre les dons de l’hospitalité, pour que je supplie Poséidon de t’accorder un heureux retour ; je suis son fils, il se glorifie d’être mon père ; seul, si tel est son désir, il me guérira, sans le secours d’aucun autre, ni des dieux fortunés ni des hommes mortels. »
Il dit, et moi je lui répondis en ces mots :
« Plût aux dieux que j’eusse pu, te privant de l’âme et de la vie, t’envoyer dans le royaume d’Hadès, comme il est sûr que Poséidon ne guérira pas ton œil ! »
Telle fut ma réponse ; lui cependant implorait Poséidon, en élevant les mains vers les cieux étoilés.
« Exauce-moi, Poséidon à la chevelure azurée, toi qui soutiens la terre ; si vraiment je suis ton fils, et si tu te glorifies d’être mon père, accorde-moi que le fils de Laërte ne retourne pas dans sa demeure, Ulysse, le destructeur des cités, qui possède une maison dans Ithaque. Si pourtant son destin est de revoir ses amis, de retourner en son riche palais, aux terres de la patrie, qu’il n’y parvienne que tard, après de grands maux ; qu’ayant perdu tous ses compagnons, il arrive sur un navire étranger, et qu’il trouve la ruine dans sa maison.
C’est ainsi qu’il priait ; Poséidon l’exauça. Alors de nouveau le Cyclope, saisissant une roche plus grande que la première, la lance, en la faisant tourner dans les airs, pour lui donner toute sa force. Cette masse tombe derrière le navire à la proue azurée ; peu s’en faut qu’elle ne frappe la pointe du gouvernail. La mer est soulevée par cette chute ; les vagues poussent le navire en avant, il est près de toucher au rivage. Lorsque nous eûmes atteint l’île où mes autres vaisseaux étaient restés, nous trouvâmes nos compagnons assis tout auprès, et qui, gémissant, nous attendaient sans cesse ; arrivés en ces lieux, nous tirons le navire sur le sable, et descendons sur le rivage de la mer.
Alors on se hâte d’amener du vaisseau les troupeaux du Cyclope, que nous nous partageons : nul ne s’éloigne de moi sans avoir une part égale aux autres. Mes valeureux compagnons, quand les troupeaux sont partagés, me donnent à part un bélier réservé pour moi seul. Je l’immole aussitôt sur la rive au fils de Cronos, Zeus aux sombres nuages, qui règne sur tous les dieux, et je brûlai les cuisses. Il n’accueillit point mon offrande, mais il délibéra comment seraient anéantis mes forts navires et mes compagnons chéris. Pendant tout le jour, jusqu’au coucher du soleil, nous savourons les mets abondants et le vin délectable. Quand le soleil est couché, quand viennent les ténèbres, nous nous endormons sur le rivage de la mer. Le lendemain, dès que brille l’Aurore, la fille du matin, excitant mes compagnons je leur ordonne de s’embarquer et de délier les cordages. Ils se hâtent de monter sur le navire, se placent sur les bancs, et tous assis en ordre ils frappent de leurs rames la mer blanchissante. Ainsi nous voguons loin de ces bords, heureux d’échapper au trépas, mais le cœur attristé d’avoir perdu nos compagnons chéris.
Fin du chant 9 de l’Odyssée
(Traduction de Jean-Baptiste Dugas-Montbel, 1835 –
Corrections Kulturica : re-hellénistation des noms propres)