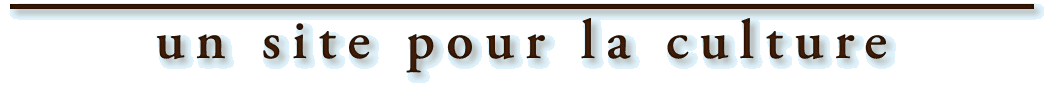Giuseppe Verdi, le pastel que le portraitiste Giovanni Boldini réalisa en quelques heures le 9 avril 1886.
Verdi, un compositeur de génie
Verdi fut l’un plus grands compositeurs d’opéras qui ont existé.
Contrairement à Wagner, son contemporain, Verdi n’a jamais philosophé sur son art ni sur sa manière de composer, et l’on continuera à opposer encore longtemps un Wagner intellectuel, "génial", "visionnaire" à un Verdi instinctif , "besogneux" et "populaire". Cette vision est erronée.
Verdi n’a jamais réellement cherché à ‘expliquer, et c’est seulement au détour d’une lettre, que l’on tombe par hasard sur une idée à peine effleurée. Verdi avait, comme Wagner, des idées très avancées sur ce que doit être un opéra, et le voyait comme un spectacle total, et non comme un divertissement fait de musique « de remplissage » pour laisser les spectateurs discuter entre eux, et de quelques airs complaisants qui seraient fredonnés à la sortie. Le durchkomponiert, les harmonies audacieuses, Verdi les avait introduits dans ses opéras, non d’une manière intransigeante, mais par paliers successifs, pour éduquer ses spectateurs. Dans Falstaff, il va très loin dans cette optique, où les voix sont traitées comme les instruments de l’orchestre, dans une pâte symphonique subtile, étourdissante.
Contrairement à Bizet, Verdi n’a pas donné, au début de sa carrière, d’oeuvres comparables à Carmen, et c’est à l’âge de 38 ans que Verdi compose sa première oeuvre indiscutablement géniale, Rigoletto, qui est tout de même son 16e opéra. Suivent les deux autres volets de ce que l’on a appelés par la suite, sa « trilogie populaire », Le Trouvère et La Traviata. Ce terme de « trilogie populaire » a été bien mal choisi : ces trois opéras n’ont en commun que le fait qu’ils aient été composés successivement, et qu’ils n’ont de populaire que le fait qu’ils ont connu un succès considérable… La musique est d’un raffinement rarement rencontré dans la musique d’opéra à cette époque
Les quinze opéras précédents ne sont pas à jeter. Ils recèlent de belles pages, parfois même inoubliables (le choeur des esclaves de Nabucco). Et surtout, ils possèdent une réelle intensité musicale, ou plutôt musico-dramatique, car Verdi a toujours su, mieux que tout autre, mettre sa musique au service du drame. Souvent bien meilleurs que ce que les scènes lyriques avaient coutumes de proposer, certains ont connu le succès (Nabucco, Attila). Mais cela ne suffisait pas à Verdi.
Il paraît évident, à la lumière des écrits du compositeur, que ces succès n’étaient pas pour lui un aboutissement, mais le signe qu’il était sur la bonne voie. Verdi avait l’ambition de devenir un génie de l’opéra, et il l’est devenu. Verdi a cherché, travaillé, réfléchi. Il était grand symphoniste (il faut écouter l’ouverture de la Traviata !), il composait divinement avec la voix, pour la voix et, enfin, possédait ce que peu de compositeurs possédaient : un réel génie dramatique.
L’opéra au 19e siècle
L’opéra, au 19e siècle, n’était pas le spectacle rare et protégé que l’on connaît aujourd’hui. L’opéra était à l’époque un divertissement que l’on pourrait comparer au cinéma des années 1930. Face à une demande énorme, il fallait mettre d’importants moyens, il fallait créer, produire, composer, mettre en scène, et cela, pour un public, pour lui plaire, et non pas pour l’éduquer. C’est pourquoi, parmi les centaines d’opéras composés depuis 1600, comme parmi les milliers de films tournés dans les années 1930, une faible partie d’entre eux sont des chefs-d’oeuvre.
Verdi a recherché le succès, non comme une fin en soi (bien que l’on puisse comparer peu de bonheurs à celui d’être acclamé par son public), mais comme le « crible » par lequel il pouvait confirmer ou infirmer ses choix musicaux. Mais Verdi connaissait aussi la valeur d’être fredonné par une cousette. Et c’est dans ce cadre qu’il a élaboré son art personnel.
Certains auditeurs répugnent à approuver un art "trop facile". Mais l’art de Verdi est tout sauf facile : sa maîtrise de la composition est virtuose. Ce qui fait en premier lieu le génie de Verdi, c’est la manière dont il réalise "l’accroche", la possibilité qu’il laisse à l’auditeur, quelle que soit son éducation musicale, d’entrer dans le son, d’y trouver ses repères, de s’y reconnaître. Sa musique n’entre pas dans le débat du "simple" ou de l’"hermétique". Elle est universelle.
Le testament le plus drôle du monde
Verdi avait 80 ans lorsque l’on joua la première de Falstaff (1893). Il avait fait mis un point final à sa carrière de compositeur 6 ans auparavant sur ce qui devait être son ultime chef-d’oeuvre, Otello. Mais, deux ans plus tard, en 1889, le librettiste Boito, avec lequel Verdi avait eu des relations parfois houleuses, décide de relancer le vieil homme sur un nouveau livret, un éclat de rire, une "immense explosion d’hilarité" (ce sont les termes mêmes de Boito, exprimés dans une lettre à Verdi).
Les craintes de ne pouvoir terminer l’ouvrage sont balayées, et Verdi se met au travail début 1890, lorsque Boito termine le livret. Celui-ci est tiré principalement des Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare – oeuvre de circonstance que Shakespeare avait écrite pour satisfaire la reine Elizabeth Ie qui désirait retrouver sur scène le personnage de Falstaff qui lui avait tant plus dans Henry IV.
Ecrite par Shakespeare en deux semaines, cette pièce est bâtie sur une trame mince : c’est l’histoire d’une farce (au sens propre du terme) faite par trois femmes de caractère à un coureur de jupons imbu de sa personne – l’esquire Falstaff en personne -, trame dans laquelle se glisse une touchante histoire d’amour entre deux adolescents transis. Cette histoire, a priori sans grand intérêt, recèle pourtant ses joyaux : le personnage formidable de Falstaff (dont on peut difficilement faire le tour, au propre comme au figuré), l’histoire d’amour contrarié qui sert de contrpoint lumineux à la farce vaguement scabreuse, la scène finale dans la forêt, la nuit, où Shakespeare nous convie à un jeu virtuose : nous sommes dans la farce, loin de tout merveilleux, et pourtant, le merveilleux intervient…
Boito simplifie cette pièce, pour l’opéra – quelques pans de l’intrigue tombent, des personnages disparaissent ou "fusionnent" – mais il emprunte également à Henry IV une longue tirade d’anthologie.
Falstaff n’est pas un personnage tout à fait sympathique : il est trop avide de bonnes choses pour penser à son prochain. Ce n’est pas non plus un héros, il est trop vieux, trop près de la mort. Pendant qu’il composait, Verdi s’est identifié à ce personnage, ce qui nous vaut des pages où se mêlent drôlerie et tendresse, où la moquerie n’est jamais méchante. C’est aussi le propre des génies de pouvoir aborder tous les sujets, tous les personnages de la terre sans tomber dans la vulgarité, la bêtise ou la méchanceté.
Verdi avait un compte à régler avec la comédie : son premier opéra-bouffe, Un giorno di regno, fut un échec. Sa composition se place dans la période la plus noire de la vie de Verdi, et l’on ne peut en aucun cas le juger sur le fait qu’il n’ait pas réussi à insufler à sa musique, pendant cette période, l’éclat, la "vis comica" qui lui manquent. C’est avec les tragédies les plus noires et les plus sinistres que Verdi a connu la gloire. Mais, au fil du temps, Verdi avait parfois insuflé à certaines de ses pages une veine sinon comique, du moins "bouffe", un ton plus léger, comme on en trouve, par exemple, dans Rigoletto, la Force du destin et surtout Un Bal masqué (sans doute le plus bel opéra de Vedri avec Otello et Falstaff).
Verdi n’a jamais semblé mal à l’aise avec les conventions de l’opéra : ayant fait ses classes sur le "drame à l’italienne" en 4 actes, il s’est parfaitement adapté au "grand opéra à la française" en 5 actes avec ballet, ainsi qu’à toutes les scènes du monde (n’oublions pas Le Caire !) qui lui ont passé commande. Une telle apparence de soumission ne pouvait laisser présager combien Verdi allait transcender les genres pour créer un canon de l’opéra idéal.
Depuis que l’homme chante accompagné d’un instrument, la musique "derrière la voix" a presque toujours été considérée comme une accompagnement, plus ou moins complexe, de bonne ou de moins bonne qualité, mais rarement la voix humaine avait été traitée comme un instrument. C’est pourtant le cas ici : le chanteur n’a aucun soutien, Verdi traite les voix dans l’ensemble de la pâte orchestrale. Cela ne nuit pas, au contraire, à la compréhension du texte, qui sonne étonamment clair ici, car, si la ligne mélodique vocale n’est pas soutenue, c’est le sens du texte qui en bénéficie. La musique suit le texte, non dans son rythme, non dans sa couleur, mais dans son sens : elle rit avec lui, elle accentue les petits drames et les tensions, elle expose l’énormité du chevalier formidable, elle irradie de tendresse envers les deux amoureux et ensorcelle dans la féerie du dernier acte.
Une musique prodigieusement belle, culminant en drôlerie dans le second acte ("reverenzia" !), et en féérie au troisième, une scène de la forêt digne du Songe d’une Nuit d’été. Rarement autant de beauté aura été conjuguée à autant de drôlerie.
Shakespeare et Verdi : une histoire d’amour
Flastaff n’est pas la première "collaboration" entre Shakespeare et Verdi : Verdi avait déjà mis en musique Macbeth, dans la période "de jeunesse" et Otello, qui aurait dû être le dernier opéra du Maestro.
Macbeth
L’histoire de la composition de Macbeth mérite d’être racontée. C’est la tragédie la plus courte de Shakespeare et il est probable que le texte que l’on possède de Macbeth soit une version amputée et assez largement apocryphe. Si la composition générale de la pièce, la manière dont sont campés les personnages, les "trouvailles" (les trois sorcières, la "forêt en marche"…) sont de veine très shakespearienne (s’il ne les a pas inventées, il aura fait le choix de les retenir, et non de les gommer), mais de nombreuses inélégances verbales sont très éloignées du style du plus grand écrivain anglais. De son côté, après avoir composé son Macbeth à l’âge de 34 ans (1847), Verdi y est revenu 18 ans plus tard, dans l’intention de l’adapter pour le public parisien, en 1865. Les deux styles de Verdi cohabitent, celui des "années de galère" avec ses morceaux de bravoure, et le style raffiné, maîtrisé, virtuose du vieux Verdi. L’opéra que l’on connaît est, comme pour un certain nombre d’opéras de Verdi, la version originale française traduite en italien.
Mais cette pièce puissante développe un vision du mal et du meurtre qui a toujours fasciné. Le livret de Piave, corrigé à la demande de Verdi par Maffei, distille de la pièce sa substantifique moëlle de cruauté et de fatalité.
Otello
Otello, drame raffiné de Shakespeare, avec son cheminement lent vers une fin fatale, le personnage de Iago, à la fois subtil et odieux, terriblement intelligent face au héros Otello, brave et courageux mais stupidement jaloux, mettant en place un complot à la trame parfaite, celui d’Otello, une sorte d’Ajax noir, inspirant admiration pour son courage et répulsion pour la couleur de sa peau – répulsion savamment camouflée mais qui éclate librement à la fin de la pièce – le personnage, enfin, de Desdémone, pure et lumineuse, naïve et aveugle. "Tuez-moi demain, laissez-moi vivre aujourd’hui…"
Trente ans après avoir mis en musique son premier Macbeth, Verdi est revenu à Shakespeare avec Otello et a mis tout son art dans cet opéra avec lequel il comptait clôturer sa carrière de compositeur. Il avait 74 ans, il était arrivé à une maîtrise à laquelle peu de compositeurs ont pu arriver, et il était en pleine forme, physiquement et intellectuellement. La musique d’Otello, splendide, évocatrice, reste encore aujourd’hui un modèle pour les compositeurs.
Discographie
Falstaff
Toscanini nous a laissé un témoignage essentiel de cet opéra (voir plus bas, le coffret consacré aux enregistrements officiels de Verdi par ce très grand chef), mais, pour une première rencontre avec le pancione, la version la plus réjouissante est celle de Bernstein, qui fait honneur à la beauté de la partition et où les chanteurs ne sont pas en reste. Le ton juste de drôlerie et de féérie, iconoclaste, comme l’était le jeune Verdi de 80 printemps. Fischer-Dieskau campe un Falstaff grand diseur, dont le raffinement vocal contraste d’une manière jubilatoire avec la vulgarité foncière du personnage et convient parfaitement à ses prétentions de noblesse et de grandeur. A ses côtés, des chanteurs d’exception, hélas aujourd’hui oubliés pour la plupart, dont un trio de "commères" de rêve, composé d’Ilva Ligabue, de Regina Resnik et de Hilde Rössel-Majdan.
Plus récente, la version Abbado, avec le magnifique Falstaff de Bryn Terfel, qui apporte au rôle une profondeur nouvelle, se pose comme la référence moderne.
Les autres adaptations shakespeariennes de Verdi
Macbeth
L’enregistrement actuellement le plus satisfaisant est celui d’Abbado : très réussi techniquement, il manque de théâtralité, mais il n’existe pas de version idéale. Le live de 1952 avec Maria Callas et de Sabata à la baguette
a malheureusement toujours été très "flou" sur le plan sonore, malgré les efforts des ingénieurs d’EMI qui en a racheté les bandes. La version Leinsdorf vaut surtout pour son plateau de rêve
, avec le Macbeth de Leonard Warren, la très grande Lady Macbeth de Leonie Rysanek et la superbe prestation de Carlo Bergonzi.
Otello
Pour Otello, il y a bien sûr le témoignage de Toscanini, et aucun amoureux de cette oeuvre ne saurait s’en passer. Mais la plus belle version, la version idéale pour apprendre à connaître son Otello, pour l’écouter et le réécouter, c’est la version Karajan de 1961, avec l’angélique Tebaldi et le timbre divin de Del Monaco. Ce ténor n’a jamais été meilleur que sous la direction de Karajan, et Tebaldi est ici captée à son zénith, tandis que Karajan, extraordinaire chef de théâtre, nous détaille les merveilles de musicalité de cette partition géniale dans un climat de tension dramatique qui ne se relâche pas.
Il n’y a eu aucun enregistrement officiel de Carlos Kleiber dirigeant Otello , bien que ce fut l’un des opéras qu’il affectionnait. Il nous reste heureusement quelques témoignages non officiels, notamment la fameuse soirée à la Scala du 7 décembre 1976, où il dirigea cet opéra en public pour la première fois, tandis que Domingo, Freni et Cappuccilli faisaient eux-aussi leurs débuts dans les rôles, respectivement, d’Otello, de Desdemona et de Iago. Une splendeur, et la qualité sonore est une bonne surprise.
Les amateurs d’opéra n’hésiterons pas à investir dans le coffret de 12 CD comprenant l’intégrale des enregistrement verdiens officiels de Toscanini pour RCA, dans un mono meilleur que jamais. On y trouvera deux indispensables, Otello et Falstaff, deux des plus beaux enregistrements d’opéra réalisés, ainsi que ses splendides Aïda, Traviata et Un bal masqué. On ne trouvera pas ailleurs de meilleure direction. Malheureusement, les chanteurs ne sont pas toujours au niveau du chef. Si les chanteurs de cet Otello et de ce Falstaff se sont surpassés et si le plateau du Bal masqué est équilibré, Herva Nelli souffre en Aïda, et Licia Albanese, malgré un vrai tempérament, nous laisse une Traviata parfois aigre, souvent stridente. En prime, un très beau Requiem, et beaucoup de belles surprises.