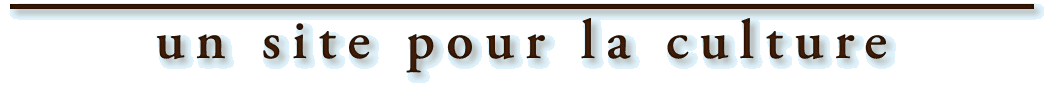L’Iliade et l’Odyssée dans la traduction de Jean-Baptiste Dugas-Montbel
L’Iliade : Chant 1 • Chant 2 • Chant 3 • Chant 4 • Chant 5 • Chant 6 • Chant 7 • Chant 8 • Chant 9 • Chant 10 • Chant 11 • Chant 12 • Chant 13 • Chant 14 • Chant 15 • Chant 16 • Chant 17 • Chant 18 • Chant 19 • Chant 20 • Chant 21 • Chant 22 • Chant 23 • Chant 24
L’Odyssée : Chant 1 • Chant 2 • Chant 3 • Chant 4 • Chant 5 • Chant 6 • Chant 7 • Chant 8 • Chant 9 • Chant 10 • Chant 11 • Chant 12 • Chant 13 • Chant 14 • Chant 15 • Chant 16 • Chant 17 • Chant 18 • Chant 19 • Chant 20 • Chant 21 • Chant 22 • Chant 23 • Chant 24
Lutte d’Ulysse contre les Phéaciens.

Ulysse et ses compagnons, mosaïque du musée du Bardo à Tunis
Dès que l’Aurore, la fille du matin, eut brillé dans les cieux, le fort Alcinoos sort de sa couche ; de son côté se lève aussi le valeureux Ulysse, fils de Zeus. Le roi marche le premier pour se rendre à l’assemblée qui devait se tenir près des vaisseaux. Quand ils sont arrivés, tous deux s’asseyent l’un près de l’autre sur des pierres polies. Cependant la puissante Athéna parcourait la ville sous la figure d’un des hérauts d’Alcinoos ; et, toujours occupée du retour d’Ulysse, elle adresse ces paroles à ceux qu’elle rencontre :
« Hâtez-vous, princes et chefs des Phéaciens, de vous rendre à l’assemblée, pour apprendre quel est cet étranger tout nouvellement arrivé dans le palais d’Alcinoos, après avoir erré sur les flots, et qui par sa taille est semblable aux immortels. »
En parlant ainsi, la déesse excite l’intérêt et le désir des Phéaciens. Bientôt toutes les places, tous les sièges, sont remplis d’hommes rassemblés ; et chacun contemple avec admiration le noble fils de Laërte. Athéna répand une grâce divine sur la tête, sur les épaules du héros, et le fait paraître plus grand et plus fort, pourqu’il soit cher aux Phéaciens, qu’il leur soit respectable et terrible, et qu’il triomphe dans les jeux où ces peuples doivent éprouver la vigueur d’Ulysse. Quand tous les citoyens sont réunis, Alcinoos fait entendre ces mots au sein de l’assemblée :
« Écoutez-moi, princes et chefs des Phéaciens, pour que je vous dise ce que m’inspire mon cœur. Je ne sais quel est cet étranger, égaré dans sa route, et s’il vient dans mon palais, après avoir quitté les peuples, ou de l’aurore ou du couchant ; mais il nous demande de le reconduire, et nous supplie d’assurer son retour. Soyons ce que nous avons été jusqu’à présent, et songeons à le reconduire. Jamais aucun étranger venu dans ma maison n’eut longtemps à gémir parmi nous dans l’attente de son départ. Mais allons, lancez à la mer le meilleur de nos vaisseaux; choisissez parmi le peuple cinquante-deux jeunes gens, et les plus habiles. Tous attachez les rames sur les bancs du navire ; ensuite, venant dans mon palais, hâtez-vous de préparer le repas, je veux en offrir un splendide à tous. C’est aux plus jeunes que je confie ces soins ; pour vous, princes décorés du sceptre, venez dans mes riches demeures, afin que nous y recevions l’étranger avec amitié ; qu’aucun de vous ne me refuse ; cependant appelez le chantre divin, Démodocos, auquel un dieu donna la voix pour nous charmer, toutes les fois que son âme le porte à chanter. »
En achevant ces mots, Alcinoos s’avance vers son palais, les princes décorés du sceptre suivent ses pas ; un héraut va chercher le divin chanteur. Cinquante-deux jeunes gens choisis se rendent, comme le roi l’ordonna, sur le rivage de la mer. Quand ils sont arrivés près du rivage, ils lancent le noir navire sur les vagues profondes ; ils placent le mât avec les voiles, passent les rames dans les anneaux de cuir, disposent tout avec soin, et déploient les voiles éclatantes de blancheur ; puis ils conduisent le navire du côté du midi, vers la haute mer ; ils se hâtent ensuite de se rendre dans le vaste palais du sage Alcinoos. Les cours, les portiques, et l’intérieur de la maison sont remplis d’hommes rassemblés ; les jeunes gens et les vieillards y sont en foule. Alors Alcinoos immole douze brebis, huit porcs aux dents éclatantes, et deux bœufs aux pieds vigoureux. Bientôt on dépouille les victimes, on les divise en morceaux, et l’on prépare un festin splendide.
En ce moment arrive un héraut conduisant le divin chanteur que chérissait une Muse, qui lui dispensa le bien et le mal ; elle le priva des yeux, mais elle lui donna de mélodieux accents. Pontonoos le fait asseoir sur un siège enrichi de clous d’argent, au milieu des convives, et l’appuie contre une haute colonne ; il suspend, au moyen d’une cheville, la lyre mélodieuse au-dessus de la tête de Démodocos, et le héraut lui montre comment il pourra la prendre avec la main ; puis tout auprès il place une corbeille, une belle table, avec une coupe remplie de vin, pour que Démodocos boive au gré de ses désirs. Alors tous les convives portent les mains vers les mets qu’on leur à servis. Quand ils ont apaisé la faim et la soif, la Muse inspire à Démodocos de célébrer les faits éclatants des héros, et de redire un chant dont la renommée était déjà montée jusque dans les cieux : la querelle d’Ulysse et d’Achille, fils de Pélée, qui se disputèrent avec d’aigres paroles durant le superbe repas des dieux ; le roi des hommes, Agamemnon, se réjouissait dans son âme que les chefs des Argiens fussent divisés. C’est ainsi que, lui prédisant l’avenir, avait parlé le brillant Apollon dans la divine Pytho, lorsque ce prince franchit le seuil de pierre pour consulter l’oracle ; alors se préparait pour les Grecs et les Troyens le commencement des maux qu’ils devaient éprouver par la volonté du grand Zeus.
Tels étaient les chants de l’illustre Démodocos ; cependant Ulysse, de ses deux mains prenant son manteau de pourpre, en couvrait sa tête et cachait son beau visage ; il avait honte devant les Phéaciens de laisser couler les larmes de ses yeux. Lorsque le chantre suspendait ses accents, le héros séchait ses pleurs, découvrait sa tête, et, remplissant une large coupe, il faisait des libations aux dieux. Mais lorsqu’il recommençait, et que les chefs des Phéaciens l’engageaient à chanter, parce qu’ils étaient charmés de ses paroles, alors Ulysse de nouveau pleurait en couvrant sa tête. Il déroba la vue de ses larmes à tous les Phéaciens ; le seul Alcinoos le vit et s’en aperçut, car, étant assis près du héros, il l’entendit pousser de profonds soupirs. Aussitôt il s’adresse à tous les convives, et leur dit :
« Écoutez-moi, princes et chefs des Phéaciens : nous avons assez longtemps goûté les plaisirs du repas et de la lyre, cette aimable compagne des festins ; sortons maintenant pour nous essayer à toutes sortes de jeux, et que l’étranger, de retour dans sa maison, raconte à ses amis combien nous surpassons tous les autres peuples dans les exercices du pugilat, de la lutte, du saut et de la course. »
À ces mots, il sort le premier de la salle, et tous les convives suivent ses pas. Un héraut suspend à la cheville la lyre harmonieuse, prend la main de Démodocos, et le conduit hors du palais ; il le mène par la même route qu’avaient prise les plus illustres Phéaciens pour aller admirer les jeux. Bientôt ils arrivent, sur une place publique ; les citoyens par milliers suivaient en foule, et dans le nombre plusieurs étaient jeunes et vaillants. Là paraissaient Acronéos, Ocyalos, Élatréus, Nautéus, Prymnéus, Anchialos, Érethméus, Pontéus, Protéus, Thoon, Anabésineos, Amphialos, fils de Polyneos issu de Tectonis ; puis Euryalos, semblable au terrible Arès, et Naubolidès, qui par sa taille et sa beauté l’emportait sur tous les Phéaciens après l’irréprochable Laodamas. Là se trouvaient aussi les trois fils d’Alcinoos : Laodamas, Halios, et le divin Clytoneos. D’abord ils s’avancent pour disputer de vitesse à la course. Depuis la borne s’étendait une longue carrière ; à l’instant tous s’élancent à la fois, en faisant voler la poussière. Le plus prompt à la course fut le valeureux Clytoneos. Autant que des mules traçant un sillon devancent les bœufs, autant ce héros, en courant le premier, arrive près du peuple ; tous ses rivaux sont dépassés. Ensuite ils s’essayent au terrible combat de la lutte : Euryalos l’emporta sur les plus vaillants. Amphialos fut le plus léger à sauter, Élatréus le plus habile à lancer le disque ; au pugilat ce fut Laodamas, fils vaillant d’Alcinoos. Lorsque tous eurent pris plaisir à ces jeux, Laodamas s’adresse à ses compagnons, et leur dit :
« Mes amis, demandons à l’étranger s’il sait, s’il est instruit dans quelque jeu : il n’est point d’un extérieur méprisable ; ses jambes, ses cuisses, ses bras, son cou nerveux, annoncent une mâle vigueur ; même il ne manque point de jeunesse ; mais peut-être est-il brisé par ses nombreux travaux. Je n’en connais pas de plus pénibles que ceux de la mer pour affaiblir un homme, quelque fort qu’il soit. »
« Laodamas, le discours que tu viens de tenir est très-convenable, reprend aussitôt Euryalos. Toi-même, va donc maintenant inviter l’étranger ; porte-lui la parole. »
A peine le noble fils d’Alcinoos a-t-il entendu ces mots, qu’il s’avance au milieu de l’assemblée, et dit au héros :
« Venez aussi, vénérable étranger, vous essayer à des jeux, s’il en est que vous connaissiez ; mais il me semble que vous les savez tous. Non, il n’est pas de plus grande gloire pour un homme, quel qu’il soit, que les exercer et des pieds et des mains. Allons, essayez, et bannissez la tristesse de votre âme. Votre voyage ne sera pas longtemps différé, déjà le navire est à flot, et les compagnons sont tout prêts. »
Alors le sage Ulysse lui répond en ces mots :
« Laodamas, pourquoi m’inviter à vos plaisirs comme pour me railler? Les douleurs bien plus que les jeux remplissent la pensée d’un malheureux qui jusqu’à ce jour à beaucoup souffert et supporté bien des peines ; maintenant, dans votre assemblée, désireux du retour, je suis assis pour supplier Alcinoos et tout le peuple. »
Alors Euryalos, en lui répondant, l’outrage publiquement en ces mots :
« Étranger, non sans doute tu n’es point semblable à l’homme habile dans ces combats nombreux parmi les héros, mais à l’homme assis sur les bancs d’un navire, comme un chef de ces nautoniers qui s’occupent de leurs trafics, registre de cargaison, inspecteur des vivres et des produits de leurs rapines : va, tu n’as point l’air d’un athlète. »
Ulysse, regardant Euryalos avec indignation :
« Étranger, lui dit-il, vous ne parlez pas avec sagesse ; vous me paraissez être un homme insensé. Non, les dieux n’accordent point leurs faveurs à tous les mortels : la beauté, la sagesse et l’éloquence. Tel est inférieur en beauté, mais un dieu, par le charme des discours, orne sa figure ; on se plaît à le regarder ; il parle sans se troubler avec une douce pudeur, et triomphe parmi les hommes assemblés ; quand il marche par la ville, on le considère comme un dieu. Tel autre, au contraire, est par sa beauté semblable aux immortels ; mais autour de lui la grâce des paroles n’est point répandue. Ainsi, vous êtes d’une beauté si parfaite, qu’un dieu même ne serait pas autrement ; mais votre esprit est inconsidéré. Vous m’avez blessé le cœur en parlant sans aucune mesure ; non, je ne suis point inhabile aux combats, comme vous l’avez dit, et je pense avoir été jadis aux premiers rangs, lorsque, dans ma jeunesse, je me confiais à la force de mon bras. Maintenant je suis la proie de l’infortune et des douleurs ; j’ai supporté de nombreux travaux, soit en combattant des ennemis, soit en traversant les vagues orageuses. Cependant, quoique j’aie souffert bien des maux, j’essayerai les jeux ; car votre parole est mordante, et vos discours m’ont excité. »
Il dit, et, sans quitter son manteau, le héros saisit un disque plus grand, plus épais et plus pesant encore que celui dont les Phéaciens s’étaient servis entre eux. Il le fait tourner, et le jette d’une main vigoureuse ; la pierre gronde ; les Phéaciens, navigateurs illustres, au jet de la pierre se couchent par terre. Le disque vole au delà de toutes les marques, en s’échappant sans effort de la main du héros ; Athéna, sous la figure d’un mortel, place un signe à l’endroit que le disque à touché ; puis elle s’écrie :
« Étranger, un aveugle en tâtonnant distinguerait votre marque ; elle n’est point confondue dans la foule, mais elle est en avant de beaucoup. Rassurez-vous sur ce combat ; aucun des Phéaciens ne pourra la dépasser ni même l’atteindre. »
A ces mots, le sage Ulysse est rempli de joie, heureux de trouver dans l’assemblée un juge favorable. Alors, d’une voix plus douce, il dit aux Phéaciens :
« Atteignez ce but, jeunes gens ; bientôt, je l’espère, je pourrai lancer un second disque tout aussi fort et même plus pesant. Mais si le courage excite quelqu’un de vous, allons, qu’il vienne, et, puisque vous m’avez enflammé de colère, qu’il s’essaye au pugilat, à la lutte, à la course : je ne redoute aucun des Phéaciens, excepté le seul Laodamas. Il est mon hôte ; et quel homme combattrait celui qui l’accueille en ami ! Ce ne peut être qu’un méchant, un insensé, celui qui dispute à son hôte le prix des jeux chez un peuple étranger ; il anéantit tout ce qu’il possède. Quant aux autres, je n’en refuse ni n’en redoute aucun ; mais je veux connaître leur force et l’essayer en présence de tous. Certes je ne suis point un lâche, même au milieu des plus vaillants ; je sais manier avec dextérité l’arc étincelant, et le premier je frapperais un héros en jetant un trait dans la foule des ennemis, quand même de nombreux compagnons seraient à mon côté, prêts à lancer leurs flèches. Le seul Philoctête l’emportait sur moi par son arc au milieu du peuple troyen, lorsque les Grecs lançaient des flèches ; mais je crois l’emporter aujourd’hui sur tous les hommes qui, sur la terre, se nourrissent de blé. Pourtant je ne voudrais point le disputer aux héros des premiers âges, tels que fut Héraclès ou l’Échalien Eurytos, eux qui luttèrent au combat de l’arc avec les immortels. Aussi le fier Eurytos mourut-il bientôt, et n’atteignit pas la vieillesse dans son palais ; Apollon irrité l’immola, parce qu’Eurytos avait osé le provoquer au combat de l’arc. Avec mon javelot je frappe un but qu’un autre n’atteint pas avec sa flèche. Toutefois à la course je craindrais que quelque Phéacien ne me devançât ; car je viens d’être misérablement meurtri par des vagues nombreuses ; je suis resté longtemps sans nourriture quand la tempête eut submergé mon navire ; mes membres sont brisés de fatigue. »
Il dit, et tous les assistants gardent le silence ; le seul Alcinoos reprend en ces mots :
« Étranger, vos discours ne peuvent nous déplaire ; vous avez voulu montrer quelle force vous est échue en partage, indigné que cet homme se soit levé dans l’assemblée pour vous outrager ; nul ici ne conteste votre valeur, du moins quiconque sait du fond de l’âme parler avec justice. Mais écoutez, et recueillez maintenant mes paroles, afin qu’un jour, lorsque, dans votre palais, vous mangerez auprès de votre femme et de vos enfants, et vous ressouvenant de notre vertu, vous disiez à quelque héros quels furent les devoirs que nous à toujours imposés Zeus depuis le temps de nos ancêtres. Nous ne sommes point habiles au combat du ceste et de la lutte, mais nous sommes rapides à la course, et nous excellons à diriger les vaisseaux ; nous aimons les festins, le son de la lyre, les chœurs des danses, les parures nouvelles, les bains chauds et les plaisirs de l’amour. Allons, jeunes danseurs phéaciens, vous tous les plus habiles, exécutez les jeux, afin que l’étranger, de retour chez lui, puisse dire à ses amis combien nous l’emportons sur tous les autres dans la navigation, la course, les danses et le chant. Hâtez-vous d’apporter à Démodocos la lyre mélodieuse qui sans doute est restée dans mon palais. »
Ainsi parla le divin Alcinoos ; aussitôt un héraut s’éloigne pour apporter de la demeure du roi la lyre brillante. Alors se lèvent neuf chefs choisis par le peuple, qui disposent tout pour les jeux ; ils aplanissent le sol où s’exécuteront les danses, et donnent plus d’espace à la superbe arène. Le héraut revient, s’approche et remet la lyre à Démodocos : celui-ci se place dans le milieu de l’assemblée. Autour de lui de jeunes hommes paraissent debout, tous à la fleur de l’âge, et les mieux exercés à ces jeux ; bientôt de leurs pieds ils frappent l’arène aplanie. Ulysse contemple avec surprise la brillante rapidité de ces mouvements, et son âme est saisie d’admiration.
Démodocos, en s’accompagnant avec sa lyre, chantait les amours d’Arès et de la belle Aphrodite ; il dit d’abord comment ils s’unirent en secret dans le palais d’Héphaïstos. Arès donna des présents nombreux, et déshonora le lit et la couche du roi Héphaïstos ; mais celui-ci fut averti par le Soleil, qui les vit tous les deux unis d’amour. Lorsque Héphaïstos entendit cette affreuse nouvelle, il vole à sa forge, en méditant une profonde vengeance. Il place sur le billot une énorme enclume, et forge des liens indestructibles, indissolubles, pour qu’ils subsistent inébranlablement. Quand il a préparé ces pièges, plein de colère contre Arès, il se rend dans la chambre où fut placée sa couche ; de toutes parts, autour des pieds de cette couche, il ajuste ces liens ; et nombreux il les attache aux lambris supérieurs, comme les fils légers de l’araignée : nul ne pouvait les apercevoir, pas même aucun des dieux, tant ils étaient placés avec adresse. Après avoir ainsi disposé tous ces pièges autour de la couche, il feint d’aller à Lemnos, ville superbe, et de toutes ses contrées celle qu’il chérissait le plus. Arès, qui n’exerçait point une vaine surveillance, s’aperçut que le boiteux Héphaïstos s’éloignait, et se rend dans les demeures de cette illustre divinité brûlant d’amour pour la belle Cythérée. Elle venait de quitter son père, le puissant Zeus, et se reposait à l’écart ; aussitôt Arès pénètre dans le palais, prend la main d’Aphrodite, et lui dit ces mots :
« Venez sur cette couche, ô divinité chérie, et nous dormirons ensemble. Héphaïstos n’est plus en ces lieux, il est allé dans Lemnos, parmi les Sintiens au barbare langage. »
Il dit ; ce doux repos parut plein de charmes à la déesse. Tous les deux montent sur la couche nuptiale, et bientôt autour d’eux se répandent les liens trompeurs forgés par l’industrieux Héphaïstos : leurs membres ne peuvent ni se mouvoir, ni se dégager. Ils reconnaissent alors que pour eux il n’est plus de fuite. Cependant Héphaïstos arrive auprès d’eux, étant revenu sur ses pas, avant d’être allé dans le pays de Lemnos ; car le Soleil, observateur attentif, l’avait prévenu. Héphaïstos se rend à sa demeure, le cœur dévoré de chagrins ; il s’arrête sous les portiques, et la plus violente colère s’empare de lui ; s’adressant alors à tous les dieux, il s’écrie d’une voix formidable :
« Puissant Zeus, vous tous, dieux immortels, accourez afin de voir des actions infâmes et intolérables; parce que je suis boiteux, la fille de Zeus, Aphrodite, me méprise, et s’unit au farouche Arès, parce qu’il est beau, rapide à la course, tandis que moi je suis sans forces. Pourtant la cause n’en est point à moi, mais à mes parents ; plût aux dieux qu’ils ne m’eussent pas donné le jour ! Regardez comme ils sont unis d’amour sur ma couche nuptiale ; à cette vue, je reste accablé de tristesse. Certes, je ne pense pas qu’ils restent ainsi, même un instant, quelle que soit leur ardeur ; bientôt ils ne voudront plus dormir ensemble : mais ces liens, ces ruses les arrêteront jusqu’au jour où le père d’Aphrodite me rendra tous les présents que je lui donnai pour obtenir cette indigne épouse ; sa fille est belle sans doute, mais elle est sans pudeur. »
Ainsi parle Héphaïstos ; tous les immortels alors se rassemblent dans ses brillants palais ; bientôt arrive Poséidon, soutien de la terre, arrivent aussi le bienveillant Hermès et le puissant Apollon ; mais les déesses par pudeur restent dans leurs demeures. Les dieux, source de toutes nos félicités, s’arrêtent sous les portiques ; un rire inextinguible éclate au sein de la troupe immortelle, lorsqu’ils aperçoivent les ruses d’Héphaïstos. Tous disaient entre eux :
« Non, les méchantes actions ne prospèrent jamais : la lenteur à vaincu la rapidité. Voilà qu’aujourd’hui le pesant Héphaïstos à saisi Arès, le plus vite de tous les habitants de l’Olympe, et, quoique boiteux, il triomphe par ses artifices ; Arès doit payer la dette de son crime. »
C’est ainsi qu’ils discouraient entre eux ; alors Apollon adresse à Hermès ces paroles :
« Hermès, fils de Zeus, vous le dispensateur de tous les biens, voudriez-vous, ainsi renfermé dans d’étroits liens, reposer sur cette couche auprès de la blond’Aphrodite ? »
« Oui, sans doute, puissant Apollon, répond le messager céleste, que je sois enchaîné dans des liens trois fois plus forts ; dieux, et vous, déesses, soyez-en tous les témoins, je consens volontiers à dormir près de la blonde Aphrodite. »
Il dit ; et le rire éclate de nouveau parmi les dieux immortels. Le seul Poséidon ne se livre point à la joie ; sans cesse il supplie l’illustre ouvrier Héphaïstos de délivrer le dieu Arès, et lui dit ces mots rapides :
« Délivrez-le ; moi, je garantis que Arès, comme vous le désirez, payera la dette réclamée avec justice, en présence de tous les immortels. »
« Formidable Poséidon, reprend l’industrieux Héphaïstos, ne me donnez point de tels ordres. C’est une méchante caution que de répondre pour des méchants. Comment pourrai-je vous contraindre, même en présence des immortels, si Arès en fuyant s’affranchissait à la fois de sa dette et de ses liens ? »
« O Héphaïstos, interrompt Poséidon, si Arès s’enfuit et refuse sa dette, c’est moi-même qui l’acquitterai. »
Héphaïstos répondit aussitôt :
« Il ne serait ni juste ni convenable de refuser ta promesse. »
En disant ces mots, le dieu rompt les liens. Les deux amants, après que cette chaîne, quoique si forte, eut été brisée, s’échappent aussitôt : Arès s’élance vers les contrées de la Thrace, et Aphrodite, la déesse des ris, s’envole à Chypre, dans la ville de Paphos ; là s’élève un champ réservé pour elle avec un autel chargé de parfums ; là les Grâces s’empressent de la baigner, et de répandre sur la déesse une huile divine, qui n’est à l’usage que des dieux immortels ; puis elles la revêtent de superbes habits, parure admirable à voir.
Ainsi chantait l’illustre Démodocos ; Ulysse se réjouissait dans son cœur en l’écoutant, et de même tous les Phéaciens, navigateurs habiles.
Cependant Alcinoos engage Halios et Laodamas à danser seuls, parce que nul ne pouvait lutter avec eux. Alors ils prennent en leurs mains un superbe ballon couleur de pourpre, qu’avait fait l’ingénieux Polybos ; l’un des deux, se renversant en arrière, le jette jusqu’aux sombres nuages ; l’autre, s’élançant avec légèreté, l’atteint, et le renvoie sans effort avant que de ses pieds il ait touché la terre. Après s’être exercés à lancer le ballon dans les airs, ils dansent en effleurant le sol, et font mille tours variés ; les jeunes gens, debout dans le cirque, applaudissent avec transport; un grand bruit s’élève de toutes parts. Alors Ulysse adresse au roi ces paroles :
« Puissant Alcinoos, et le plus illustre parmi tous ces peuples, vous m’aviez promis les plus merveilleux danseurs, et c’était à juste titre ; je suis, en les voyant, saisi d’admiration. »
Il dit : le héros Alcinoos éprouve une douce joie ; puis il parle en ces mots aux navigateurs phéaciens :
« Écoutez mes conseils, princes et chefs des Phéaciens : cet étranger me semble être un homme rempli de sagesse. Allons, offrons-lui les dons de l’hospitalité comme il convient. Douze chefs illustres gouvernent le peuple, moi je suis le treizième ; eh bien, que chacun de nous lui donne un manteau superbe, une tunique et de plus un talent d’un or éprouvé ; rassemblons promptement ici toutes ces richesses, afin qu’après les avoir reçues l’étranger se rende au repas du soir, en se réjouissant dans son cœur. Pour Euryalos, il apaisera notre hôte par des paroles et des présents, car le discours qu’il à tenu n’était point selon l’équité. »
Il dit ; tous applaudissent à ces paroles, et donnent des ordres; chacun envoie un héraut pour apporter les présents. Alors Euryalos, s’adressant au roi, lui parle en ces mots :
« Puissant Alcinoos, et le plus illustre parmi tous ces peuples, j’apaiserai l’étranger comme vous le commandez ; je lui donnerai ce glaive d’airain, dont la poignée est d’argent, et le fourreau d’un ivoire nouvellement travaillé ; sans doute ce présent sera digne de lui. »
Aussitôt Euryalos remet entre les mains d’Ulysse un glaive à la poignée d’argent, et lui dit :
« Salut, ô vénérable étranger ; puisque un mot funeste fut prononcé, qu’il s’envole sur les ailes de la tempête. Puissent les dieux vous donner de revoir votre épouse, votre patrie, après avoir, loin de vos amis, souffert tant de maux ! »
« Vous aussi, cher Euryalos, répond Ulysse à l’instant, soyez heureux, et que les dieux vous comblent de biens ! Puissiez-vous n’avoir jamais besoin du glaive que vous m’avez offert, eu m’apaisant par de douces paroles. »
Il dit, et suspend à ses épaules le glaive enrichi de clous d’argent. Le soleil terminait sa carrière, lorsque arrivèrent les présents ; les hérauts les portèrent dans le palais d’Alcinoos. Ses fils reçoivent ces dons magnifiques, et les placent auprès de leur vénérable mère. Cependant le puissant Alcinoos précède les convives ; ils s’asseyent, en entrant, sur des sièges élevés. Alcinoos s’adressant alors à la noble Arété :
« Chère épouse, dit-il, ordonnez qu’on apporte un coffre précieux, le plus beau de tous ; vous y placerez une tunique avec un riche manteau. Commandez aussi qu’on mette sur la flamme un vase d’airain, et faites tiédir l’onde, afin que notre hôte, après s’être baigné, voyant les présents que lui destinent les Phéaciens, se réjouisse pendant le repas, en écoutant une chanson célèbre. Je veux en outre lui donner aussi ma belle coupe d’or, afin que toujours il se ressouvienne de moi lorsque, dans son palais, il fera des libations à Zeus ainsi qu’à tous les autres dieux. »
Ainsi parle Alcinoos ; Arété commande à ses femmes de mettre à l’instant sur le foyer un large trépied. Celles-ci s’empressent de placer sur le feu le trépied destiné pour le bain ; elles y versent de l’eau, puis allument au-dessous le bois qu’elles ont rassemblé. La flamme enveloppe les flancs du trépied, et l’onde s’échauffe. Cependant Arété, de sa chambre, apporte un coffre magnifique, y dépose les riches présents, les habits et les talents d’or que les Phéaciens avaient donnés à l’étranger ; elle y place une riche tunique, un manteau, puis adresse au héros ces paroles rapides :
« Examinez ce couvercle, et vous-même fermez-le promptement avec un lien, pour qu’on ne vous dérobe rien pendant le voyage, lorsque, emporté sur votre navire, vous goûterez les douceurs du sommeil. »
Ulysse, après avoir entendu ces paroles, adapte à l’instant le couvercle, et le ferme avec un nœud compliqué qu’autrefois lui fit connaître l’ingénieuse Circé. Bientôt après, l’intendante du palais, pour le laver, le conduit au bain ; il s’aperçoit qu’on a fait tiédir l’onde, et s’en réjouit, n’en ayant point fait usage depuis qu’il a quitté les demeures de la belle Calypso : mais alors on avait pour lui les mêmes soins que pour un dieu. Quand les servantes ont baigné le héros, elles le parfument d’essences, le revêtent d’une tunique et d’un manteau superbe, et lui, sortant du bain, se rend au milieu des convives. Nausicaa, qui reçut des dieux la beauté, se tenait debout près de la porte solide ; elle admire Ulysse en le voyant, et lui dit ces mots rapides :
« Salut, étranger ; quand vous serez dans votre patrie, ressouvenez-vous de moi, car c’est à moi la première que vous devez d’avoir conservé la vie. »
« Nausicaa, fille du magnanime Alcinoos, lui répond le sage Ulysse, puisse Zeus, le formidable époux d’Héra, me permettre d’aborder dans ma patrie et de revoir le jour du retour ; la sans cesse je vous implorerai comme une divinité, car c’est vous qui m’avez sauvé la vie, jeune vierge. »
Il dit, et va s’asseoir sur un trône auprès d’Alcinoos. Bientôt on distribue les parts du festin, et l’on verse le vin dans les coupes. Alors un héraut s’approche, en conduisant le chantre mélodieux, Démodocos honoré par les peuples ; il le fait asseoir au milieu des convives, et l’appuie contre une haute colonne. Alors Ulysse dit à ce héraut, après avoir coupé le dos du sanglier, entouré d’une graisse délicate, et dont il restait encore la plus grande partie :
« Héraut, portez cette viande à Démodocos, pour qu’il la mange, et dites-lui que je le salue, malgré ma tristesse. De tous les mortels, ces chantres merveilleux sont les plus dignes de nos respects et de nos honneurs, parce que c’est une Muse qui leur enseigne ces chants ; elle aime la tribu des chanteurs. »
Il dit ; le héraut portant dans ses mains le dos du sanglier le place devant Démodocos ; celui-ci le reçoit, et s’en réjouit dans son cœur. Alors tous les convives étendent les mains vers les mets qu’on leur a servis. Quand ils ont apaisé la faim et la soif, le prudent Ulysse, se tournant vers Démodocos, lui parle en ces mots :
« Démodocos, de tous les hommes c’est vous que j’honore le plus, car vous fûtes instruit par une Muse, fille de Zeus, ou par Apollon ; vous chantez admirablement le malheureux destin des Grecs, ce qu’ils ont entrepris, ce qu’ils ont souffert, et tout ce qu’ils ont accompli, comme si vous-même en aviez été témoin, ou si vous l’aviez entendu de quelque autre. Mais à présent changez vos récits, chantez-nous ce cheval de bois que construisit Epeos avec le secours d’Athéna, et que le divin Ulysse conduisit dans la citadelle après l’avoir rempli de guerriers qui renversèrent Ilion. Si vous nous redites ces faits avec exactitude, je proclamerai devant tous les hommes qu’un dieu bienveillant vous enseigna ce chant sublime. »
Aussitôt Démodocos, inspiré par un dieu, commence et fait entendre ses chants, en disant d’abord comment les Grecs s’embarquèrent sur leurs solides vaisseaux, après avoir livré leur camp aux flammes ; mais déjà, sous la conduite du vaillant Ulysse, les Argiens étaient au milieu de la place publique, renfermés dans le cheval ; car les Troyens eux-mêmes l’avaient traîné dans la citadelle. C’est là qu’il fut placé ; les citoyens d’Ilion assis tout autour agitaient des avis divers ; le conseil se partageait entre trois partis, ou de rompre avec le fer les cavités de cette machine, ou, la tirant sur le sommet, de la précipiter sur les rochers, ou bien de permettre qu’elle devînt un immense ornement pour apaiser les dieux : c’est cette dernière résolution qui devait s’accomplir, car le destin d’Ilion était de périr sitôt que ses murs recèleraient cet énorme cheval, où se cachèrent les plus illustres des Argiens, portant à leurs ennemis le carnage et la mort. Démodocos ensuite chanta comment les fils des Grecs, étant sortis du cheval, ravagèrent la ville, après avoir abandonné ces embûches ténébreuses. Il chantait tous les héros renversant à l’envi cette cité superbe ; mais surtout il chante Ulysse, qui, semblable au dieu Arès, se précipite, avec le divin Ménélas, contre le palais de Déiphobos ; Ulysse qui, soutenant en ces lieux un combat terrible, vainquit enfin par les soins de la valeureuse Athéna.
Tels sont les chants de Démodocos ; à ces souvenirs, Ulysse s’attendrissait, et de ses yeux laissait couler des larmes sur son visage. Ainsi pleure une femme attachée au corps de son époux tombé devant la ville et l’armée en repoussant l’heure fatale loin de ses enfants et de sa patrie ; en le voyant palpitant encore et respirant à peine, elle l’entoure de ses bras, et pousse des cris aigus ; derrière elle cependant les ennemis, de leurs lances lui frappant le dos et les épaules, l’entraînant en esclavage pour supporter le travail et la peine ; dans sa douleur lamentable ses joues sont amaigries par les larmes ; ainsi de ses yeux Ulysse laisse couler de lamentables pleurs. Cependant il dérobe son trouble à tous les convives ; le seul Alcinoos le vit et s’en aperçut, car, étant assis près du héros, il l’entendit soupirer avec amertume. Aussitôt il parle en ces mots aux Phéaciens :
« Écoutez-moi, princes et chefs des Phéaciens, que Démodocos suspende les sons de sa lyre harmonieuse ; ses chants ne plaisent pas également à tous. Depuis que le repas est terminé, depuis que le chanteur divin a commencé, l’étranger n’a pas cessé de soupirer ; sans doute un profond chagrin s’est emparé de son âme. Que Démodocos cesse donc de chanter, afin de nous réjouir tous ensemble, les hôtes et l’étranger ; c’est là ce qui vaut le mieux. Car tout est préparé pour ce héros vénérable, le départ et les présents que nous lui donnons avec amitié. L’étranger, le suppliant est comme un frère pour tout homme à qui la plus légère compassion touche le cœur. Mais vous, maintenant, ne me dissimulez point, par de trompeuses pensées, ce que je vais vous demander ; il est bien pour vous de me répondre. Dites-moi de quel nom vous appelaient votre père, votre mère, et ceux qui dans la ville étaient vos proches voisins. Personne parmi les mortels, ni le lâche, ni le vaillant, n’est sans nom au moment de sa naissance ; mais les parents en donnent un à tous les enfants qu’ils mettent au jour. Dites-moi quel est votre pays, votre peuple, votre ville, afin que de leur propre mouvement nos vaisseaux vous y conduisent. Les navires phéaciens n’ont point de pilotes, point de gouvernails, toutes choses qu’ont les autres navires ; mais ils savent les pensées et les désirs des hommes, et connaissent les villes et les champs fertiles de tous les mortels ; ils sillonnent avec rapidité les vagues de la mer, toujours enveloppés dans l’ombre et les nuages ; ils n’ont aucune crainte d’éprouver quelque dommage ni de périr. Pourtant voici qu’autrefois j’entendis raconter à mon père Nausithoos, qui me disait que Poséidon s’irriterait contre nous, parce que nous étions sans péril les guides de tous les étrangers. Il ajoutait qu’un de nos vaisseaux à son retour périrait sur la mer ténébreuse, et qu’une haute montagne couvrirait notre ville. C’est ainsi qu’il parlait ; mais ce dieu peut accomplir ses desseins, ou les laisser sans effet, comme il l’aura décidé dans son cœur. Vous cependant, répondez-moi, racontez avec détail où vous avez erré, quels hommes vous avez visités ; parlez-nous de ces peuples et de leurs villes opulentes ; dites-nous s’ils étaient cruels, sauvages, sans justice, ou s’ils étaient hospitaliers et si leur âme respectait les dieux. Dites-nous enfin pourquoi vous pleurez, pourquoi vous gémissez au fond de l’âme, en écoutant la destinée malheureuse des Argiens, des enfants de Danaos et d’Ilion. Les dieux ont ourdi cette destinée, ils ont résolu la mort d’un grand nombre de héros, pour être un chant instructif aux hommes à venir. Auriez-vous perdu devant Ilion quelque proche parent, un gendre valeureux, un beau-père, eux qui nous sont les plus chers après ceux de notre sang et de notre famille ? Auriez-vous vu périr un compagnon généreux et vaillant ? car il n’est pas moins qu’un frère, celui qui, compagnon fidèle, est rempli de prudence. »
Fin du chant 8 de l’Odyssée
(Traduction de Jean-Baptiste Dugas-Montbel, 1835 –
Corrections Kulturica : re-hellénistation des noms propres)