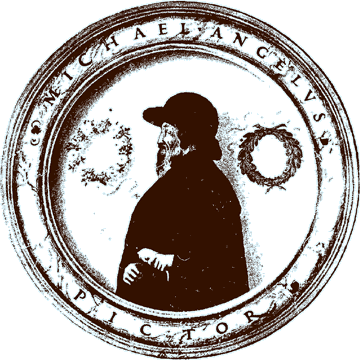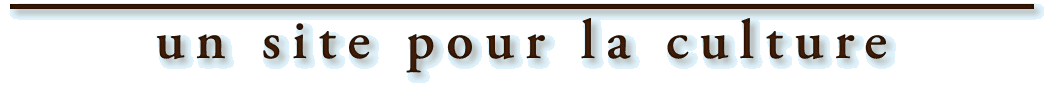Dans son premier dialogue, Francisco de Hollanda met en scène, notamment, à côté de Michel-Ange, l’amie intime de ce dernier, Vittoria Colonna, marquise de Pescara. Michel-Ange s’exprime sur les prérogatives des peintres et leur comportement réputé insociable, et sur la supériorité de la peinture et des peintres italiens et les raisons qui l’expliquent.
Dialogues sur la peinture de Francisco de Hollanda en ligne
Présentation • Premier dialogue • Second dialogue • Troisième dialogue
Michel-Ange, vers 1538 (?), et donc âgé de 63 ans, tiré du carnet de dessin de Francisco de Hollanda.
Dialogue premier
|
Mon intention en allant en Italie, où je fus envoyé par mon Roi, n’était pas de chercher d’autre profit ni d’autre honneur que de bien faire. Je n’avais en vue nul autre intérêt, tel que les bonnes grâces du pape ou des cardinaux de sa cour. Et pourtant, Dieu le sait et Rome le sait, si j’avais voulu demeurer en cette ville, les facilités ne m’eussent sans doute pas manqué, tant par moi-même que par la protection de personnes haut placées dans la maison du pape. Mais toutes ces pensées étaient en moi si amorties que d’autres, plus nobles et plus de mon goût, ne les laissaient même pas traverser mon imagination ; lesquelles pouvaient sur moi beaucoup plus qu’aucune convoitise de bénéfices ou d’expectatives, que j’aurais au moins pu emporter avec moi, comme font ceux qui vont à Rome. |
Notes |
|
|
La seule chose que j’eusse toujours présente, c’était en quoi je pourrais servir par mon art le Roi, notre maître, qui m’avait envoyé en ce pays ; cherchant toujours en moi-même comment je pourrais dérober et emporter en Portugal les gentils chefs-d’oeuvre de l’Italie, pour le plus grand plaisir du Roi, des infants, et du sérénissime seigneur l’infant Dom Luiz 2. |
2. Les infants D. Fernando (1507-1534), D. Affonso (1509-1540) et D. Luiz (1506-1555), fils d’Emmanuel 1er et frères de Jean III. Francisco de Hollanda avait été au service des deux premiers et devait beaucoup à la protection du troisième. |
|
|
Je me disais : «Quelles forteresses ou cités étrangères n’ai-je pas encore en mon livre ? Quels édifices éternels, quelles pesantes statues y a-t-il encore en cette ville, que je n’aie dérobés et que je n’emporte, sans charrettes ni navires, sur de légers feuillets ? Quelle peinture en stuc ou grotesque découvre-t-on dans les excavations et les ruines tant de Rome que de Baïes ou de Pouzzoles, dont le plus curieux ne se trouve esquissé sur mes cahiers 3 ? » Et je ne savais oeuvre antique ou moderne de peinture, sculpture, ou architecture, du meilleur de laquelle je n’eusse pris quelque souvenir. Car il me semblait que c’étaient là les plus excellentes prébendes et expectatives que je pusse emporter avec moi, les plus glorieuses et les plus profitables pour le service de mon roi, et les plus de mon goût. Et, en cela, je ne pense pas m’être trompé, encore que d’aucuns me le disent. |
3. Ce cahier de dessins existe encore à la bibliothèque de L’Escurial. Nous en avons reproduit le frontispice [compte tenu de son manque d’intérêt, nous ne l’avons pas reproduit dans ces pages], et le curieux portrait de Michel-Ange [voir supra]. Il contient, en outre, un médaillon du pape Paul III, des monuments de Rome, de Venise, de Naples, des statues, des ruines, des chapiteaux, etc. |
|
|
En sorte que, comme c’étaient là tous mes soins et mes seules requêtes et sollicitations, je n’avais d’autre cardinal Farnèse 4 à accompagner, ni d’autre Dataire à me rendre favorable que d’aller visiter un jour Don Giulio de Macédoine 5, enlumineur des plus célèbres; un autre, maître Michel-Ange; aujourd’hui, le noble sculpteur Baccio 6; demain, maître Perino 7, ou Sébastien de Venise 8; et, parfois, Valerio de Vicence 9, ou Jacopo Mellequino 10 l’architecte, ou Lattanzio Tolomei 11. La connaissance et l’amitié de pareils hommes m’étaient beaucoup plus précieuses que celles de n’importe quels autres plus éminents ou plus illustres, s’il en pouvait être en ce monde. Et Rome les tient en la même estime. De leurs personnes et de leurs oeuvres je recueillais pour mon art quelque fruit et enseignement, et je me récréais à deviser avec eux de maintes choses excellentes et nobles de l’antiquité aussi bien que des temps nouveaux. Et principalement je prisais si fort maître Michel-Ange que si je le rencontrais, soit chez le pape, soit dans la rue, nous ne consentions à nous séparer que les étoiles ne nous signifiassent la retraite. Et Dom Pedro Mascarenhas 12 l’ambassadeur peut être bon témoin combien c’était chose étonnante et difficile, comme aussi des mensonges 13 que certain jour, à l’issue de vêpres, Michel-Ange dit à lui et au cardinal Santiquattro 14, au sujet de moi et d’un mien livre où j’avais dessiné les choses de Rome et d’Italie. En effet, je ne dirigeais mes pas et mon chemin autre part que vers le temple majestueux du Panthéon 15, dont je faisais le tour pour en noter toutes les colonnes et les membres; vers les mausolées d’Hadrien et d’Auguste, le Colisée, les thermes d’Antonin et de Dioclétien, les arcs de Titus et de Sévère, le Capitole, le théâtre de Marcellus, et vers tous les autres monuments remarquables de cette ville, dont je ne me rappelle plus les noms. Parfois aussi, on ne pouvait m’arracher des magnifiques Chambres du pape, où j’allais seulement parce qu’elles sont peintes de la noble main de Raphaël d’Urbin. Et je préférais de beaucoup les antiques hommes de pierre sculptés sur les arcs et les colonnes des vieux édifices à ceux, plus changeants, qui nous importunent de toute part. Et j’apprenais davantage d’eux et de leur muette gravité. Or, entre temps que je passais ainsi à Rome, je dus certain dimanche, comme j’avais accoutumé ce jour-là, aller faire visite à messer Lattanzio Tolomei. C’était lui qui, avec l’aide de messer Blosio, secrétaire du pape, m’avait procuré l’amitié de Michel-Ange. Et ledit messer Lattanzio était un personnage très considérable, tant par la noblesse de son esprit et de son sang (il était neveu du cardinal de Sienne 16) que par sa connaissance des lettres latines, grecques et hébraïques, et par l’autorité de son âge et de ses moeurs. Mais je trouvai avis en sa maison qu’il était, avec madame la marquise de Pescara, en l’église de Saint-Sylvestre 17, à Monte Cavallo, à entendre une lecture des Epîtres de saint Paul. J’allai donc à Saint-Sylvestre de Monte Cavallo. Madame Vittoria Colonna, marquise de Pescara et soeur de monseigneur Ascanio Colonna, est une des femmes illustres et renommées qu’il y ait en Italie et dans l’Europe entière, c’est-à-dire au monde. Chaste et encore belle, latiniste, éclairée, elle possède toutes les vertus et qualités qu’on puisse louer en une femme. Après la mort de son très noble mari, renonçant à vivre plus longtemps selon sa condition, elle adopta une vie sirnple et retirée. Maintenant elle n’aime plus que Jésus-Christ et les bonnes oeuvres ; elle fait beaucoup de bien aux femmes pauvres, et donne fruit de véritable catholique. Je devais la connaissance de cette noble dame à l’amitié du même messer Lattanzio, lequel était le plus familier et le meilleur de ses amis. Elle me fit asseoir, et lorsqu’eurent pris fin la lecture et les louanges qu’on lui donna, elle se mit à dire en dirigeant son regard vers moi et vers messer Lattanzio : — « Si je ne me trompe, Francisco de Hollanda écouterait de meilleur gré un sermon de Michel-Ange sur la peinture que cette lecture de frère Ambrosio 18. » À cela je répondis, presque offensé : — « Eh quoi! madame, Votre Excellence supposerait-elle que je ne suis apte et accessible qu’à la peinture seulement ? J’aurai, j’en conviens, toujours plaisir à entendre Michel-Ange ; mais, dès qu’il s’agit des Epîtres de saint Paul, j’aime mieux entendre frère Ambrosio. » — « Ne vous fâchez pas, maître Francisco, dit alors messer Lattanzio. Madame la marquise est loin de croire qu’un homme apte à la peinture ne le soit pas à toute chose. Nous avons pour cela, en Italie, une trop haute opinion de la peinture! Mais peut-être a-t-elle ainsi parlé pour vous donner, outre le plaisir que vous avez déjà eu, celui de voir Michel-Ange. » Je répondis aussitôt : — « À ce compte, Son Excellence ne fera pour moi rien de nouveau et qu’elle n’ait accoutumé ; car elle accorde toujours plus de grâces qu’on n’oserait lui en demander. » Devinant mon intention, la marquise appela un sien serviteur, et dit en souriant : — « À qui sait se montrer reconnaissant il faut savoir donner ; d’autant plus que ma part, à moi qui donne, restera aussi grande que celle de Francisco de Hollanda, qui reçoit. — Un tel!… Va au logis de MichelAnge, et lui dis que je suis avec messer Lattanzio dans cette chapelle fraîchement arrosée et dans cette église close et agréable. Demande-lui s’il veut venir perdre en notre compagnie quelques heures du jour, afin que nous les gagnions en la sienne. Mais ne lui dis pas que Francisco de Hollanda l’Espagnol est avec nous. » Comme je louais à l’oreille de Lattanzio la délicatesse que mettait en tout la marquise, elle voulut savoir de quoi je parlais. — « Il me disait, répondit Lattanzio, combien Votre Excellence sait observer la bienséance en toute chose, et jusques en un message. Car, Michel-Ange étant à présent plus son ami que le mien, il fait, dit-il, avant de se rencontrer avec lui, tout son possible pour le fuir et pour éviter cette rencontre, parce que, une fois réunis, ils ne savent plus se séparer. » — « Je connais trop bien maître MichelAnge, répliqua-t-elle, pour ne pas connaître ce sentiment. Aussi ne sais-je comment nous nous y prendrons pour l’amener habilement à parler de peinture. » Frère Ambrosio de Sienne, un des prédicateurs les plus renommés du pape, ne s’en était pas encore allé. — « Je ne crois pas, dit-il, que MichelAnge, s’il sait que l’Espagnol est peintre, consente en aucune manière à parler de peinture… Aussi devriez-vous vous cacher, si vous voulez l’entendre. » — « Le Portugais que je suis, répondis-je rudement au moine, n’est peut-être pas si facile à cacher aux yeux de Michel-Ange. Tout caché que je sois, il saura mieux me connaître que Votre Révérence, devant qui je me tiens, mît-elle même des lunettes. Qu’il vienne seulement, et vous verrez qu’il me verra beaucoup moins bien si je reste là où je suis. » À ces mots la marquise et Lattanzio se prirent à rire. Il n’en fut pas de même de moi, ni du moine, lequel entendit en outre la marquise lui affirmer qu’il trouverait en moi plus qu’un peintre. |
4. Alexandre Farnèse (1520- 1589), fils de Pier Luigi et petit-fils du pape Paul III, reçut la pourpre en 1534. Quoique Michel-Ange ait dit (Dialogue III) qu’il « ne savait pas ce que c’était que la peinture », ce prélat, dont le nom revient souvent dans l’histoire de la Renaissance italienne, aima les arts et favorisa les artistes. Il réunissait autour de lui une petite cour de poètes et de lettrés, tels que le Molza, Annibal Caro, Paul Jove, Claudio Tolomei, tous admirateurs de Vitruve dont ils étudiaient et commentaient les œuvres. C’est à l’initiative de ce groupe que nous devons les œuvres de Vasari. Paul Jove se proposait d’écrire les vies des artistes célèbres, pour faire pendant à ses Il’usirium uirorum vitte; il demanda à messer Giorgio des notes dont il fut si satisfait qu’il l’engagea à poursuivre et à composer lui-même l’ouvrage (Vasari, Descrizione delle opere di Giorgio Vasari, XXVIII). 5. Voir plus loin, n. 82. 6. Voir plus loin, n. 55. 7. Perino del Vaga (1500-1547), peintre florentin. 8. Sébastien del Piombo (I485-1547) peintre vénitien. Il a peint, entre autres portraits, celui de Vittoria Colonna. Voir plus loin, n. 76. 9. Valerio Belli, de Vicence (1468-1546), ciseleur et graveur de médailles. Voir plus loin, n. 85. 10. Jacopo Melighino, ferrarais, fut très protégé par Paul III. Balthasar Peruzzi lui laissa en mourant une partie de ses papiers. Melighino qui, au dire de Vasari, n’avait pas plus de dessin que de jugement, travaillait en même temps qu’Antonio da Sangallo à l’église de Saint-Pierre, et n’était pas moins rétribué que lui. Lorsque Perino del Vaga, Sébastien del Piombo, Michel-Ange et Vasari présentèrent au pape leurs projets pour la fameuse corniche du Palais Farnèse, Paul III déclara, après les avoir examinés: « Tous ces dessins sont beaux, mais il nous reste à voir celui de notre Melighino. » — « Saint-Père, riposta Sangallo, le Melighino est un architecte pour rire. » — « Nous voulons, répondit le pape, qu’il soit un architecte pour de bon; ses appointements vous le prouvent. » 11. Lattanzio Tolomei (14.. -1548), dont il a été question dans la préface de ce livre, était ambassadeur à Rome de la ville de Sienne. Le Palais Tolomei, dont la construction date de 1205, existe encore en cette ville. 12. D. Pedro de Mascarenhas fut ambassadeur de Portugal à Rome de décembre 1538 à mars 1540. Il mourut vice-roi des Indes, à Goa, le 16 juin 1555. 13. Par le mot mintiras, mensonges, Francisco de Hollanda entend des flatteries mensongères, exagérées. Il emploie plusieurs fois cette expression. 14. Il y eut deux cardinaux de ce nom, ou plutôt de ce titre: Lorenzo Pucci, que Condivi appelle il cardenale Santiquattro vecchio, et son neveu Antonio Pucci, dont parle ici Fr. de Hollanda. Le premier eut à s’occuper, comme exécuteur testamentaire de Jules II, du tombeau de ce pape, tombeau qui fut, on le sait, une source d’ennuis et de préoccupations pour MichelAnge. En 1533, Lorenzo Pucci, alors évêque de Pistoie, demandait au grand artiste le plan d’un pont et d’une chapelle pour la ville d’Igno. 15. Ora o meu proprio passa e a minha roita não era outra senão rodear o grave templo do Pantheon… Fr. de Hollanda joue ici sur les mots passa, pas, passage, et paço,palais, et sur le mot rota, qui signifie a la fois route et rote, tribunal ecclésiastique composé de douze juges dits auditeurs de rote. Cette phrase a donc aussi le sens de : Je ne fréquentais d’autre palais, d’autre tribunal de rote que le temple du Panthéon… 16. Girolamo Ghinucci. Il fut nonce en Espagne et en Angleterre sous le règne d’Henri VIII. 17. Aujourd’hui S. Silvestro al Quirinale, dans la rue du Quirinal. 18. Fra Ambrogio da Siena s’appelait, de son nom de famille, Lancillotto Politi. |
|
|
Etant restés quelque temps sans parler, nous entendîmes heurter à la porte, et nous commençâmes tous a exprimer notre crainte que Michel-Ange ne vînt pas, puisqu’on rapportait si vite la réponse. Mais ma bonne fortune voulut que Michel-Ange, lequel logeait au pied du Monte Cavallo, se dirigeât avec son fidèle Urbino 19 du côté de Saint-Sylvestre, faisant route vers les Thermes, tout en philosophant le long de la Voie Esquiline. Il se trouvait donc si proche de notre rendez-vous qu’il ne put nous échapper ; et ce n’était autre que lui qui heurtait à la porte. La marquise se leva pour le recevoir et se tint debout un bon moment avant de le faire asseoir entre elle et messer Lattanzio. Pour moi, je m’assis un peu à l’écart. Après être restée quelques instants sans parler, la marquise ne voulut pas manquer plus longtemps à la coutume qu’elle avait d’ennoblir toujours ceux qui s’entretenaient avec elle et le lieu où elle se trouvait. Elle se mit donc, avec un art que je ne saurais décrire, à tenir maints propos bien dits, judicieux et courtois, sans faire la moindre allusion à la peinture, pour ne pas effaroucher le grand peintre. Je la voyais se comporter comme qui veut combattre avec ruse et circonspection une citadelle inexpugnable. Et de même, comme s’il eût été l’assiégé, nous voyions le peintre se tenir alerte et faire vigilance. Il posait ici des sentinelles ; là, faisait lever les ponts, pratiquait des mines, et ne négligeait dans ses rondes ni un mur, ni une tour. Mais il fallut, à la fin, que victoire restât à la marquise. Et je ne sais vraiment qui pourrait lui résister. — « Chacun le sait, disait-elle. Quiconque voudrait avec Michel-Ange en venir aux prises sur son métier, qui est la sagesse et la prudence, ne pourrait jamais qu’être vaincu. Aussi nous faut-il, messer Lattanzio, lui parler de requêtes, de brefs, ou… de peinture, pour le rendre muet et triompher de lui. » — « Ou plutôt, dis-je alors, je ne vois rien de mieux pour mettre Michel-Ange à quia que de lui faire savoir que je suis ici, puisqu’il ne m’a pas encore aperçu. Quoique je sache déjà que le meilleur moyen de ne pas voir une personne c’est de l’avoir sous les yeux. » Vous eussiez vu, à ces mots, avec quel étonnement Michel-Ange se tourna vers moi, et me dit : — « Pardonnez-moi, messer Francisco. Je ne vous avais pas aperçu parce que je ne voyais que madame la marquise. Mais puisque Dieu veut que vous soyez là, venez, en compagnon, à mon aide et à mon secours. » — « Pour ce seul mot je vous pardonnerai ce que vous venez de dire. Mais il me semble que madame la marquise (tel le soleil, dont les rayons dissolvent et durcissent à la fois) produit avec une seule lumière deux effets contraires : vous, sa vue vous a aveuglé ; et moi, c’est seulement parce que je la vois que je vous vois et vous entends. Je sais aussi combien Son Excellence peut captiver l’attention de l’homme le plus averti, sans lui laisser le temps de s’occuper de personne autre ; c’est pourquoi je prends mal parfois les conseils de certains moines. » À ces mots, la marquise se mit à rire derechef. Alors frère Ambrosio se leva, prit congé d’elle et de nous, et s’en fut. Dorénavant il me resta fort ami. |
19. Son vrai nom était Bernardino dell’Amadore da Castel Durante. Après être resté vingt-six ans au service de Michel-Ange, il mourut à Rome le 3 décembre 1555. Tous les biographes du grand sculpteur ont cité l’émouvante lettre qu’il écrivit quelques mois plus tard à Vasari pour lui annoncer la mort d’Urbino. |
|
|
— « Sa Sainteté, reprit la marquise, m’a accordé en grâce la permission de bâtir un nouveau monastère de femmes ici proche, sur le versant du Monte Cavallo, à l’endroit où s’élève le portique en ruine 20 du haut duquel Néron contempla, dit-on, l’incendie de Rome ; et cela, afin que les traces d’un homme si criminel soient effacées sous les pas de pieuses femmes. Mais je ne sais, Michel-Ange, quelle forme ni queIles proportions donner à l’édifice. De quel côté placer la porte ? Quelque partie de l’oeuvre antique pourra-t-elle s’adapter à la nouvelle ? » — « Sans doute, madame, dit Michel-Ange. Le portique en ruine pourra servir de clocher. » |
20. La torre delle Milizie, que le peuple de Rome appelle encore la tour de Néron. |
|
|
Et cette plaisanterie fut dite avec tant de sérieux et de malice que messer Lattanzio ne put s’empêcher de la rappeler 21. Le grand peintre ajouta : — « Ce monastère, il me semble que Votre Excellence le peut parfaitement bâtir. Et, en sortant d’ici, je puis très bien, si tel est votre bon plaisir, y jeter un coup d’oeil pour vous donner en cela quelque idée. » — « Je n’osais, dit-elle, vous en demander autant. Mais je sais déjà que vous observez en toute chose le précepte du Seigneur : Deposuit potentes, exaltavit humiles. Et c’est en quoi vous êtes excellent, parce que vous faites preuve d’une libéralité éclairée, et non d’une prodigalité ignorante. Aussi, à Rome, ceux qui vous connaissent vous estiment-ils plus que vos oeuvres ; et ceux qui ne vous connaissent pas estiment de vous ce qui est le moindre, c’est-à-dire les oeuvres sorties de vos mains. Et je ne donne certes pas moins d’éloges à votre faculté de vous retirer en vous même pour fuir nos vaines conversations et à votre refus de peindre tous les princes qui vous en prient, qu’à votre résolution de ne peindre en toute votre vie qu’une oeuvre unique, comme vous l’avez fait. » — « Madame, dit Michel-Ange, vous voulez d’aventure m’attribuer plus de mérite que je n’en ai. « Mais je veux, à ce propos, me plaindre à vous de bien des gens, en mon propre nom et en celui de quelques peintres de mon humeur, comme aussi au nom de messer Francisco, que voici. « Bien des gens affirment cent mensonges, entre autres que les peintres éminents sont étranges et d’un commerce insupportable et difficile, alors qu’ils n’ont rien de contraire à la nature de l’homme. Aussi les sots, mais nullement les esprits raisonnables, les tiennent-ils pour capricieux et fantasques, et ont-ils grand peine à souffrir pareille humeur en un peintre. Il est vrai que pareille humeur en un peintre ne se trouve que là où il existe des peintres, c’est-à-dire en de rares endroits, tels que l’Italie, où les choses sont en leur perfection. Mais ils sont loin d’avoir raison les oisifs imparfaits qui, d’un travailleur parfait, exigent tant de cérémonies, car il est peu de mortels qui fassent bien leur métier ; et nul de ceux-là ne fait le sien qui blâment ceux qui font le leur. |
21. …que não se pôde ter M. Lactancio que a não lembrasse. Les différents traducteurs ne sont pas d’accord sur ce passage. Manoel Diniz : « que no se pu do tener Miser Lactancio que no la tornase a acordar ». C’est le sens que j’ai adopté. Roquemont : « que messire Lactance ne put s’empêcher d’en faire la remarque ». M. de Vasconcellos : « dass Messer Lattanzio es nicht unterlasse konnte, demselben noch mehr Nachdruck zu verleihen ». |
|
|
« Quant aux vaillants peintres 22, s’ils sont insociables, ce n’est en aucune façon par orgueil, mais parce qu’ils trouvent peu d’esprits dignes de la peinture ; ou pour ne pas se corrompre dans la vaine conversation des oisifs, et pour ne pas rabaisser leur intelligence en l’arrachant aux hautes imaginations qui les tiennent dans un continuel ravissement 23. « Et j’affirme à Votre Excellence que Sa Sainteté elle-même m’ennuie et m’importune parfois quand elle me parle et s’informe avec tant d’insistance pourquoi je ne vais pas la voir. Et je me dis parfois que je sers mieux le pape en ne me rendant pas à son appel et en ne cherchant pas mon intérêt, que lorsque je cherche à le servir de mon mieux en ma maison. Et je lui dis que, ce faisant, je le sers bien plus comme il convient à Michel-Ange qu’en me tenant debout toute la journée devant lui, comme tant d’autres. » — « Oh! heureux Michel-Ange, m’écriai-je à ces mots. Un prince autre que le pape pourrait-il pardonner semblable péché ? » — « Ces péchés-là, messer Francisco, sont précisément ceux que les rois doivent pardonner. » répondit-il. Puis, il ajouta : — « Parfois même, vous dirai-je, ma lourde charge me donne telle licence que, étant à m’entretenir avec le pape, j’ai avec lui mon franc parler, et je mets par inadvertance sur ma tête ce chapeau de feutre. Néanmoins il ne me fait pas mettre à mort pour cela ; c’est lui, au contraire, qui me donne la vie. Et, comme je vous l’ai dit, j’ai en ce cas plus d’égards pour son service, auquel ils sont nécessaires, que pour sa personne, à laquelle ils sont superflus. « S’il se trouvait d’aventure un homme assez aveugle pour affecter un commerce aussi peu avantageux que de vivre à l’écart et de se suffire à soi-même, au point de perdre ses amis et de s’aliéner tout le monde, il n’y aurait pas grand mal à le lui reprocher. Mais, celui qui tient cette humeur tant de la rigidité de sa discipline qui l’exige, que de ce qu’il lui est inné de faire peu de façons et d’affectations exagérées, ne serait-il pas très déraisonnable de l’empêcher de vivre à sa guise ? Et, si cet homme a la modération de ne rien exiger de vous, que prétendez-vous exiger de lui ? Pourquoi vouloir le plier à ces vaines convenances auxquelles sa quiétude ne cadre pas ? Ne savez-vous pas que certaines sciences demandent l’homme tout entier, sans lui laisser le moindre loisir pour vos oisivetés ? Lorsqu’il sera inoccupé autant que vous l’êtes, tuez-le, s’il ne fait mieux que vous votre métier et vos cérémonies. Mais vous ne connaissez cet homme et ne lui accordez vos louanges que pour vous honorer vous-mêmes ; voilà pourquoi vous êtes si heureux qu’il soit digne de s’entretenir avec un pape ou un empereur. Et, à ce propos, j’oserais soutenir qu’il ne saurait avoir grand mérite l’homme qui satisfait les ignorants et non ceux de sa profession, pas plus que celui qu’on ne taxe pas de « singulier », d’ « insociable », ou comme il vous plaira de le nommer ; car les autres esprits, domestiq uéset vulgaires, on les trouve sans chandelle sur les places du monde entier. » Sur ce, Michel-Ange se tut, et, peu après, la marquise reprit : — « Si ces amis dont vous parlez se montraient, en revanche, aussi généreux que ceux de l’antiquité, moindre serait le mal. Archésilas, étant un jour allé voir Apelle qui se trouvait malade et dans le besoin, lui fit soulever la tête sous prétexte d’arranger son oreiller, et, sous cet oreiller, il glissa une somme d’argent pour les soins qui lui étaient nécessaires. La vieille femme qui était au service du peintre ayant trouvé cette somme et s’étonnant de son importance, le malade lui dit en riant : « Ne t’étonne pas ; c’est Archésilas qui est l’auteur de ce vol. » Lattanzio, à son tour, exprima son opinion en ces termes : — « Les vaillants dessinateurs sont tellement jaloux de certains privilèges procédant de leur art qu’ils ne consentiraient à se troquer contre aucune autre espèce d’hommes, si grands soient-ils. Mais au moins leur conseillerais-je d’échanger leur sort contre celui des heureux, si je pensais qu’ils y voulussent consentir ou qu’ils ne s’estimassent les plus heureux des mortels. « Un esprit capable d’exceller en la peinture sait bien où tendent et en quoi consistent la vie et les joies des hommes présomptueux ; comment ils meurent sans laisser de nom et sans avoir connu les choses dignes d’être connues et estimées en ce monde ; comment, enfin, de tels hommes ne peuvent se flatter d’être nés pour tant d’argent qu’ils aient amassé en leurs coffres. Ainsi en arrive-t-il à comprendre qu’en une belle oeuvre et en un renom de vertu immortel réside la félicité de cette vie, et que tout le reste n’est guère à souhaiter. « C’est pourquoi le peintre, en passe de pouvoir obtenir cette gloire, s’estime au-dessus de qui ne connaît et ne sut jamais désirer rien de tel ; de qui se contente d’un empire bien moindre que d’imiter par la peinture une des oeuvres de Dieu ; de qui ne conquit jamais une province aussi vaste que la satisfaction de soi-même en des oeuvres plus malaisées et plus hasardeuses que l’asservissement du pays entre les Colonnes d’Hercule et le Gange indien ; de qui ne mit jamais à mort cet ennemi, le plus difficile à vaincre : la conformité de l’oeuvre avec le désir ou l’idéal d’un grand peintre ; de qui ne fut jamais aussi satisfait, buvant dans un vase d’or, qu’il ne l’est lui-même, buvant dans un vase d’argile. « Et l’empereur Maximilien n’avait pas tort de dire qu’il lui était bien possible de faire un duc ou un comte, mais qu’un peintre excellent, Dieu seul le pouvait faire, quand bon lui semble. C’est la raison pour laquelle il fit grâce à l’un d’eux qui avait mérité la mort. » — « Que me conseillez-vous, messer Lattanzio ? dit ensuite la marquise. Soumettrai-je à Michel-Ange un doute que j’ai sur la peinture ? Ne va-t-il pas à présent, pour soutenir que les manières des grands hommes sont justifiées et nullement étranges, en user envers moi avec ce même emportement qui lui est familier envers d’autres ? » Et Lattanzio : — « Michel-Ange, madame, peut-il faire autrement que de se contraindre en faveur de Votre Excellence, et que de laisser échapper ici ce qu’il est fort bien qu’il garde secret partout ailleurs ? » Michel-Ange ajouta : — « Que Votre Excellence me demande seulement une chose que je puisse lui donner, et cette chose sera sienne. » Et elle, avec un sourire : — « Je désire beaucoup savoir, puisque nous sommes sur ce chapitre, ce qu’est la peinture flamande et quels sont les gens qu’elle satisfait ; car elle me semble plus dévote que la manière italienne. » |
22. Fr. de Hollanda emploie toujours ces mots, os valentes pintores, os ualenies desenhadores, les vaillants peintres, les vaillants dessinateurs, pour signifier les peintres, les dessinateurs de valeur ou de talent. 23. « Michel-Ange, dans sa jeunesse, s’adonna non seulement à la sculpture et à la peinture, mais encore à tous les arts qui s’y rattachent; et cela avec tant d’application qu’il resta un certain temps étranger, ou peu s’en faut, au commerce des hommes et qu’il n’en fréquentait que très peu. De là vient que les uns le tinrent pour orgueilleux, d’autres pour bizarre et fantasque. Or, il n’avait ni l’un ni l’autre de ces défauts, mais l’amour de la perfection et la pratique continuelle des beaux-arts le faisaient vivre solitaire. L’art lui suffisait et faisait tellement ses délices que, loin de lui donner contentement, la société des hommes lui déplaisait, comme le détournant de ses méditations. Et, comme disait le grand Scipion, il n’était jamais moins seul que quand il était seul. » Condivi. |
|
|
— « Madame, répondit posément le peintre, la peinture flamande satisfera en général un dévot quelconque plus qu’aucune peinture d’Italie. Celle-ci ne lui fera jamais verser une seule larme ; celle de Flandre, au contraire, lui en fera verser beaucoup. Et cela ne tient pas à la vigueur et à la bonté de cette peinture, mais à la bonté du dévot en question. Elle plaira aux femmes, principalement aux plus vieilles et aux plus jeunes, comme aussi aux moines, aux nonnes, et à certains gentilshommes privés du sens musical de la véritable harmonie 24. « On peint en Flandre, à vrai dire, pour tromper la vue extérieure, soit des choses agréables à voir, soit des choses dont on ne puisse dire du mal, comme par exemple des saints et des prophètes. Cette peinture n’est que chiffons, masures, verdures de champs, ombres d’arbres, et ponts, et rivières, qu’ils nomment paysages, et maintes figures par-ci, et maintes figures par-là. Et tout cela, encore que pouvant passer pour bon à certains yeux, est fait en réalité sans raison ni art, sans symétrie ni proportions, sans discernement, ni choix, ni aisance, en un mot, sans aucune substance et sans nerf. « Il est néanmoins d’autres pays où l’on peint plus mal qu’en Flandre. Et si je dis tant de mal de la peinture flamande, ce n’est pas qu’elle soit toute mauvaise ; c’est que les peintres de ce pays veulent faire bien tant de choses, dont une seule serait suffisamment difficile, qu’ils n’en font aucune de bien. « Les oeuvres qui se font en Italie sont presque les seules auxquelles on puisse vraiment donner le nom de peinture. C’est pourquoi nous appelons italienne la bonne peinture. Que si on en faisait de telle en un autre pays, nous lui donnerions le nom de ce pays ou de cette province. Et il n’est rien de plus noble ni de plus dévot que la bonne peinture, parce que rien n’évoque et ne suscite davantage la dévotion dans les esprits éclairés que la difficulté de la perfection qui va s’unir et se joindre à Dieu. Car la bonne peinture n’est autre chose qu’une copie des perfections de Dieu et une réminiscence de sa propre peinture ; une musique et une mélodie, en un mot, que seule l’intelligence peut percevoir non sans grande difficulté. Aussi cette peinture est-elle si rare que presque personne ne sait la faire ni ne s’y peut hausser. « Je prétends en outre (et quiconque réfléchira à ce que j’avance en tiendra grand compte) que, de tous les climats ou pays qu’éclairent le soleil et la lune, on ne peut bien peindre en aucun autre qu’en Italie. C’est une chose qu’on ne peut en quelque sorte faire bien qu’ici, y eût-il dans les autres contrées des esprits supérieurs aux nôtres, s’il en peut exister. Et cela, pour les raisons que je vais vous dire. « Prenez un grand peintre d’une autre nation ; dites-lui de peindre ce qu’il voudra et ce qu’il saura le mieux faire, et qu’il le fasse. Prenez, d’autre part, un méchant élève italien ; demandez-lui de tracer une esquisse ou de peindre ce que vous voudrez, et qu’il le fasse. Vous trouverez, si vous êtes bon juge, que l’esquisse de cet apprenti contient, pour ce qui est de l’art, plus de substance que l’œuvre de ce maître ; et ce qu’il aura cherché à faire l’emportera sur tout ce que l’autre aura fait. Demandez, en revanche, à un grand maître qui ne soit pas italien, fût-ce même à Albert Dürer, homme délicat en sa manière, de vouloir bien, pour tromper soit moi-même, soit Francisco de Hollanda, contrefaire ou imiter une oeuvre de peinture qui paraisse italienne ; et, si elle ne peut être des meilleures, qu’elle soit médiocre, ou même mauvaise. On reconnaîtra sur-le-champ, je vous le certifie, que ladite œuvre n’a été faite ni en Italie, ni par la main d’un Italien. |
24. …a alguns fidalgos desmusicos da verdadeira barmonia. On retrouve cette expression plus loin à trois reprises. |
|
|
« Aussi affirmé-je que nulle nation, nul peuple (un ou deux Espagnols exceptés 25) ne peut imiter ni s’approprier la manière de peindre de l’Italie (qui est celle de la Grèce antique) avec assez de perfection pour n’être pas aussitôt et facilement reconnu comme étranger, quels qu’aient été ses efforts et son travail. Et si par grand miracle quelque étranger arrivait à bien peindre, tout ce qu’on en pourrait dire, ne cherchât-il même pas à imiter l’Italie, c’est qu’il peint comme un Italien. « De sorte qu’on n’appelle pas italienne toute peinture faite en Italie, mais toute peinture qui est bonne et conforme à l’art. Et, parce qu’en Italie on fait avec plus d’art et de respect qu’en aucun autre pays du monde les nobles oeuvres de peinture, nous nommons italienne la bonne peinture ; laquelle, fût-elle faite en Flandre, ou en Espagne (dont la manière se rapproche davantage de la nôtre), sera de la peinture italienne, à condition qu’elle soit bonne. Car cette très noble science n’est d’aucun pays, mais elle est venue du ciel. Toutefois elle s’est maintenue depuis l’antiquité en notre Italie plus qu’en aucun pays du monde, et je pense qu’elle s’y maintiendra jusqu’à la fin. » Ainsi parlait Michel-Ange. Et moi, voyant qu’il s’était tu, je l’incitai de cette manière à poursuivre : — « Vous affirmez donc, maître Michel-Ange, qu’aux seuls Italiens au monde vous concédez le don de la peinture. Mais le beau miracle qu’il en soit ainsi! Ne savez-vous pas qu’en Italie on peint bien pour maintes raisons, et qu’en dehors de l’Italie on peint mal pour maintes raisons ? |
25. M. de Vasconcellos suppose que les peintres ainsi désignés doivent être Alonso Berruguete, qui fut élève de Michel-Ange, et Pedro Machuca. |
|
|
« En premier lieu, les Italiens sont par nature extrêmement studieux. Ceux dont l’esprit est ouvert apportent déjà de leur propre fonds, en naissant, le travail, le goût et l’amour de ce à quoi ils sont enclins, de ce que leur demande leur génie. Et si l’un d’eux se détermine à faire un métier, à suivre un art ou une science libérale, il ne se contente pas d’en apprendre ce qui suffit pour s’enrichir ou pour se mettre au rang du commun des ouvriers ; mais il consacre assidûment son travail et ses veilles à devenir unique et hors de pair, n’ayant en vue un moindre intérêt que de devenir un miracle de perfection (je parle à qui me croira, je le sais), et nullement un ouvrier médiocre en cet art ou cette science. Et cela, parce qu’on ne fait en Italie aucun cas de ce nom de médiocre, parce qu’on y tient l’imitation pour une chose des plus méprisables et que, si l’on y parle de quelqu’un pour le porter jusqu’au ciel, c’est de ceux-là seulement qui méritent le nom d’aigles 26 parce qu’ils surpassent tous les autres et se font jour à travers les nuages jusqu’à la lumière du soleil. « Vous naissez de plus (voyez si c’est là un avantage!) en une contrée mère de tous les arts et de toutes les sciences, qui s’y sont conservés ; parmi tant de reliques de vos ancêtres (introuvables partout ailleurs) que, dès votre prime enfance, à quelque profession que vous soyez enclins par penchant ou par génie, vous en rencontrez devant vos yeux maints modèles dans les rues ; en sorte que vous êtes accoutumés dès le berceau à la vue de ces choses qu’en d’autres pays les vieillards même n’ont jamais vues. « D’autre part, en grandissant, alors même que vous fussiez rudes et grossiers, vous avez déjà par habitude les yeux si pleins de la connaissance et de la vue de maintes oeuvres antiques en renom, que vous ne pouvez qu’être portés à les imiter. D’autant plus que vous joignez à cela, comme je viens de le dire, des esprits d’élite, du goût, et un amour infatigable de l’étude. Vous possédez, à imiter, les œuvres de maîtres sans rivaux ; quant aux choses modernes, vos villes sont pleines de toutes les gentilles nouveautés que l’on découvre et invente chaque jour. Et si tous ces avantages, que j’estimerais pour ma part très suffisants à la perfection de n’importe quelle science, vous semblent peu de chose, voici au moins qui mérite considération : « Nous autres, Portugais, encore que certains de nous soient, comme il advient fréquemment, doués en venant au monde d’une gentille intelligence, nous n’en tenons pas moins pour galante l’affectation de priser peu les beaux-arts, et nous rougissons presque d’en être bien instruits ; aussi laissons-nous toujours nos oeuvres imparfaites et inachevées. Vous autres, Italiens (je ne parle ni des Allemands, ni des Français), c’est seulement s’il est terrible en la peinture ou en toute autre faculté, que vous accordez à un homme le plus de gloire, le plus de noblesse, et que vous le jugez capable de bien des choses en dehors de sa profession ; et celui-là seul qui acquiert le renom d’accompli et de singulier en sa profession est tenu en grande estime et parfois presque exalté par les gentilshommes, les capitaines, les esprits éclairés, les détracteurs, les princes, les cardinaux et les papes. Et l’Italie, faisant peu de cas des grands princes et de leur renommée, accorde seulement à un peintre le titre de divin, comme vous le pourrez lire, Michel-Ange, dans les lettres que vous a écrites l’Arétin, ce détracteur de tous les princes de la chrétienté. « Les prix qu’on paie la peinture en Italie me semblent aussi être une des principales raisons pour lesquelles on ne saurait peindre nulle part ailleurs ; car il n’est pas rare qu’une tête ou un visage tirés au naturel s’y paient mille cruzades. Et maintes autres oeuvres s’y paient (vous le savez mieux que moi, messires) autrement cher que dans les autres pays, nonobstant que le mien soit un des plus magnifiques et des plus généreux. « Que Votre Excellence juge à présent si les peintres ne sont pas en Italie, plus qu’ailleurs, favorisés par les circonstances et la libéralité! » — « Il me semble, répondit la marquise, que vous possédez en dépit de ces désavantages l’esprit et le savoir, non d’un ultramontain, mais d’un Italien véritable. Le talent, après tout, est en tous lieux même chose, comme le bien et le mal, jusque dans les pays qui ne sont pas aussi policés que le nôtre. » — « Madame, répondis-je, si l’on vous entendait parler ainsi dans ma patrie, on ne s’étonnerait pas moins des louanges que vous m’accordez d’une manière si flatteuse que de la distinction faite par Votre Excellence entre les Italiens et les autres hommes que vous nommez ultramontains,c’est-à-dire nés au-delà des monts : |
26. Fr. de Hollanda a laissé une liste des artistes « qui ont mérité d’être appelés aigles ». Elle comprend une cinquantaine de noms. Entre autres, parmi les peintres, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, Titien, Perino deI Vaga, Polydore de Caravage, Sébastien del Piombo, Jules Romain, le Parmesan, Giotto, Mantegna, Pordenone, Berruguete, Machuca, Jean d’Udine, Quentin Metsys ; parmi les enlumineurs, Antonio de Hollanda et Giulio Clovio ; parmi les sculpteurs, Michel-Ange, Baccio Bandinelli, le Mosca, Donatello, Nino di Andrea Pisano, Jean de Nola, Torrigiano; parmi les architectes, Bramante,Balthasar Peruzzi, Antonio da Sangallo, Jacopo Melighino et Francisco de Hollanda, « le dernier des architectes » ; parmi les graveurs d’estampes, Albert Dürer, Marc-Antoine, Mantegna et Lucas de Leyde; parmi les graveurs de médailles, Valerio de Vicence, Benvenuto Cellini, Caradosso, Moderno. |
|
|
Non obtusa adeo gestamus pectora Pœni, « Nous avons, madame, en Portugal, de belles et antiques cités, dont la principale est Lisbonne, ma patrie. Nous avons de bonnes mœurs, de bons courtisans, de vaillants chevaliers, et des princes valeureux, soit en temps de guerre, soit en temps de paix. Et surtout nous avons un roi très puissant et illustre, lequel nous gouverne et nous assure la paix. Il règne, en des provinces fort lointaines, sur des peuples barbares qu’il a convertis à la foi. Redouté de tout l’Orient et de la Mauritanie tout entière, il favorise tellement les beaux-arts que, s’étant abusé sur mon talent qui donna dès ma jeunesse quelques espérances, il m’a envoyé voir l’Italie, sa civilisation, et maître Michel-Ange, que voici. « Il est bien vrai que nous n’avons, comme vous en avez ici, ni édifices ni peintures policées ; mais nous commençons cependant, et nos oeuvres vont perdant peu à peu les superfluités barbares que les Goths et les Maures ont semées à travers les Espagnes. J’espère, d’ailleurs, à mon retour en Portugal et au sortir de l’Italie, contribuer à ce que nous puissions, soit pour l’élégance de l’architecture, soit pour la noblesse de la peinture, rivaliser avec vous. « Ces arts se sont, pour ainsi dire, tout à fait perdus en nos provinces, où ils n’ont plus ni réputation ni éclat. La faute en est uniquement à la situation retirée du Portugal, et à une désuétude telle que bien peu de gens les estiment et les comprennent, si ce n’est notre sérénissime Roi, soutien et protecteur de tout mérite, et son frère, le sérénissime infant Dom Luiz, prince aussi brave que savant, lequel a de ces arts, comme des autres sciences libérales, un sentiment très délicat et très judicieux. Pour tous les autres, ils n’entendent rien à la peinture et ils n’en font aucun cas. » |
27. « Nous n’avons pas des esprits tellement obtus, et le soleil n’attelle pas ses coursiers si loin de la ville des Lysiens. » Éneide, I, 567-8. Fr. de Hollanda a substitué le mot Lysia à Tyria qui se trouve dans Virgile. |
|
|
— « Et ils font bien », dit Michel-Ange 28. Mais messer Lattanzio, qui n’avait rien dit depuis un moment, poursuivit de cette manière : — « Nous avons, nous autres Italiens, ce très grand avantage sur toutes les autres nations de ce vaste monde, c’est que nous connaissons et honorons tous les arts et toutes les sciences illustres et les plus dignes de l’être. Or, je vous le fais savoir, maître Francisco de Hollanda, l’homme qui ne comprend rien à la très noble peinture et n’en fait aucun cas, la faute en est à lui seul, et nullement à cet art, qui est de noble et haut lignage. C’est un barbare dépourvu de jugement et de l’une des qualités qui font le plus honneur à l’être humain. « A l’appui de cela, on peut citer maint exemple de très puissants empereurs et rois de l’antiquité et des temps modernes, de philosophes et de sages qui, ayant tout approfondi, se sont fait la plus grande gloire de connaître et d’apprécier la peinture, d’en parler avec les plus hautes louanges, de la pratiquer, et de la payer d’une main libérale et munificente ; comme aussi le grand cas que fait de cet art Notre Mère l’Église, en la personne de ses saints pontifes, de ses cardinaux, de ses princes et de ses prélats. « Donc, comme vous le trouverez dans l’histoire des siècles passés, tous les peuples tinrent toujours cet art en si haute estime que rien ne leur parut plus miraculeux ni plus digne d’admiration. « Nous voyons qu’Alexandre le Grand, Démétrius et Ptolémée, rois fameux, ainsi que bien d’autres princes, se sont fait gloire de savoir apprécier la peinture ; et parmi les Césars Augustes, le divin César, Octavien Auguste, Marcus Agrippa, Claude, et Caligula et Néron, en cela seul vertueux. De même Vespasien et Titus comme le prouvent les célèbres bas-reliefs du Temple de la Paix, que ce dernier éleva après la défaite des Juifs et la prise de Jérusalem. Que dirai-je du grand empereur Trajan, et d’Ælius Hadrien, lequel peignait fort habilement de sa propre main, à ce qu’écrivent dans sa vie Dion le Grec et Spartianus ? Quant au divin Marc-Aurèle, Julius Capitolinus rapporte qu’il apprit à peindre, et eut pour maître Diogenitus. À ce que raconte Hélius Lampridius, l’empereur Alexandre Sévère, qui fut un prince des plus courageux, peignit lui-même sa généalogie pour démontrer qu’il descendait de la famille des Metellus. Plutarque, parlant du grand Pompée, dit qu’il dessina de la pointe de son style, en la ville de Mitylène, le plan et la forme du théâtre qu’il voulait faire construire à Rome, comme il le fit par la suite. « Et,quoique la noble peinture mérite toute vénération par ses effets et ses chefs-d’oeuvre, sans qu’il soit besoin d’alléguer d’autre autorité que la sienne propre, j’ai voulu néanmoins montrer ici, devant qui le sait bien, par quelle sorte d’hommes elle fut estimée. « Et, s’il se trouvait d’aventure en quelque temps ou en quelque lieu un homme se jugeant trop haut placé et trop grand pour daigner faire cas de cet art, qu’il sache quel cas, en ont fait d’autres, beaucoup plus grands que lui. Qui pourrait-il être, en effet, pour s’égaler à Alexandre le Grec, ou le Romain ? Pour surpasser les prouesses de César, la gloire de Pompée, la magnanimité de Trajan ? Or, ces Alexandres et ces Césars, non contents d’aimer avec passion la divine peinture et de la payer à grand prix, la pratiquèrent de leurs propres mains. Et, sera-t-il un seul homme qui, après l’avoir dédaignée en sa farouche présomption, ne se sente, devant la face grave et sévère de la Peinture, très humble et très inférieur à elle ? » Il semblait que Lattanzio terminât ainsi l’entretien ; mais la marquise poursuivit : « Quelle âme vertueuse et quiète, la dédaignât-elle par sainteté, n’éprouverait un grand respect pour la sainte peinture et n’adorerait les dévotes et spirituelles contemplations qu’elle inspire ? « Mais, à vouloir célèbrer ses louanges, le temps ferait défaut plus vite que la matière. Elle provoque à la joie le mélancolique. À l’homme, heureux ou troublé, elle fait connaître la misère humaine. Elle incite l’impénitent à la componction, le mondain à la pénitence, les moins dévots et les moins contemplatifs à la contemplation, à la crainte, et à la honte de leurs fautes. Elle nous représente d’une manière plutôt douce que terrible la mort et le peu que nous sommes. Elle nous montre les périls et les tourments de l’enfer, et, dans la mesure du possible, la gloire et la paix des bienheureux ; ou encore, l’image inconcevable de Dieu Notre-Seigneur. C’est elle qui nous fait voir, mieux que de toute autre manière, la modestie des saints, la constance des martyrs, la pureté des vierges, la beauté des anges, l’ardent amour, la charité ardente des séraphins. Elle rend notre esprit plus pénétrant, et, le ravissant en extase par delà les étoiles, lui permet d’imaginer l’empire de là-haut. « Dirai-je de quelle manière elle nous rend présents, pour que nous puissions imiter leurs hauts faits, les grands hommes morts depuis tant d’années que jusqu’à leurs ossements ont disparu de sur la terre ? Comment elle nous montre, sous forme d’exemples et d’histoires délectables, leurs conseils de guerre et leurs batailles, leurs actions d’éclat, leur mansuétude et leurs moeurs ? Aux capitaines elle apprend la disposition des armées antiques, l’ordonnance des cohortes, l’ordre et la discipline militaires. Scipion l’Africain n’avouait-il pas qu’elle inspire le courage et l’audace, en suscitant dans les coeurs une émulation et une vertueuse envie à l’égard des guerriers fameux ? — « La peinture conserve le souvenir des vivants à ceux qui viendront après eux. Elle nous montre les vêtements des étrangers et des anciens, la diversité des peuples, des monuments, des animaux et des monstres dont la description écrite serait prolixe et difficile à comprendre. Et, non content de cela, ce noble art nous met sous les yeux l’image de tout grand homme que nous désirons voir et connaître d’après ce qu’il a fait ; comme aussi la beauté d’une femme étrangère et séparée de nous par bien des lieues (chose que Pline vante au plus haut point). À qui meurt elle donne la vie pendant bien des années, en nous conservant la ressemblance peinte de son visage ; elle console la femme qui voit chaque jour devant elle l’image de son mari défunt, et les enfants qu’il a laissés tout petits sont heureux, parvenus à l’âge d’homme, de connaître au naturel l’aspect de ce père qui leur est cher, et dont la présence leur inspire la crainte de toute action honteuse. » Ici la marquise, presque en larmes, fit une pause. Messer Lattanzio continua, pour l’arracher à ses souvenirs et à son imagination : — « Outre ces considérations, qui ont un grand poids, est-il rien, plus que la peinture, qui ennoblisse ou embellisse toute chose: les armes, les temples, les palais, les forteresses, quoi que ce soit où il y ait place pour l’ordre et la beauté ? Aussi les grands esprits affirment-ils que l’homme ne peut rien trouver de mieux pour triompher de sa condition mortelle et de l’envie du temps. Et Pythagore ne s’écartait guère de cette opinion lorsqu’il disait que trois choses seulement rendent les hommes semblables à Dieu immortel : la science, la peinture et la musique. » Michel-Ange dit alors : — « Je suis certain, messer Francisco, que s’ils voyaient en votre Portugal combien sont belles les peintures qu’il y a en certaines maisons de notre Italie, ils ne sauraient être assez dépourvus de sens musical pour n’en pas faire grande estime et pour ne pas désirer les posséder. Mais comment pourraient-ils connaître et apprécier ce qu’ils n’ont jamais vu et ce qu’ils ne possèdent pas ? » Là-dessus, Michel-Ange se leva, pour montrer qu’il était temps de penser à se retirer. La marquise se leva de même, et je la priai en grâce de donner rendez-vous à toute cette illustre société, pour le jour suivant, en ce même lieu ; et que Michel-Ange n’y manquât pas. Elle fit ce que je lui demandais, et Michel-Ange promit de venir . |
28. « Fazem bem » dixe M. Angelo. Roquemont traduit : « Votre roi et vos princes font bien ». C’est n’avoir pas compris combier cette boutade est dans le caractère et les habitudes de Michel-Ange. Lorsqu’on lui montra la salle de la Chancellerie, où Vasari avait peint des faits de la vie de Paul III, on lui dit que cet immense travail avait été exécuté en cent jours seulement. « E’ si conosce » (Ça se voit), répondit-il sur le même ton. |
|
|
Étant tous sortis avec la marquise, messer Lattanzio et Michel-Ange se séparèrent de nous. Moi et Diego Zapata l’Espagnol, nous accompagnâmes la marquise du monastère de Saint-Sylvestre de Monte Cavallo jusqu’à cet autre monastère où l’on conserve le chef de saint Jean-Baptiste 29. C’est là qu’elle demeurait et que nous la remîmes aux mains des mères et des religieuses. Et je regagnai mon logis. |
29. S. Silvestro in Capite, église construite par le pape Paul 1er (757-767) pour y conserver la relique de saint Jean dont parle Fr. de Hollanda. |